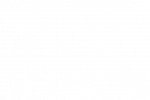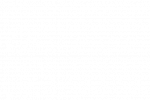L’exil de Hassan : « Tigisi était éthiopienne, très belle. Grâce à elle, j’ai pu aller en Turquie »

L’exil de Hassan : « Tigisi était éthiopienne, très belle. Grâce à elle, j’ai pu aller en Turquie »
Par Emile Costard
Dans cette série en trois épisodes, Hassan, un réfugié d’origine érythréenne, raconte son histoire et l’épopée qui l’a mené en France.
Depuis deux mois, dans le cadre du projet européen « Les nouveaux arrivants », Le Monde suit un groupe de réfugiés installé à Vichy. Pendant un an, nous racontons l’intégration de ces hommes originaires du Soudan et d’Erythrée. Hassan est l’un d’’eux.
C’est à bord de sa Peugeot 307 bleu pétrole que Hassan passe nous prendre en cette matinée du 14-Juillet. Arrivé chez lui, il reprend là ou il s’était arrêté deux jours plus tôt, comme s’il avait mis pause sur le disque de son existence.
Après avoir vécu près de deux ans en Erythrée, son pays d’origine, Hassan a décidé de fuir lorsqu’il a reçu sa convocation au service militaire. De retour au Soudan, son pays d’adoption, il a fait route vers la capitale, Khartoum. Il ne sait pas encore comment s’y prendre, mais Hassan a décidé de rejoindre l’Europe. Les mois défilent jusqu’à ce qu’il rencontre une jeune Ethiopienne qui précipitera son départ.
Une fois à Khartoum, j’ai trouvé rapidement du travail. J’étais prêt à faire n’importe quoi. J’ai bossé pendant deux mois dans la restauration et sur des chantiers. Je dormais à droite, à gauche.
Un soir, alors que je fume une cigarette dans un café, perdu dans mes pensées, un Yéménite du nom d’Ahmed me demande du feu. Nous engageons la conversation et, sans vraiment m’en rendre compte, je lui raconte mon histoire : l’Erythrée, le Soudan, mon envie de partir en Europe… J’avais besoin de parler et cet homme m’écoutait. En partant, il me donne son numéro et m’invite à l’appeler. Il me dit qu’il peut peut-être m’aider, que son oncle fait du business et qu’il pourrait me le présenter. Alors dès le lendemain, je le recontacte.
Ahmed a tenu parole et il m’a fait rencontrer son oncle, Abdallah. Je n’ai jamais compris ce qui l’avait poussé à faire ça pour moi. Les rencontres surviennent au hasard de l’existence, et j’aime me remémorer celle-ci car elle était emplie d’humanité et de solidarité.
Abdallah avait des camions qui livraient des fruits et légumes, mais aussi une grande entreprise d’extraction de pierres. J’ai commencé à faire des livraisons. En ramenant le camion à l’entrepôt, je voyais les camions à benne, les pelleteuses et les bulldozers qui servaient dans les carrières. Au bout d’un mois, je savais tout conduire. Abdallah m’a fait faire une journée d’essai puis il m’a embauché. Je gagnais bien ma vie, je travaillais beaucoup. J’ai aimé cette période, j’avais un bon travail, je pouvais mettre de l’argent de côté.
Mais tout s’est arrêté du jour au lendemain. Ce qui m’avait fait du tort des années auparavant au Soudan se reproduisait. Je ressentais une certaine jalousie de la part des collègues, j’entendais des moqueries, parfois ils m’insultaient. Le gérant de la carrière ne m’avait pas à la bonne. Un jour il m’a dit que c’était terminé, sans aucune raison. Je ne demandais jamais rien, je travaillais bien et beaucoup. C’est tout.
C’était le retour de la galère et je savais que ce serait compliqué de retrouver un aussi bon boulot. J’étais vraiment déprimé. J’ai trouvé un emploi de chauffeur de camion-citerne, mais il fallait aller dans les zones en guerre du Soudan et je n’avais pas envie de risquer ma peau pour le salaire misérable qui était proposé. J’ai décliné l’offre. Tout se refermait de nouveau sur moi, mes économies fondaient et ne me permettaient pas de quitter le pays.
Puis, un jour d’errance, j’ai entendu un homme parler d’immigration. C’était un passeur. Je l’ai interpellé, il m’a demandé combien j’avais. Pas grand-chose, seulement 4 000 livres soudanaises [500 euros]. Pour ce prix-là, il m’a dit que je pouvais trouver des passeurs qui m’organiseraient un voyage vers la Libye mais qu’il y avait des risques que j’arrive en Europe dans un cercueil.
Lui se présentait comme un passeur de luxe, il faisait sortir uniquement deux personnes à la fois : un homme et une femme. Il constituait des faux couples qu’il faisait voyager vers la Turquie avec un passeport et un visa tourisme. Mais ses prix étaient extrêmement élevés : 3 500 dollars par personne. Il m’a donné un numéro et je l’ai gardé précieusement car j’avais une idée en tête.
Ça faisait quelques mois que je fréquentais une femme. Tigisi était éthiopienne. C’était une très belle femme aux yeux noirs et à la peau couleur émeraude*.
*Hassan a arrêté l’école très jeune. Pourtant, à plusieurs reprises, son niveau de langage interpelle Adel Al-Kordi, le traducteur. Lorsque Hassan décrit physiquement Tigisi, Adel interrompt la traduction pour raconter une anecdote. L’expression que Hassan vient d’employer en arabe pour rendre de manière poétique la beauté de la peau de Tigisi noire, il l’a entendue pour la dernière fois en 1994, quand il était étudiant à l’université de Rabat. Hassan rougit : « Je suis curieux de nature, j’apprends vite et j’ai une certaine fibre artistique », explique-t-il avant de reprendre son récit.
En Erythrée, les femmes éthiopiennes sont réputées pour leur beauté. Tigisi ne faisait pas mentir les on-dit. On s’était rencontrés dans le quartier Al-Jerif de Khartoum, où vivent les Ethiopiens et les Erythréens. Le jeudi soir, on sortait ensemble dans les bars clandestins du quartier pour boire des bières érythréennes.
Elle aimait que je lui achète des vêtements et j’adorais la voir porter les habits que je lui avais offerts. On s’entendait bien. Tout ce qui peut se passer entre un homme et une femme s’est passé entre Tigisi et moi. Je ne sais pas si c’était de l’amour, mais, avec le recul, je me dis que c’était peut-être le début d’une histoire. En tout cas elle a bouleversé ma vie, c’est certain.
Tigisi aussi cherchait désespérément à quitter le Soudan. On en parlait souvent. Elle voulait aller en Norvège pour rejoindre une partie de sa famille. Ses proches étaient prêts à lui envoyer beaucoup d’argent pour financer son voyage, alors je lui ai parlé de ma rencontre avec le passeur. Je ne lui ai pas menti, je lui ai dit que je n’avais pas d’argent, du moins pas assez. J’apportais la solution, elle apportait l’argent. Voilà le deal que je lui ai proposé.
Ç’a été très dur de la convaincre, mais un jour elle a accepté. J’ai rappelé le passeur et nous l’avons rencontré. Tigisi a versé une partie de l’argent. Plus question de faire machine arrière.
Hassan et Tigisi doivent maintenant attendre. Ils ont reçu l’interdiction formelle de se voir et de se contacter. Toutes les instructions leur seront données par téléphone. Une semaine s’écoule, puis deux. Hassan ne tient plus en place et commence à croire qu’il s’est fait rouler, lorsque, un matin, son téléphone sonne. Les passeurs lui ordonnent de se rendre dans un hôtel et lui achètent un costume pour le voyage. A l’excitation du départ se mêle l’angoisse liée aux incertitudes et à la crainte de se faire arrêter.
Où sont les billets ? Le passeport sera-t-il à mon nom ? Où est Tigisi ? Je me posais plein de questions et je n’avais aucune info, alors, deux jours avant le départ, j’ai un peu craqué nerveusement. Je me suis mis à gueuler sur l’intermédiaire qui m’apportait à manger. Quelqu’un est venu à l’hôtel pour me calmer, il a sorti un passeport de sa veste et l’a ouvert très vite. Je n’ai rien pu lire mais j’ai vu ma photo. J’ai demandé à voir mon nom, mais le gars m’a répondu : « Qu’est ce que ça peut faire, ton nom ? Ce qui importe, c’est que tu sois en Turquie dans deux jours, alors reste tranquille et arrête de poser des questions. » Toutes les indications me seraient transmises par téléphone.
A minuit, mon téléphone a sonné. Je devais me rendre à une adresse, mais aussitôt arrivé là-bas, j’ai dû changer de taxi et me diriger vers une autre destination. J’ai pris au moins quatre taxis différents avant d’arriver dans une rue où mes interlocuteurs m’observaient d’une fenêtre. Je suis sorti de la voiture et l’homme au téléphone m’a dit de monter dans un véhicule qui se trouvait sur ma droite. Tigisi m’attendait sur la banquette arrière, elle était très bien habillée. J’étais soulagé de la retrouver. On a fait route vers l’aéroport et on a reçu une dernière recommandation : quelqu’un nous attendrait à Istanbul, il viendrait nous parler et nous devrions le suivre.
Etonnamment, le voyage s’est très bien passé et, une fois à bord de l’appareil, j’étais très détendu. J’étais en costard, dans un avion long-courrier, assis près d’une belle femme, mais on est restés très silencieux. C’est quand on est arrivés et qu’il a fallu passer la police aux frontières que l’angoisse de se faire interpeller a resurgi, mais j’ai réussi à prendre sur moi, à garder mon calme et à parler correctement.
Personne ne nous a rien demandé. Ils ont tamponné nos passeports, j’ai pu récupérer mes valises et on est sorti de l’aéroport. J’étais déconcerté par la facilité avec laquelle on était arrivés en Turquie. Puis un homme qui était au téléphone et qui me tournait le dos m’a interpellé. Il m’a demandé si j’étais Hassan et nous a dit de le suivre. Tigisi m’a pris par le bras, elle craignait qu’on nous sépare et j’essayais de la rassurer comme je pouvais. Il devait être 8 heures du matin quand on est arrivés dans une maison de la banlieue d’Istanbul.
A leur arrivée, Hassan et Tigisi n’ont pas le temps de souffler, un passeur doit venir s’entretenir avec eux dans la matinée. L’homme qui se présente parle arabe et connaît leurs noms. Tigisi doit continuer son voyage vers la Norvège, Hassan, lui, n’a aucun point de chute et peu de ressources. Le passeur s’occupera donc en priorité de Tigisi, mais il propose à Hassan de rejoindre rapidement la Grèce pour 150 dollars. Seul et sans but, Hassan accepte. La séparation avec Tigisi est difficile, ils ne se reverront jamais. Depuis, Hassan a tenté de la retrouver via Facebook, en vain. Il avoue qu’il pense chaque à elle et se demande si elle va bien, si elle est parvenue à destination. Au fond de lui, Hassan a la conviction que Tigisi pense aussi à lui.
Tigisi est partie avec le passeur de son côté, puis tout s’est passé très vite. Le soir même, un intermédiaire m’a conduit dans une cave où une soixantaine de personnes étaient entassées. Une Somalienne avec qui j’ai discuté était ici depuis cinq jours. J’ai eu beaucoup de chance de n’y rester que quelques heures, les conditions étaient terribles. Vers minuit, on nous a fait sortir pour nous entasser dans des minibus : 30 personnes dans des véhicules de 8 places, on était traités comme des animaux. On a roulé quatre heures et puis le bus s’est arrêté dans une zone désertique. Le reste du trajet devait se faire à pied.
On s’arrêtait régulièrement selon les ordres des guides, il fallait s’abaisser quand on voyait les phares d’une voiture au loin. Dans notre groupe il y avait un Asiatique, un homme de grande taille qui se plaignait depuis des heures de la manière dont on était traités. Les passeurs lui ont dit de la fermer, mais il a continué à protester. L’un d’eux a alors sorti une arme automatique et a commencé à le battre à coups de crosse. C’était extrêmement violent. Personne n’a protesté. L’homme est resté à terre, il ne bougeait plus. On l’a regardé et on l’a laissé là. Il y a beaucoup de solidarité sur les routes de l’exil, mais il y a ces moments où l’homme réagit à l’instinct. Chacun veut sauver sa peau.
Le groupe de migrants continue de marcher pendant plusieurs heures avant d’arriver sur les bords de la rivière Evros. Les passeurs leur demandent de se tenir en retrait pendant qu’ils installent une corde de chaque côté de la rive et gonflent un Zodiac. Les migrants devront traverser par groupe de dix à quinze personnes. Arrivés en territoire grec, ils se remettent en route jusqu’à ce que les passeurs disparaissent dans la nuit.
Là, ç’a été la panique totale. On ne savait pas où on était, les gens étaient déboussolés. Avec des Soudanais, on a décidé de suivre un petit sentier : dix minutes plus tard, des flics sont apparus. Certains ont commencé à se cacher, mais moi j’ai décidé d’aller me présenter. J’ai été interrogé, ils m’ont demandé d’où on venait et combien de personnes avaient traversé. Ils nous ont emmenés dans un camp et on a dû faire des photos avec des numéros.
On était complètement dans le flou, on se demandait ce qui allait nous arriver, on ne comprenait rien… On nous a dit qu’on allait rester ici quelque temps puis qu’on pourrait repartir vers Athènes. Les conditions dans le camp sont indescriptibles, il n’y avait aucune humanité. Des centaines de personnes étaient entassées là, avec seulement trois toilettes. On est restés une semaine et on a été libérés, alors j’ai fait route vers Athènes. Je ne pensais pas rester longtemps en Grèce. J’étais loin d’imaginer que j’allais y passer les quatre prochaines années de ma vie.