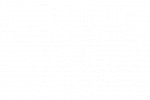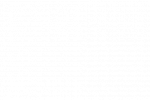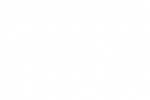Le procès de « Jungle Jabbah », une brèche dans la culture de l’impunité au Liberia
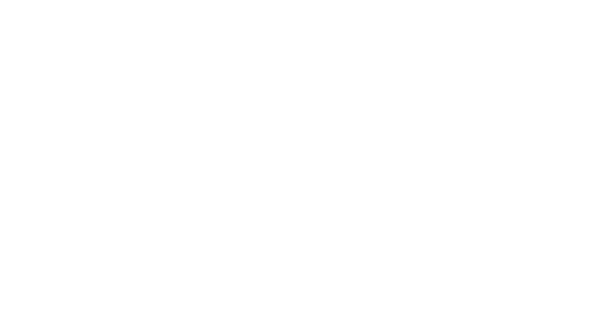
Le procès de « Jungle Jabbah », une brèche dans la culture de l’impunité au Liberia
Par Alain Werner
Le milicien Mohammed Jabateh va être jugé par un tribunal américain pour des crimes commis durant la guerre civile. Une première, se félicite l’avocat Alain Werner.
Le Liberia a connu récemment deux guerres civiles (1989-1996 puis 1999-2003) qui ont coûté la vie à au moins 150 000 personnes. En 2009, un rapport de la Truth and Reconciliation Commission (TRC, Commission vérité et réconciliation) a fait un inventaire détaillé et édifiant des crimes commis. Il met en cause des individus pour des crimes graves, allant même jusqu’à publier des listes nominatives de personnes devant être jugées au Liberia pour ces crimes de guerre.
Et pourtant, huit ans après la publication de ce rapport et le prix Nobel de la paix décerné en 2011 à Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Liberia, personne n’a été poursuivi dans le pays. La liste des candidats à l’élection présidentielle, dont le premier tour se tient le 10 octobre, donne même l’impression qu’avoir été de près ou de loin impliqué dans les guerres civiles est une condition sine qua non pour pouvoir prétendre au poste suprême.
Cinquante ans de prison
En effet, le plus notoire des criminels de guerre, Prince Yormie Johnson, sénateur de sa région depuis de nombreuses années, s’y présente pour la troisième fois consécutive. Contre lui fait campagne Benoni Urey, un ancien haut responsable de l’administration chargée du pays pendant la deuxième guerre civile qui compte parmi les hommes les plus riches du pays. Seul candidat ayant des chances de victoire et n’ayant aucun lien avec la guerre, le Ballon d’or 1993 et ancienne star du Paris-Saint-Germain, George Weah. Mais celui-ci a décidé de prendre comme colistière la sénatrice Jewel Howard Taylor, ex-femme de l’ancien président du Liberia Charles Taylor. Ce dernier, qui a commis plus de crimes de guerre dans son pays qu’il ne peut probablement s’en souvenir, ne peut pas se présenter puisqu’il a été condamné à cinquante ans de prison pour son implication dans la guerre civile qui a eu lieu dans le pays voisin, la Sierra Leone (1991-2002). Il semble cependant déterminé à peser sur les élections : il menaçait il y a encore quelques mois des politiciens libériens par téléphone de la prison de haute sécurité de Durham, au Royaume-Uni.
Cette incroyable impunité n’est pas un phénomène nouveau dans ce petit pays d’Afrique de l’Ouest de moins de 5 millions d’habitants, fondé en 1847 par des esclaves affranchis venus des Etats-Unis. Car ces derniers, depuis leur arrivée au début des années 1820, et leurs descendants ne se sont jamais montrés très humanistes avec la population indigène qu’ils appelaient « country people » ou « native people », termes qui, jusqu’à ce jour, portent une connotation négative au Liberia.
L’entre-soi des élites de Monrovia
En 1927, le président fraîchement élu, Charles D. B. King, fut accusé d’avoir autorisé l’esclavage dans son pays. De même, des membres de l’administration furent soupçonnés d’être impliqués dans l’envoi par bateau et de force de main-d’œuvre libérienne vers l’île de Fernando Poo, alors sous protectorat espagnol. Le scandale eut une telle répercussion que la Société des nations mit sur pied un comité pour examiner les faits. Ce dernier publia en 1930 un rapport connu sous le nom de Rapport Christy, d’après le nom du président du comité, le Britannique Cuthert Christy.
Le comité conclut dans son rapport que les trajets par bateau vers Fernando Poo équivalaient bel et bien à de l’esclavage, du fait des méthodes de recrutement, et nota également que des membres de l’administration libérienne avaient abusé de leur pouvoir en recrutant de la main-d’œuvre avec l’aide des forces officielles aux frontières. Le rapport épingla aussi des entreprises étrangères, constatant que des plantations, comme celle du producteur américain de caoutchouc Firestone, avaient eu recours au travail forcé.
L’impact de ce rapport fut tel au Liberia que le président King et le vice-président Yancy furent contraints de démissionner de leurs fonctions. Pour autant, personne ne fut jamais pénalement poursuivi pour les faits exposés dans le Rapport Christy.
Près de quatre-vingt-dix ans après la publication de ce rapport historique, l’entre-soi des élites de Monrovia – qui se protègent de toute poursuite pour crimes internationaux – n’a pas changé d’un iota. Et pourtant, ce n’est plus une fatalité. La société civile a su s’organiser et certaines victimes des crimes de guerre travaillent désormais avec des militants libériens courageux et professionnels afin de poursuivre des personnes suspectées d’être impliquées dans la guerre civile mais vivant à l’extérieur du Liberia.
Une quête de justice
Cette coopération porte ses fruits, et les procès auxquels les élites s’opposent si farouchement au Liberia commencent à avoir lieu à l’étranger. Le 1er octobre, à Philadelphie, a débuté le procès de Mohammed Jabateh, connu sous le nom de guerre « Jungle Jabbah ». Si ce dernier est poursuivi pour avoir menti à l’immigration américaine sur son passé militaire, c’est bel et bien les crimes qu’il aurait commis comme commandant d’une des factions rebelles pendant la guerre civile qui seront au cœur de son procès. En audience, plus d’une quinzaine de victimes confronteront « Jungle Jabbah », qui risque jusqu’à trente ans de prison. C’est la première fois que les victimes des crimes commis pendant la première guerre civile peuvent participer à une telle procédure.
D’autres procès contre d’anciens combattants libériens suspectés d’avoir commis des crimes graves lors de la guerre civile devraient se tenir en 2018, notamment au Royaume-Uni, en Suisse et en Belgique. Au centre de ces efforts de justice se trouve notamment Hassan Bility, ancien journaliste, torturé par les sbires de Charles Taylor en 2002, couronné par Amnesty International et Human Rights Watch pour son combat, et aujourd’hui directeur du Global Justice Research Project (GJRP). Ce dernier a brisé un tabou au Liberia en travaillant avec des victimes de crimes qui auraient été commis, notamment, par des anciens combattants de son propre groupe ethnique.
Le procès de « Jungle Jabbah » et cette quête libérienne de justice sont importants, non seulement pour les victimes de ce pays, mais pour leur valeur d’exemple. Ils montrent une voie possible à toutes les victimes oubliées par leurs gouvernements, par les Nations unies et la Cour pénale internationale. Cette quête de justice, qui n’était qu’illusoire pour les victimes au temps du Rapport Christy, ne l’est désormais plus aujourd’hui.
Alain Werner est avocat au barreau de Genève et directeur de l’ONG Civitas Maxima. Il a travaillé notamment comme avocat dans les procès de Charles Taylor à La Haye, de Hissène Habré à Dakar et de Kaing Guek Eav à Phnom Penh.