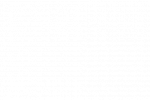A Tunis, le festival Dream City installe l’art contemporain au cœur de la médina

A Tunis, le festival Dream City installe l’art contemporain au cœur de la médina
Par Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
Pour la cinquième édition de la biennale, l’artiste Nidhal Chamekh a encagé la Porte de la mer pour dénoncer l’obsession sécuritaire dans les villes.
De loin, l’arc de marbre et de granit semble gainé d’une membrane transparente, grisée, légère comme une mousseline. De près, la texture du voile se fait plus âpre, écrue, et l’on découvre que les fils tissant l’enveloppe sont de fer, barbelé, blessant le regard qui glisse ainsi de la soie à l’épine. Dès lors, le doute n’est plus permis : Bab Al-Bhar (la Porte de la mer), dressée à l’entrée orientale de la médina de Tunis, est bien encagée, incarcérée même.
Là est la protestation de Nidhal Chamekh, artiste plasticien vivant entre Paris et Tunis, qui alerte sur la clôture des cités, cisaillées de barrières, hachées de chevaux de frise en ce nouvel âge de peurs collectives. Ces frontières qui opacifient jusqu’au cœur des cités, Nidhal Chamekh, né en 1985, formé aux beaux-arts de Tunis, ne les admet pas.
Un puissant symbole
Son œuvre a été l’une des plus remarquées de Dream City, le festival d’art contemporain qui a semé l’audace, du 4 au 8 octobre, dans le labyrinthe de la vieille ville de Tunis. Embastiller Bab Al-Bhar, c’était assurément s’affronter à un puissant symbole. Le portique monumental a historiquement marqué la limite entre la médina et la mer, avant de séparer la cité autochtone de la ville coloniale. Et il y a ce changement de nom – la Porte de la mer avait été rebaptisée Porte de France sous le protectorat – qui en dit long sur l’imaginaire imposé par les maîtres d’alors. Nidhal Chamekh ne pouvait rêver de meilleure allégorie et il l’a torsadée à souhait.
« J’ai voulu amplifier ce qui existe déjà dans l’espace tunisien », dit-il. Grand, plutôt frêle, œil noir étoilé de tendresse pour son monde, Nidhal Chamekh est assis dans une salle de Dar Bash Hamba, demeure palatiale où siège l’association l’Art Rue dont le couple fondateur, les danseurs et chorégraphes Sofiane et Selma Ouissi, ont créé Dream City il y a une décennie. Tunis n’est certes pas Kaboul, tant s’en faut, mais les barbelés ou les guérites de gardes armés cadenassent le seuil de l’ambassade de France, du ministère de l’intérieur, de la radio nationale, de l’ambassade de Libye…
« Au début, juste après la révolution, cela gênait beaucoup les gens, se souvient Nidhal Chamekh. Puis ces barrières sont entrées dans la normalité des choses ». « Je veux questionner cette normalité en la poussant à son extrême », ajoute-t-il. Et s’il y a urgence à ne pas s’y complaire, c’est que ces nouvelles frontières subvertissent un rêve qui eut sa noblesse. « Ce qu’il y a eu de remarquable en 2011 [pendant la révolution], c’est que la population s’était réapproprié l’espace urbain, souligne-t-il. Or cet espace public n’est aujourd’hui plus tant public que cela. »
« Mettre la ville en mouvement »
Questionner les frontières donc, celles qui barrent les boulevards ou les rivages, mais Nidhal Chamekh ne veut administrer aucun magistère. Il mêle le public à son exploration, l’invite à ajouter à la performance. Ainsi a-t-il ouvert, à proximité de Bab Al-Bhar, une sorte de cabinet de curiosités sous les arcades décrépites du fondouk (hôtel) des Français, vestige d’un caravansérail qui connût son heure de gloire au XVIIe siècle. Il a demandé aux Tunisois de lui prêter, le temps de l’événement, des objets qui symbolisent à leurs yeux la frontière, la limite, les confins. La collection improvisée est troublante. S’empilent sur les étagères un globe, une horloge, des menottes, des timbres, des billets de banque, un livre d’astronomie, un drapeau américain, un keffieh palestinien ou une cage d’oiseau.
C’est là un peu l’esprit de Dream City, biennale atypique qui creuse sa venelle avec pour folle ambition de « mettre la ville en mouvement » en plaçant les artistes (originaires de dix pays) « en dialogue intense avec ses citoyens », selon la formule de Jan Goossens, directeur artistique de cette cinquième édition. Dream City veut résolument tenir les deux bouts. Etre à la fois « pointu et populaire », « très ancré dans la médina et radicalement ouvert sur le monde », ajoute M. Goossens.
Etre à la fois ludique, tel l’acrobate tout de sangles ligoté qui arpente à la verticale la façade du palais Kheiredinne, et clinicien des failles du monde, auscultant les mémoires meurtries ou en déshérence : l’expérience de la prison, la marginalité homosexuelle, l’errance migratoire, la jeunesse dépossédée ou l’agonie des métiers traditionnels. C’est cette exigence qui a séduit Nidhal Chamekh, au départ assez sceptique sur le projet. « Quand Sofiane Ouissi [directeur de l’Art Rue] m’a invité, le lieu – la médina – a d’abord suscité chez moi la réticence : j’avais peur du folklorisme, voire du néo-orientalisme ». Il n’a finalement pas hésité longtemps.