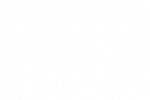Du danger de (trop) s’indigner en ligne

Du danger de (trop) s’indigner en ligne
Par Luc Vinogradoff
Et si notre capacité à vraiment s’indigner, à distinguer la tragédie de la simple nuisance se diluait à force d’être irrité quotidiennement par le contenu dans nos flux ?
Les cycles d’indignation sur les réseaux ne durent jamais très longtemps. Un sujet provoquant l’irritation d’un certain nombre d’utilisateurs émerge et devient le centre d’une conversation plus large, alimentée par des reprises médiatiques. Puis il s’essouffle, descend de quelques crans sur la liste des trending topics, et est vite remplacé par le suivant.
L’indignation de leurs utilisateurs est un des carburants qui font tourner Twitter ou Facebook. Elle est recherchée et encouragée par ces multinationales car elle est au cœur même du fonctionnement des plates-formes qu’elles ont créées. Le contenu à fort quotient émotionnel génère le plus de likes, de commentaires, de partages – une des émotions qui rapportent le plus est la colère. Pour que ces services, que nous utilisons gratuitement, soient rentables, ces entreprises ont besoin de toujours plus de trafic, donc de revenus publicitaires. Elles ont intérêt à ce qu’on y reste le plus longtemps possible.
C’est une réalité qu’on a trop tendance à oublier lorsqu’on traite de polémiques nées sur les réseaux sociaux. Molly Crockett, professeure adjointe de psychologie à l’université Yale (Connecticut), le rappelle justement dans « Indignation morale à l’ère digitale », une étude qui s’intéresse « à la façon dont la technologie peut transformer l’expression de l’indignation morale et ses conséquences sociales ».
« Si l’indignation est un incendie, Internet serait-il de l’essence ? »
L’hypothèse émise par Molly Crockett, qui s’appuie sur de précédentes études et sur ses propres recherches, a forcément déjà été effleurée par celles et ceux qui ont un usage un peu trop intensif des réseaux sociaux : ces écosystèmes « exacerbent la façon dont on exprime l’indignation, en gonflant les stimulus déclencheurs, en réduisant son coût et en amplifiant les bénéfices personnels que l’on en tire ».
Rien de plus facile que de rejoindre en quelques clics une cohorte numérique qui crie son mécontentement, surtout si le hashtag, la vidéo ou la personne qui suscite le mécontentement apparaît sans cesse dans notre flux, partagé par nos amis et automatiquement mis en avant par les algorithmes. Ou, comme le formule une comparaison de l’étude particulièrement bien trouvée :
« Si l’indignation est un incendie, Internet serait-il de l’essence ? »
Dans les espaces sociaux d’Internet, l’expression de l’indignation relève parfois du réflexe, de par l’architecture même de ces espaces, et pour d’autres raisons qui en découlent et que la chercheuse résume ainsi : « Exprimer son indignation n’est pas limité par l’endroit où on se trouve, par l’heure ou la probabilité d’être confronté à la source de notre indignation. »
« Diffuser notre réprobation morale à des personnes qui partagent nos valeurs nous permet de nous cacher dans la foule. Moquer un inconnu dans la rue est bien plus risqué que de rejoindre une foule de plusieurs milliers de comptes Twitter. »
Dans un environnement comme Facebook ou Twitter, chacun a une compensation émotionnelle en échange du partage de son indignation, explique Molly Crockett, qui parle de « récompense réputationnelle », ce retour, sous la forme de likes, de cœurs ou de retweets, pour avoir « fait la publicité de notre caractère à notre réseau social ». Dans ce jeu, ce serait la carotte. Le bâton, en revanche, pourrait potentiellement faire plus de dommages.
Si notre capacité d’indignation s’est à ce point banalisée, sa valeur ne peut que se diluer. A force de s’indigner systématiquement, on ne s’indigne plus vraiment de rien. « Exactement comme quelqu’un qui grignote sans cesse sans même avoir faim, écrit Molly Crockett. Celui qui a pris l’habitude de s’indigner en ligne va le faire sans vraiment se sentir indigné. »
Pis encore, « en abaissant le seuil de l’indignation, les réseaux sociaux, mais aussi les médias numériques risquent de dégrader notre capacité à distinguer entre l’abominable et le désagréable ». A trop passer de temps dans nos flux, une tragédie humanitaire qui se déroule à des milliers de kilomètres, la dernière déclaration politique débile diffusée par les matinales de radio ou un hashtag de cour de récréation se succèdent et finissent par se confondre.
Catharsis dans l’agora numérique
Evitons quand même de tomber dans le piège de dire que l’écosystème qui s’est construit autour des réseaux sociaux ne serait qu’un espace creux de sentiments désincarnés. Les indignations omniprésentes qui y circulent sont parfois canalisées et aboutissent à des actions concrètes et structurées, servent à mettre en contact des personnes éloignées qui organisent des pétitions à succès, des manifestations.
Le dernier mouvement qui est apparu, massif et organique, est incarné en France par le hashtag #balancetonporc avec lequel des milliers de femmes ont partagé sur Twitter leurs expériences d’agression ou de harcèlement sexuels. A moins d’une semaine d’existence, on ne peut pas encore dire s’il restera une explosion cathartique de victimes tentant de se libérer d’un poids trop longtemps enfoui, ou s’il aboutira à des avancées tangibles pour lutter contre le harcèlement et les violences envers les femmes.
Il n’est pas surprenant que cette prise de parole collective ait pu naître et essaimer sur les réseaux, mais comme le dit le chercheur Olivier Ertzscheid sur Rue89, « ce serait une catastrophe que ces débats commencent et terminent sur Twitter ou sur Facebook. Comme ce serait une catastrophe de croire que ces plates-formes protégeront ». Si ces espaces deviennent des agoras numériques où des problèmes de société émergent et débordent jusque dans la « vie réelle », c’est qu’ils remplissent un vide laissé par les pouvoir publics et les médias.
Pour Twitter et Facebook, #balancetonporc n’est qu’un hashtag parmi d’autres, intéressant uniquement dans la mesure où il rapporte du trafic. Olivier Ertzscheid rappelle, lui aussi, une vérité qu’on oublie trop souvent :
« Il n’y a pour ces plates-formes ni victimes ni bourreaux, ni opprimés ni oppresseurs, seulement des usagers et des clients. »