Au Kenya, une présidentielle bis dans un climat d’incertitude
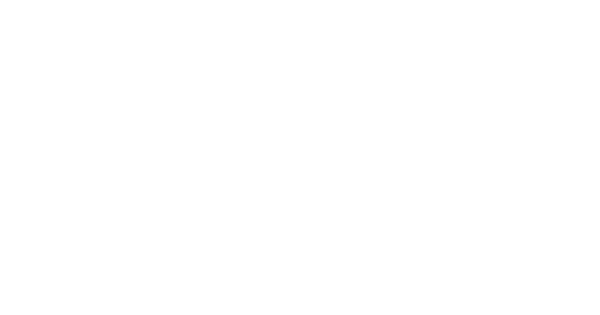
Au Kenya, une présidentielle bis dans un climat d’incertitude
Par Bruno Meyerfeld (Nairobi, envoyé spécial)
Après l’annulation par la Cour suprême du scrutin du 8 août, une nouvelle élection est organisée le 26 octobre en plein chaos institutionnel.
Rassemblement des supporters de Uhuru Kenyatta, le président sortant, à Nairobi (Kenya), le 23 octobre 2017. / BAZ RATNER / REUTERS
« C’est une énorme opportunité manquée ! », se désole Patrick Gathara, célèbre caricaturiste kényan et fin observateur de la vie politique de son pays. Alors que doit se tenir, le 26 octobre, un nouveau scrutin présidentiel faisant suite à l’annulation par la Cour suprême de l’élection du 8 août, remportée par le président sortant Uhuru Kenyatta, le moral est au plus bas. « Ce jugement était une chance historique pour remettre notre démocratie sur pied. Il a été gâché par des politiciens obsédés par leurs intérêts personnels et incapables de se comporter en hommes d’Etat », tranche Patrick Gathara.
Après deux mois de chaos politique et institutionnel, le Kenya est à bout de souffle. Et nul ne sait précisément dans quelles conditions sera organisé le scrutin de jeudi. La Commission électorale (IEBC), chargée d’organiser l’élection, minée par des luttes internes et cible de toutes les critiques, a perdu la semaine dernière son directeur exécutif, parti subitement en congé, et l’une de ses sept commissaires, enfuie aux Etats-Unis. « Dans de telles conditions, il est difficile de garantir une élection libre, équitable et crédible »? a lui-même reconnu le président de l’institution, Wafula Chebukati. Un aveu d’échec.
Poker menteur
Mais la Constitution kényane, qui stipule qu’un nouveau scrutin doit avoir lieu avant le 1er novembre, n’a laissé que peu de marge de manœuvre à une commission en pleine dérive. Pour ne rien arranger, depuis deux mois, le président Kenyatta et le chef de l’opposition, Raila Odinga ont joué au poker menteur, cachant leur jeu dans un Kenya transformé en fragile château de cartes. D’un côté, un chef de l’Etat à bout de nerfs, menaçant les juges et se disant prêt à changer à tout moment la loi électorale. De l’autre, un opposant ambigu, ne dévoilant pas la marche à suivre, affirmant boycotter le scrutin mais sans jamais formaliser officiellement son retrait auprès de l’IEBC.
Entre les deux camps, les ponts semblent donc rompus. « Kenyatta n’a ni la culture ni le passé d’un démocrate !, tonne Salim Lone, l’un des principaux conseillers de M. Odinga. Son père, Jomo Kenyatta [au pouvoir de 1963 à 1978] était un autocrate pratiquant une présidence impériale. Uhuru a grandi dans un environnement où le chef faisait la loi tout seul. Il est prêt à transformer le Kenya en Etat à parti unique. »
Faut-il craindre un retour des violences et des émeutes ? Au mois d’août, celles-ci auraient fait jusqu’à 67 morts. « Il y a des aspects encourageants. Depuis deux mois, on n’a pas eu d’explosion comme en 2007 [où les affrontements postélectoraux firent 1 200 victimes] », tente de se rassurer Murithi Mutiga, chercheur à l’International Crisis Group.
La démocratie kényane marche donc à l’aveuglette, son sort dépendant de la bonne – ou mauvaise – volonté de ses dirigeants. « Le discours d’Odinga fixant la marche à suivre [prévu pour la veille du scrutin] sera déterminant, ajoute M. Mutiga. S’il appelle à un simple boycott, on pourra éviter un bain de sang. Mais s’il ordonne à ses supporteurs de se confronter à la police et de bloquer les bureaux de vote, tout pourrait dégénérer. »







