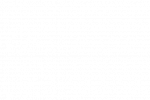« La violence fait partie de l’ADN politique du Kenya »

« La violence fait partie de l’ADN politique du Kenya »
Propos recueillis par Bruno Meyerfeld (Nairobi, envoyé spécial)
Pour l’historien David Anderson, l’élection présidentielle, qui s’est déroulée dans la plus grande confusion, révèle l’échec du rêve démocratique kényan.
Un nouveau scrutin présidentiel s’est tenu au Kenya jeudi 26 octobre. Mais le vote s’est déroulé dans la plus grande confusion, entre boycott, bureaux de vote fermés, participation en chute libre, affrontements entre policiers et manifestants et craintes de violences ethniques.
Historien et professeur à l’université de Warwick, David Anderson est l’un des meilleurs connaisseurs du Kenya moderne. Il est notamment l’auteur de Histories of the Hanged (Weidenfeld & Nicholson, 2005, non traduit), ouvrage de référence sur l’insurrection des Mau Mau. Il revient sur les causes profondes de la crise kényane.
Que vous inspire cette nouvelle élection ?
David Anderson On le voit très clairement dans les événements de ces derniers mois : la démocratie kényane est profondément défectueuse. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, la crise à laquelle fait face le Kenya aujourd’hui n’est pas qu’une crise institutionnelle ou politique. C’est une crise existentielle, qui atteint la nation dans ses fondements. Elle est le résultat de trois décennies de frustrations face à un système démocratique qui n’a pas tenu ses promesses. Vingt-cinq ans après les premières élections multipartites de 1992 et sept ans après l’introduction de la nouvelle Constitution, je crois qu’on peut dire que le rêve démocratique kényan a échoué. Peut-être même est-il mortellement blessé…
C’est un constat très dur…
Oui. Certes, il existe une société civile active et des institutions plus ou moins indépendantes, comme la Cour suprême. Mais regardez l’état du système démocratique et surtout les hommes politiques qu’il a produits. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga sont des leaders sans idéologie, sans programme, sans vision de long terme pour leur pays. Au-delà de la lutte historique de pouvoir entre leurs deux tribus [Kikuyu pour Kenyatta et Luo pour Odinga], aucun d’eux ne souhaite réellement s’attaquer aux problèmes de fond du Kenya. Pendant cette campagne, ni Kenyatta ni Odinga n’ont articulé une vision claire pour l’avenir de la nation.
Au Kenya, malheureusement, on entre aujourd’hui en politique pour faire de l’argent et non pour changer la vie. Le pays reste l’un des plus corrompus au monde et les parlementaires sont parmi les mieux payés de la planète. Les Kényans voient la politique comme un monde de peur et de suspicion. Résultat : aux niveaux local et national, le système repose sur le clientélisme. Les électeurs votent non pas pour des idées, mais pour des politiques dont ils souhaitent qu’ils protègent leurs intérêts contre ceux des autres. Une fois au pouvoir, vous remerciez ceux qui vous ont élu. Et c’est tout.
Vous dites que cette crise « atteint la nation dans ses fondements ». Pourquoi ?
Ces élections l’ont démontré : le Kenya, aujourd’hui, est un pays incroyablement et tragiquement divisé. Le 26 octobre, une large partie de la population, peut-être la moitié, n’est pas allée voter. Ce Kenya-là ne se sent pas représenté par l’Etat. Il voit le gouvernement non pas comme un serviteur mais comme une menace, une force dangereuse, corrompue, absolument pas fiable.
Si on regarde la réalité en face, il n’y a guère que les classes moyennes à Nairobi qui se sentent réellement « kényanes ». Elles seules épousent les principes démocratiques mis en avant par la Constitution et font preuve d’un réel patriotisme. Mais elles sont terriblement isolées. Il suffit d’aller dans les marges du pays pour s’en rendre compte : dans les régions éloignées, déshéritées et négligées du Nord-Est somali ou du Turkana, sur la côte musulmane ou sur les terres des Luo dans l’ouest, on ne se sent pas kényan. Et on n’est pas ou peu allé voter le 26 octobre.
Plus d’un demi-siècle après l’indépendance, les tensions entre les nombreuses communautés du pays sont toujours aussi fortes. Comment l’expliquez-vous ?
Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Sous le gouvernement du premier président du pays, Jomo Kenyatta [père d’Uhuru Kenyatta], entre 1963 et 1978, le pouvoir était tenu d’une main de fer par l’élite kikuyu. Mais le « père de la nation » souhaitait malgré tout créer un consensus politique national et évitait de recourir aux violences ethniques. Tout le contraire de son successeur, Daniel arap Moi, au pouvoir de 1978 à 2002.
Afin de se maintenir au pouvoir, Daniel arap Moi a ethnicisé à l’extrême la vie politique kényane. A partir du début des années 1990 et la fin de la guerre froide, cet autocrate a dû laisser un peu d’espace démocratique et accepter d’organiser des premières élections multipartites. Afin de remporter les scrutins de 1992 et 1997, il a décidé de chasser ses rivaux du Rift, sa terre natale, en envoyant ses milices à l’assaut des opposants de la région. Le tout a provoqué un terrible nettoyage ethnique pendant une décennie, avec des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.
Plus grave encore : cette politique destructrice a monté les communautés kényanes les unes contre les autres et fragmenté la vie politique nationale en groupes ethniques. Chacun s’est replié sur sa tribu pour se défendre contre un Etat dangereux et meurtrier. Le Kenya n’a jamais réussi à se remettre cette ère de terreur et de violence, les responsables de ces crimes n’ont jamais été jugés ou punis, les victimes n’ont jamais été compensées. Et le Kenya vit encore dans l’ombre de cette sinistre dictature.
Le Kenya est toujours présenté comme un îlot de stabilité dans une région est-africaine en proie à la guerre et à la violence. Est-ce un mythe ?
Tout à fait. Contrairement au cliché survendu par les alliés américain et européens de Nairobi, la violence fait partie de l’ADN politique du Kenya. On fait semblant de le redécouvrir à chaque élection. Mais cela remonte à bien plus loin, et d’abord à la colonisation britannique, qui a été d’une violence effroyable, qui a militarisé l’administration et qui fut responsable de crimes de masse dans les années 1950 lors de l’insurrection des Mau Mau [qui aurait fait entre 150 000 et 300 000 morts].
Mais après l’indépendance, la violence n’a pas disparu. Au contraire : la liste des atrocités commises au Kenya depuis 1963 est interminable. On pourrait citer la sanglante mais oubliée guerre des Shifta [1963-1967] contre les sécessionnistes somali ; l’assassinat de nombreux leaders politiques ; la torture de milliers d’opposants sous Daniel arap Moi ; le meurtre, depuis l’attentat du Westgate, en 2013, de leaders musulmans soupçonnés de proximité avec les chabab ; le grand nettoyage ethnique du Rift, dont je vous ai déjà parlé ; et bien sûr, les violences post-électorales de 2007-2008, qui firent près de 1 200 morts et 600 000 déplacés. Il faut se rendre à l’évidence : le Kenya est un pays de violence. Et il est grand temps de reconsidérer radicalement notre vision de ce pays.