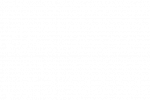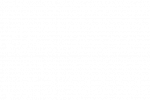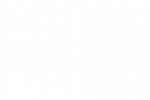Sida : l’autotest, un moyen de dépistage pratique mais encore mal connu

Sida : l’autotest, un moyen de dépistage pratique mais encore mal connu
Par Faustine Vincent
Lancé fin 2015, l’autotest VIH, disponible en pharmacie, ciblait les séropositifs qui s’ignorent. Mais les études manquent pour savoir s’il a atteint son objectif.
En France, 30 000 personnes sont séropositives sans le savoir, soit 20 % des porteurs du virus du sida. Lancé en septembre 2015, l’autotest VIH a été conçu pour atteindre ces malades qui s’ignorent, parmi lesquels 40 % d’homosexuels, 40 % de migrants d’Afrique subsaharienne et 20 % d’hétérosexuels ayant des pratiques à risque. A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, vendredi 1er décembre, l’agence sanitaire Santé publique France rappelle qu’identifier ces personnes est un « objectif majeur de santé publique », car elles « ne bénéficient pas des traitements efficaces, et peuvent être à l’origine de nouvelles contaminations sans le savoir ». Environ 6 000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année en France, dont 27 % à un stade avancé de l’infection.
L’autotest s’adresse en priorité à ceux qui ne veulent pas se rendre dans les centres de dépistage ou chez le médecin, de crainte d’être stigmatisé ou d’avoir à répondre à des questions sur leur sexualité, et à ceux qui sont géographiquement trop éloignés de ces centres. Il permet de se dépister soi-même où l’on veut, quand on veut, à l’aide d’une microgoutte de sang, et d’obtenir un résultat un quart d’heure après (fiable trois mois après le rapport sexuel).
Disponible en vente libre en pharmacie à un prix variant de 20 à 30 euros, l’autotest est venu s’ajouter à la palette déjà fournie d’outils de dépistage : test remboursé sur ordonnance en laboratoire d’analyses médicales, test gratuit et anonyme dans les centres de dépistage, et celui que proposent les associations, qui peuvent également distribuer l’autotest gratuitement.
Impossible de savoir s’il a atteint sa cible
Deux ans après sa commercialisation, il est pourtant trop tôt pour savoir si l’autotest a atteint sa cible. « On ne sait pas encore si cela a permis de réduire le nombre de séropositifs qui s’ignorent, reconnaît Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon, à Paris, et membre du comité de suivi de l’autotest. Si on ne les touche pas, on aura perdu notre pari, mais pour l’heure on est confiant. »
Une étude qualitative approfondie sur l’autotest, baptisée « V3T » et portant sur un panel initial de 4 800 personnes, a été lancée en octobre 2016 par l’ANRS, l’agence française de recherches sur le VIH-Sida. Elle doit s’achever en décembre, mais relève déjà que la moitié des personnes interrogées déclarent ne pas avoir fait de test de dépistage lors des douze derniers mois, et que 17 % n’en ont jamais fait.
A défaut d’en savoir davantage, pour l’heure, sur le profil des usagers, cette étude permet en tout cas de lister les avantages et les limites de l’autotest. « Les gens plébiscitent l’aspect pratique, rapide et confidentiel, explique Tim Greacen, directeur du laboratoire de recherche de l’établissement public de santé Maison blanche, à Paris, et coordinateur de l’enquête. Il est probable qu’un certain nombre d’usagers soient des personnes habitant à la campagne avec une vie sexuelle cachée. »
Les données manquent également pour savoir si des usagers ont découvert leur séropositivité seuls chez eux, ce qui était la crainte majeure des opposants à l’autotest avant son lancement. Le numéro de Sida Info Service a été inscrit en gros sur la notice pour assurer un suivi si besoin. En deux ans, la hotline a enregistré 5 000 appels liés à l’autotest, dont 75 % d’hommes, en priorité pour des questions sur les risques de transmission du VIH.
Un tarif « rédhibitoire »
L’autotest, non remboursé par la Sécurité sociale, est en revanche jugé bien trop cher. « Il est inabordable pour les jeunes et les migrants originaires d’Afrique subsaharienne, souvent en situation de grande précarité », selon Tim Greacen, qui plaide pour qu’il passe à « moins de 10 euros », sous peine de rater une partie de sa cible.
La même critique revient dans les dizaines de témoignages reçus par Le Monde. fr. « Le prix de 25 euros en pharmacie est rédhibitoire, assure Lucas, lycéen en Auvergne. Une prise en charge devrait être envisagée pour encourager les personnes qui n’osent aller en centre à se dépister malgré tout ! » Cassandre, 21 ans, a finalement opté pour un dépistage en laboratoire plutôt qu’un autotest car « étant étudiante, [elle] n’aurait pas eu les moyens de [s]’en procurer un ».
Le fabricant du test, la société AAZ, a engagé des discussions avec les mutuelles pour qu’il soit remboursé. A ce jour, six d’entre elles le prennent en charge, dont deux mutuelles étudiantes (Smeno et MGEL). Encore faut-il en avoir une, ce qui n’est pas le cas des populations les plus vulnérables, en particulier les migrants d’origine subsaharienne, pourtant très exposés au virus.
Malgré cela, les chiffres de ventes sont plutôt encourageants. En 2016, 74 651 autotests ont été vendus en pharmacie, et le chiffre devrait atteindre 90 000 en 2017. Ce moyen de dépistage est encore marginal par rapport aux 5,4 millions de sérologies VIH réalisées en laboratoire de biologie médicale en 2016, mais il a dépassé les dépistages réalisés par les structures associatives (56 300 la même année). Joseph Couloc’h, président de la société AAZ, précise que l’autotest a été « davantage vendu dans les officines en ville qu’à la campagne ».
« Autour de moi, personne ne connaissait »
Aujourd’hui, une pharmacie sur deux en vend. A en croire les témoignages que nous avons reçus, l’autotest semble pourtant difficile à se procurer. « Aucune des pharmacies de ma ville de banlieue n’en disposait. J’ai dû commander sur Internet. Donc côté accessibilité c’est pas le top », témoigne Guy, un habitant de l’Essonne, soulagé d’avoir échappé aux « questionnements et conseils du médecin traitant sur [sa] vie sexuelle ».
Elise, qui vit elle aussi en banlieue parisienne, a quant à elle découvert l’existence de l’autotest lors d’une nuit d’angoisse, en cherchant sur Internet l’adresse d’un centre de dépistage. Elle s’étonne : « Cela semble être un tabou, il faut chercher longtemps avant d’avoir l’info ou une pharmacie qui en a. Autour de moi, personne ne connaissait ces tests et cette possibilité. »
C’est tout l’enjeu de la campagne lancée par le ministère de la santé et l’agence Santé publique France : mieux faire connaître les différents outils de dépistage afin de soigner les malades, et éviter les nouvelles contaminations.