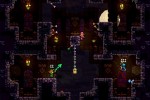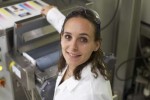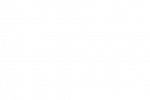« Free to play », « games as a service »… Comprendre les modèles économiques du jeu vidéo

« Free to play », « games as a service »… Comprendre les modèles économiques du jeu vidéo
Par William Audureau
Avec l’explosion du dématérialisé, l’industrie s’est lancée dans d’innombrables expérimentations, tranchant avec le vieux modèle de l’achat unitaire. Tour d’horizon.
Qu’il est loin, le temps où un jeu coûtait soixante euros et appartenait une bonne fois pour toutes à son acquéreur. Avec l’explosion du jeu sur smartphone, de l’e-sport, du dématérialisé et l’envolée des coûts, les éditeurs tentent de diversifier leurs modèles économiques. Parfois avec fracas, à l’image de la récente polémique sur les coffres aléatoires payants intégrés à Star Wars Battlefront 2. Le plus souvent avec succès, si l’on en croit le succès colossal de Clash of Clans, un jeu en téléchargement gratuit, ou la hausse des nouvelles formes de revenus dans les comptes d’Ubisoft, Activision ou encore Electronic Arts.
Les modèles traditionnels
- La vente unitaire
C’est le bon vieil achat à l’unité, soit d’un jeu en boîte, soit de sa version dématérialisée, sur le store d’un constructeur de consoles ou d’un distributeur. Traditionnellement, il donne à l’acquéreur la propriété du jeu, et aucun frais supplémentaire n’est demandé. On parle également aujourd’hui de modèle premium. Il est sur le déclin.
Pour une quarantaine d’euros, l’acquéreur de « Pokémon Ultra Soleil » est possesseur de son exemplaire du jeu, dont le contenu est complet. / Nintendo
- L’achat à l’acte
Héritage de l’âge d’or du flipper, ce modèle consiste à payer à la partie – le fameux « insérez une pièce », ou insert a coin en anglais. Une solution pratique pour des équipements volumineux et coûteux, comme l’étaient les bornes de jeux vidéo d’arcade, et qui perdure aujourd’hui dans les installations foraines. Une variante s’est développée récemment pour essayer des casques de réalité virtuelle dans des salles spécialisées. Cela reste un modèle très marginal.
Les premiers modèles nés avec Internet
- L’abonnement
Avec le jeu vidéo en ligne s’est développé une nouvelle forme de pratique, impliquant plus d’interactions humaines. Dans les MMORPG notamment, comme World of Warcraft, des millions de joueurs arpentent chaque mois le territoire d’Azeroth. Une vie parallèle permise par des serveurs entretenus depuis plus d’une décennie et financée par un abonnement mensuel d’une dizaine d’euros. Depuis peu, des éditeurs comme Electronic Arts ou des consoliers comme Sony et Microsoft proposent à leur tour des services similaires, comme EA Pass, PlayStation Now ou Xbox Pass, à ceci près qu’ils donnent accès non pas à un jeu, mais à un catalogue, sur le modèle de Netflix.
« World of Warcraft » a popularisé le modèle de l’abonnement dans les années 2000. Aujourd’hui, il est repris pour des services inspirés de Netflix. / Blizzard
- Les extensions payantes
Qui veut du rab ? Parfois sous forme physique, le plus souvent en dématérialisé, l’industrie s’est mise à proposer à partir de la fin des années 2000 des downloadable contents (ou DLC), du contenu téléchargeable comme des nouveaux chapitres ou de nouveaux niveaux. Généralement payants, ils permettent au joueur de prolonger son aventure dans le jeu tout en permettant à l’éditeur d’amortir les coûts de développement : ce contenu additionnel reprend, en effet, de nombreux éléments déjà créés (moteur de jeu, personnages, animations, etc.), ce qui le rend moins coûteux à produire.
Un « season pass » permet de préacheter les futures extensions payantes d’un jeu. Les blockbusters en sont friands. / Activision
En 2008, GTA IV en proposait deux, avec The Ballad of Gay Tony et The Lost & Damned. Aujourd’hui, la plupart des blockbusters comme Call of Duty, Far Cry ou Assassin’s Creed en prévoient plusieurs, que les joueurs peuvent même acheter par avance, grâce à un season pass, un droit d’accès au contenu additionnel prévu.
- Les jeux vidéo épisodiques
Proches cousin des DLC, dont ils sont contemporains, les jeux vidéo par épisodes fonctionnent sur le modèle de séries télévisées : approche narrative, grammaire cinématographique et cliffhanger en fin d’épisode. Ceux-ci sont courts, rarement plus de deux heures de jeu, et forment en général une saison complète au bout de cinq chapitres, achetables indépendamment (15-20 euros en moyenne) ou conjointement (souvent au prix d’un jeu classique, 60 euros). La révélation française de l’année 2015, Life is Strange, repose sur ce modèle.
Les modèles récents issus du smartphone et du PC
- Le freemium
C’est la contraction de free et de premium. Ce modèle, théorisé dans la seconde partie des années 2000 et très populaire sur smartphones, consiste à proposer en accès libre une partie tronquée d’un jeu vidéo, afin d’allécher le consommateur et lui donner envie, par un dosage subtil de la frustration, de débloquer l’expérience entière. En 2015, le jeu Super Mario Run, dont la partie gratuite s’arrête brutalement au bout de trois niveaux, en a été un exemple parfait.
- Le free-to-play (F2P)
Devenu incontournable sur smartphones, il a porté le succès planétaire de jeux comme Temple Run, Candy Crush Saga et Clash of Clans. Contrairement au jeu freemium, le jeu free-to-play (ou F2P) ne restreint pas l’expérience du joueur, qui peut profiter (quasiment) à volonté du jeu téléchargé. C’est sur des revenus indirects que se rémunère l’éditeur. Ceux-ci peuvent provenir d’annonceurs (placement produit, publicité intégrée, voire financement du développement, dans le cas d’un jeu publicitaire, ou advergame).
Ils peuvent également venir des joueurs eux-mêmes, soit par l’achat d’objets virtuels cosmétiques, les skins, qui permettent de personnaliser son avatar, soit par l’acquisition de crédits, pour rejouer plus vite, ou encore d’objets virtuels donnant un avantage dans un jeu compétitif (on parle alors de pay to win – modèle particulièrement critiqué des joueurs).
Plus récemment sont apparus des packs d’objets payants au contenu aléatoire, sur le modèle des cartes à jouer (d’ailleurs repris dans Hearthstone, ou par extension), baptisés « loot boxes ». Certains utilisateurs, surnommés « baleines » (ou whales), sont capables de dépenser plusieurs dizaines de milliers d’euros dans un jeu.
Candy Crush Saga est entièrement gratuit, mais il est possible d’investir dans des objets virtuels facilitant les parties. / King
La nouvelle approche, le « games as a service »
Dernier-né, le « jeu en tant que service » ressemble à une synthèse protéiforme de ces différents modèles. Porté par les gros éditeurs comme Activision, Electronic Arts ou encore Ubisoft, il consiste à marier le principe de la vente unitaire (le jeu est payant, souvent 60 euros, voire plus s’il intègre le season pass ou des contenus optionnels) et celui du free-to-play (il cumule de nombreuses formes de revenus supplémentaires, qu’il lui emprunte, comme les skins, les loot boxes, ou le placement produit).
Dans « Overwatch », les coffres à butin permettent, moyennant argent, de s’offrir de nouvelles tenues vestimentaires. / Overwatch
La critique adressée à Star Wars : Battlefront II, celle d’être un jeu payant intégrant des options de monétisation optionnelle, correspond ainsi à un modèle récent généralisé à de nombreux jeux récents, le plus souvent des superproductions (Overwatch, Destiny 2, L’Ombre de la guerre, Forza Motorsport 7, FIFA 18, etc.). Il s’explique autant par le succès colossal de certains jeux en F2P, comme League of Legends, que par la nécessité pour les géants du jeu vidéo de pérenniser des développements de plusieurs dizaines de milliers, voire millions d’euros.
Le « games as a service » est par ailleurs souvent associé à une modification du statut juridique du jeu vidéo. Celui-ci n’appartient plus au joueur, qui paye, en réalité, un droit d’accès à un service. C’est, par exemple, le cas de Rocket League, si l’on se réfère à ses conditions d’utilisation. Grâce notamment à des services dans le cloud, l’éditeur se réserve le droit de modifier à sa guise le programme – le plus souvent pour changer l’équilibrage de la difficulté ou l’enrichir en contenu, y compris payant, voire pour y ajouter des nouveaux modes, et maintenir son intérêt sur le long terme.
Nouveau mode Jeux olympiques, nouvelles pistes, nouveaux équipements optionnels sous licence... Le jeu de glisse « Steep », d’Ubisoft, continue de s’enrichir. / Ubisoft
Pour les éditeurs, l’objectif est triple : d’une part, amortir sur la longueur les coûts de développement devenus stratosphériques grâce à ces sources de revenu supplémentaires, sans augmenter le prix facial. De l’autre, allonger sa durée de vie et empêcher la revente du jeu et étouffer le marché de l’occasion, sur lequel seules les boutiques et les particuliers se rémunèrent. Enfin, permettre au jeu de se vendre sur le long terme, notamment en l’enrichissant de modes compétitifs de type e-sport.
Corollaire de cette nouvelle approche, les ventes au lancement sont de moins en moins décisives dans la carrière commerciale d’un jeu. A condition, tout de même, qu’il parvienne à se créer une communauté sur la longueur.