Chronique philo : « Star Wars », la fin des mythes
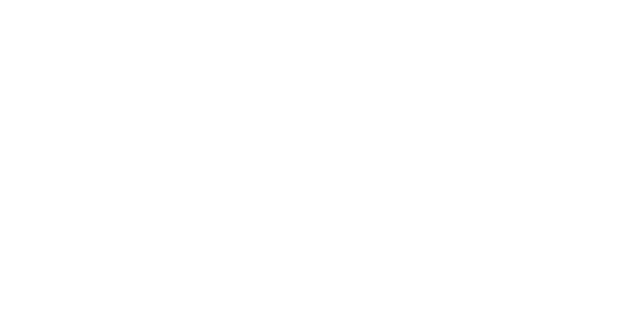
Chronique philo : « Star Wars », la fin des mythes
Des superhéros Marvel aux Jedi de Lucas film, The Walt Disney Company détient de puissants mythes contemporains, qu’elle tourne en dérision plutôt que de les renouveler, analyse le professeur de philosophie Thomas Schauder.
Reprenant le personnage du « caganer » dans les scènes de nativité catalanes, une boutique de Barcelone vend des santons Star War représentés en train de déféquer. RREUTERS / Albert Gea TEMPLATE OUT / ALBERT GEA / REUTERS
Chronique Phil’ d’actu. The Walt Disney Company, fondée en 1923, est aujourd’hui l’une des plus puissantes firmes du monde, et sans conteste la première en matière de divertissement. Elle est à la tête de l’un des plus gros gisements de créativité du monde, et surtout elle détient les droits de presque tous les grands mythes de l’ère contemporaine. Et pourtant, elle se révèle incapable d’en faire quoi que ce soit.
C’est qu’avec l’achat de Marvel en 2009, celui de Lucas Films en 2012 et de la 21st Century Fox annoncé la semaine dernière, Disney s’imagine devoir gérer des « marques » et un « catalogue », oubliant les raisons de son succès passé et de celui de ses récentes « acquisitions » : la capacité à reprendre les structures mythiques traditionnelles (le voyage initiatique, l’amitié ou l’amour entre deux êtres que tout oppose, la victoire de la ruse sur la force, etc).
Des créations comme le Marvel Cinematic Universe, au-delà de reprendre la structure de certains comics comme The Avengers et de croiser le cinéma avec la série télévisée, se veulent finalement de nouvelles mythologies, dans lesquelles les héros et les dieux sont connus et facilement identifiables, ce qui permet de varier leurs aventures sans risquer de perdre l’intérêt du public.
Bien qu’en terme de qualité ce ne soit pas du Hésiode, il n’empêche que ça rapporte gros. Et que dire de la « franchise » Star Wars, de ses millions de fans et de la prodigieuse quantité de livres, de jeux vidéo, de bandes-dessinées qu’elle a générée ? Au-delà d’un marché juteux, il s’agit bel et bien d’une « usine à rêves », d’une fabrique de mythes.
Des mythes contemporains
On peut ne pas apprécier « l’univers » Marvel ou Star Wars, ou apprécier l’un et non l’autre. La question n’est pas là. Il convient d’admettre que ces « univers » fonctionnent de par leur dimension mythique, si on admet la définition qu’en donne l’historien Jean-Pierre Vernant :
« [Le mythe] se présente sous la figure d’un récit venu du fond des âges et qui serait déjà là avant qu’un quelconque conteur en entame la narration. En ce sens, le récit mythique ne relève pas de l’invention individuelle ni de la fantaisie créatrice, mais de la transmission et de la mémoire. (…) Il n’est pas fixé dans une forme définitive. Il comporte toujours des variantes, des versions multiples que le conteur trouve à sa disposition, qu’il choisit en fonction des circonstances, de son public ou de ses préférences, et où il peut retrancher, ajouter, modifier si cela lui paraît bon. » (L’Univers, les dieux, les hommes, 1999).
Il est clair que cette définition s’applique parfaitement bien à Star Wars (George Lucas s’est beaucoup inspiré des travaux du mythologue Joseph Campbell) : un récit hors du temps (« il y a longtemps, dans une galaxie lointaine »), basé sur des personnages et des trajets archétypaux (la formation du héros auprès d’un maître sage, la lutte très « premier degré » du bien contre le mal) autorisant une variation infinie des éléments.
Mais l’histoire des super-héros de Marvel réalise également ce potentiel mythique : au fil des générations, différents auteurs et dessinateurs, puis réalisateurs, ont apporté leur vision des personnages sans que ceux-ci deviennent « autres ». Dans les deux cas, le résultat est là : ils tiennent une place importante dans la culture parce que leurs structures sont facilement identifiables et par là-même universelles.
D’un point de vue économique, voire carrément cynique, le bénéfice attendu par Disney est simple et clair : ces mythes permettent une infinité de variations, donc une infinité de films et autres produits dérivés, et ils sont parfaitement identifiables, donc le public sera toujours là (comme le prouve l’incroyable succès commercial, à défaut de critique, du huitième opus de Star Wars).
Oui... mais la tournure que prennent les plus récentes productions révèle un paradoxe.
Le rire grinçant contre le mythe
Star Wars VIII : Les Derniers Jedi m’a paru parfaitement conforme à une tendance lourde dans les super-productions récentes : la volonté de déconstruire le mythe. Pour cela, on commence par le tourner en dérision, en ajoutant des petites scènes dans lesquelles le personnage se trouve dans une position ridicule, ou en brisant les codes du genre (par exemple, l’arrêt brutal de la musique en pleine montée).
Ensuite, on débarrasse les héros des attributs qui les rendent identifiables (le marteau dans Thor : Ragnarok, le sabre laser dans Les Derniers Jedi), comme on prive l’enfant de son « objet transitionnel » (son doudou si vous préférez) pour lui signifier qu’il est temps de grandir.
Enfin, on admet explicitement qu’il faut faire « table-rase » du passé (ceux qui sont allés voir le film savent de quoi je parle), c’est-à-dire se débarrasser du poids encombrant de la structure pour en créer une nouvelle.
D’un point de vue commercial toujours, cette volonté est compréhensible car elle permet d’exploiter le filon à l’infini en déjouant les attentes des fans, c’est-à-dire de ceux qui connaissent déjà par avance les variations que peut admettre le mythe. Mais je crois qu’il y a aussi une raison moins intentionnelle et plus profonde : la difficulté de créer des mythes et du rêve aujourd’hui.
Les mythes, comme on l’a vu, reposent sur des éléments simples, agencés dans une structure qui ne bouge pas beaucoup. Or nous vivons dans un monde très fluide et complexe. Il est devenu difficile d’identifier un camp du bien et un camp du mal, alors même que le mythe repose sur ce genre de « premier degré ».
De même, la notion de « triomphe » va complètement à l’encontre de l’idéologie actuelle de « l’adaptation », et c’est bien pourquoi je parlais plus haut de l’enfance. On croit d’ordinaire que grandir, c’est s’adapter au monde réel et non lutter contre lui ou se réfugier dans un monde imaginaire.
Or c’est bien ce monde imaginaire qui est celui des super-pouvoirs qui permettent de se sortir des pires situations. En rendant les héros plus humains, c’est-à-dire à la fois plus faibles et moins unilatéraux, on leur fait perdre de leur impact sur l’imagination.
Se divertir au lieu de rêver
Que reste-t-il alors au spectateur à qui on intime l’ordre de perdre ses illusions, de dédramatiser les situations et de relativiser l’importance de ses héros ? Une réflexion sur l’état du monde ? Ce serait trop beau ! Alors même qu’ils sont plus ironiques, ces films n’en restent pas moins terriblement moralisateurs (Disney s’étant notamment inventé un discours écolo, distillé ça et là, parfaitement répugnant quand on sait la quantité de saloperies que leurs parcs vomissent quotidiennement).
Non : la seule chose que le spectateur se verra donner, c’est du divertissement, la capture de son regard par des effets spéciaux de plus en plus impressionnants et de plus en plus vides de sens ; ce divertissement, écrivait Blaise Pascal, qu’on recherche « parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir », parce qu’on ne sait pas « demeurer en repos dans une chambre », c’est-à-dire prendre le temps de s’ennuyer, de penser, de rêver (Pensées, 1670).
Or, tous les êtres humains ont besoin de rêver, car c’est de cette manière qu’on peut échapper aux contraintes du monde extérieur. Et les adultes ont besoin de satisfaire cette part d’enfance, autant qu’ils ont besoin de mythes qui leur permettent de former une communauté. L’idée très en vogue actuellement qu’il faut être « efficace », « rentabiliser » au maximum notre temps et fuir le plus possible l’inactivité va de pair avec une vision « machinique » de l’homme.
Et la meilleure preuve en est que ces super-productions Disney ne laissent pas le temps au spectateur de respirer et de ressentir des émotions (dans le dernier Star Wars, la scène où Luke apprend la mort de Han Solo ne dure que quelques secondes, et on passe à autre chose).
Disney est assis sur une mine d’or et est en train de la transformer en plomb. Ses studios révèlent davantage à chaque production leur incapacité à créer de la nouveauté, ce qui les pousse à exploiter au maximum les filons existants, tout en leur faisant perdre tout intérêt.
Quand on connaît leur passé, et celui des firmes dont ils sont désormais les propriétaires, le mot « regrettable » est encore trop faible. Ils se trompent en croyant que le public ne désire pas la nouveauté, et ils se trompent s’ils croient que nous ne sommes plus capables de rêver.
Un peu de lecture ?
- Blaise Pascal, Pensées, Folio Gallimard, 2004
- Joseph Campbell, Le Héros aux mille et un visages, J’ai lu, 2013
- Jean-Pierre Vernant, L’Univers, les dieux, les hommes, Points, 2014
A propos de l’auteur de la chronique
Thomas Schauder est professeur de philosophie. Il a enseigné en classe de terminale en Alsace et en Haute-Normandie. Il travaille actuellement à l’Institut universitaire européen Rachi, à Troyes (Aube). Il est aussi chroniqueur pour le site Pythagore et Aristoxène sont sur un bateau.
Voici ses dernières chroniques Phil d’actu :







