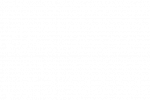Bulgarie : le plus pauvre des pays européens prend la présidence tournante de l’UE

Bulgarie : le plus pauvre des pays européens prend la présidence tournante de l’UE
Par Cécile Ducourtieux (Bruxelles, bureau européen)
Sofia, qui voudrait accéder à l’espace Schengen, devra tenter de parvenir à un accord sur les migrants et accompagnera la deuxième phase de négociation sur le Brexit.
Le Palais national de la culture, le 1er janvier, à Sofia. C’est là que se tiendront les réunions du Conseil de l’Europe. / DIMITAR DILKOFF / AFP
Au 1er janvier, c’est la Bulgarie, pays le plus pauvre de l’Union européenne (UE), qui pour la première fois en assure la présidence tournante, et ce jusqu’à la fin de juin. Une responsabilité considérable pour un Etat membre du club depuis seulement dix ans, disposant d’un nombre restreint de professionnels de la mécanique communautaire.
Pendant six mois, ce sont les officiels bulgares qui seront chargés, à Bruxelles, d’organiser les réunions ministérielles européennes, de fixer les agendas, de travailler à la formation de consensus. Pour les y aider, la Commission leur a « prêté » une quarantaine de ses fonctionnaires, une pratique relativement courante quand de petits pays, peu aux faits des us bruxellois, récupèrent une présidence tournante.
Agenda chargé et délicat
Pour Sofia, l’agenda est particulièrement chargé et délicat. Sa tâche la plus compliquée sera probablement de parvenir à un accord sur un sujet qui a profondément divisé l’Europe ces deux dernières années : la migration. Bruxelles veut pourtant aboutir à un consensus en juin. Mais les pays de l’Est, Pologne et Hongrie en tête, continuent de refuser catégoriquement toute idée de « quotas ».
« Nous rejetons avec force une telle approche, qui porte atteinte aux décisions souveraines des Etats membres », a déclaré le tout nouveau premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, à Budapest avec son homologue hongrois, Viktor Orban, mercredi 3 janvier. Ces prises de position répétées promettent une belle bataille bruxelloise au printemps. Car l’Allemagne, la Suède ou l’Italie refusent de leur côté que la « solidarité » de l’Est, en cas d’afflux de réfugiés, se limite à de l’aide financière ou logistique.
La Bulgarie, qui partage plus de 250 km de frontière terrestre avec la Turquie et fut aux avant-postes de la crise migratoire de 2015, devra tenter un compromis, sans pour autant prendre position — c’est le rôle d’une présidence que de rester le plus neutre possible à Bruxelles. Même si son premier ministre, Boïko Borissov, s’est montré plus proche des positions de M. Orban que de celles d’Angela Merkel, eux aussi membres du Parti conservateur européen, le premier parti politique à Bruxelles.
Les officiels bulgares devront également accompagner la négociation du Brexit, qui entre dans sa deuxième phase (les termes du divorce d’avec Londres ont été arrêtés à la fin de 2017). Probablement la plus difficile : la première ministre Theresa May continue de promettre à ses concitoyens « le meilleur accord » commercial possible avec l’UE, tout en défendant une sortie du marché intérieur et de l’Union bancaire, qui aura un coût considérable pour les acteurs économiques britanniques.
Rude bataille sur le budget
Autre dossier piégé, le « cadre financier pluriannuel », le budget de l’UE pour 2021-2027, au sujet duquel la Commission doit faire des propositions en mai. La bataille pour en définir les priorités et l’enveloppe globale a déjà largement commencé, et elle est rude. Après le Brexit, les vingt-sept Etats restants devront faire avec environ 10 milliards d’euros annuels en moins (la contribution britannique). Et certains (France et Allemagne) ont déjà prévenu qu’ils voulaient conditionner l’octroi de fonds au respect de l’Etat de droit, visant directement les dérives « illibérales » en Pologne et en Hongrie.
Les Bulgares réussiront-ils à éviter que la fracture Est/Ouest ne se creuse encore un peu plus ? Le pays, où le salaire minimal est presque neuf fois inférieur à celui en vigueur au Luxembourg (selon les données Eurostat du deuxième semestre 2017), espère en tout cas faire aboutir une de ses principales revendications à Bruxelles : pouvoir, enfin, accéder à l’espace sans passeport Schengen, dont il est toujours exclu, comme la Roumanie. C’est « une injustice qui ne peut pas durer », juge la commissaire bulgare Mariya Gabriel.
Surveillance rapprochée
Les deux Etats sont entrés par la petite porte dans l’UE, car jugés insuffisamment prêts. La Bulgarie doit encore se soumettre à une surveillance rapprochée, la Commission vérifiant tous les ans si le pays progresse dans la réforme de son système judiciaire, très défaillant, et dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée.
Mais il n’est pas sûr, malgré le soutien appuyé du président Jean-Claude Juncker apporté en septembre, que Sofia parvienne à convaincre tous ses partenaires européens : l’unanimité au Conseil (les Etats membres) est requise pour une entrée dans Schengen. Le fait que, sur le front de la corruption, ses progrès soient très lents n’y aide pas. Dans un rapport datant de janvier 2017, la Commission regrettait que « la lutte contre la corruption soit le secteur où la Bulgarie a réalisé le moins de progrès depuis dix ans ».
Mardi 2 janvier, le président bulgare, Roumen Radev, a mis son veto à une loi anticorruption réclamée par Bruxelles, mais qu’il juge trop faible pour se révéler efficace. Selon ce texte, une institution unique remplacerait plusieurs organes existants, qui n’ont jusque-là pas fourni de résultats tangibles. Le président Radev craint que la direction de cette institution unique, désignée à la majorité simple par le Parlement bulgare, ne tombe sous la coupe du parti majoritaire, Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB), du premier ministre Borissov.
« Nous travaillons en étroite relation avec la présidence bulgare [sur ces sujets]. Nous avons publié une série très concrète de recommandations au pays à la fin de 2017 et nous réévaluerons la situation à la fin de 2018 », a assuré jeudi Mina Andreeva, porte-parole de la Commission.