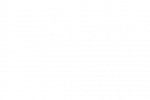A Hammam Lif, le désarroi des Tunisiens victimes de la vie chère

A Hammam Lif, le désarroi des Tunisiens victimes de la vie chère
Par Frédéric Bobin (Hammam Lif, envoyé spécial)
La détérioration des conditions de vie des familles les plus modestes enfièvre les quartiers défavorisés en Tunisie.
Manifestation contre le gouvernement et la hausse des prix, le 9 janvier à Tunis. / FETHI BELAID/AFP
L’échoppe est située entre un citronnier et une mosquée, à deux pas de la voie ferrée menant à Tunis. Hammam Lif est comme une lointaine banlieue de la capitale, mais ces vingt kilomètres de distance importent au fond assez peu. Dans la Tunisie gagnée par la fièvre sociale, la colère n’a plus de géographie, elle enjambe les cols comme les bretelles d’autoroute pour se loger jusqu’à la sandwicherie de Saïda Dellai, précieux baromètre des humeurs nationales. Foulard rose chutant sur sa blouse blanche, la patronne n’a rien d’une conjurée, elle est trop occupée à veiller sur ses bacs en aluminium emplis de laitues, d’œufs, d’oignons et de salami de dinde, garnitures qui viendront farcir le mlaoui, le pain feuilleté tunisien. Mais, quand Saïda Dellai dit que « les jeunes ont raison de se révolter car personne ne les écoute », on comprend alors que les turbulences sociales qui secouent la Tunisie depuis la deuxième semaine de janvier sont assurément une affaire sérieuse.
Hammam Lif n’est pas épargné. Ici aussi les soirées sont chaudes, émaillées de heurts entre forces de l’ordre et manifestants qui protestent contre la vie chère et Saïda Dellai prie pour que le drame de Tebourba (35 km à l’ouest de Tunis), où un jeune a été tué mardi 9 janvier, ne se reproduise pas à ses portes. Elle abhorre la violence, d’où qu’elle vienne, et son soutien au mouvement s’accompagne d’une condition : « Il ne faut pas voler, il ne faut pas casser. » Pour le reste, elle est de tout cœur avec les protestataires car « le fossé entre les dirigeants qui s’arrogent des privilèges et le peuple qui souffre » lui apparaît insoutenable.
« Quand on a faim, on est capable de bien des choses »
La cherté de la vie, ce poison qui mine le quotidien au point d’entacher à ses yeux le bilan de la révolution de 2011, Saïda Dellai en parle avec volubilité, un luxe de détails à la mesure de son désarroi. Comment peut-elle survivre avec le revenu mensuel de sa sandwicherie – environ 300 dinars, soit 100 euros – quand le bail commercial se hisse déjà à 420 dinars (140 euros) et qu’il faut payer en outre le loyer de l’appartement familial (380 dinars), les études des deux enfants, les dépenses alimentaires, etc. ? Certes, son mari, Hassid Messai, tête emmitouflée dans un bonnet de laine, rajoute au pot familial autour de 580 dinars, salaire de son emploi d’ouvrier dans une usine de fabrication d’échafaudages.
Le couple figurerait presque comme privilégié à Hammam Lif, fort de ses deux revenus qui le hissent au rang de la classe moyenne. Pourtant, il n’arrive pas à boucler les fins de mois avec la hausse des prix, en particulier ceux des biens alimentaires qui ont brutalement grimpé avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances. « Les tomates, les pommes de terre, le piment vert, les oignons, les carottes, les courgettes, tout est devenu hors de prix », grince Saïda Dellai. Quant à la viande et au poisson, elle ose à peine en parler : « Le prix du mouton a été multiplié par 1,5 depuis la révolution ! »
Du coup, la famille ne peut consommer du mouton qu’une fois tous les six mois, du poisson guère plus souvent, la seule viande accessible demeurant le poulet. Et encore, pareille diète ne suffit pas à équilibrer les comptes. Le couple est en retard dans le règlement des factures d’électricité, ce qui lui a valu une coupure punitive du courant. Depuis une semaine, la famille s’éclaire à la bougie. Pas le choix.
La révolution semble bien amère à Saïda Dellai et Hassid Messai. « Avant, on arrivait à manger, souffle Saïda. Maintenant, on y parvient à peine. La seule chose qu’on ait vraiment gagnée, c’est la liberté de s’exprimer. » Alors, faut-il redouter le pire ? « L’attitude de nos dirigeants qui s’enrichissent jette de l’huile sur le feu », s’inquiète Hassid. « Il y aura une nouvelle révolution », met en garde Saïda. « Quand on a faim, soupire-t-elle, on est capable de faire bien des choses. »
Nuits chaudes
C’est la fin de l’après-midi. Des clients entrent puis sortent de la sandwicherie. Sarah Trabelsi, foulard bleu nuit serré autour du visage, se mêle à la conversation, verbe hardi. Elle est travailleuse sociale et élève seule son enfant avec son modeste salaire de 450 dinars. Elle aussi peine à joindre les deux bouts. « Quand je peux acheter de la viande, je la réserve à mon fils, moi, je n’en mange pas », dit-elle. Et, lorsqu’elle souffre de lombalgie, elle préfère éviter de consulter un médecin, autant d’économies au service des études de son fils qui « rêve d’être pilote d’avion ».
Lors du scrutin présidentiel de 2014, Sarah Trabelsi avait accordé son suffrage à Béji Caïd Essebsi, l’actuel chef de l’Etat. Son passé de lieutenant de Habib Bourguiba lui avait bien plu, elle qui voue une admiration sans faille au « père de la nation » qui a « donné beaucoup de droits à la femme tunisienne ». La désillusion a été rude. Sarah affirme qu’elle boudera les urnes aux prochaines élections. Elle fait la moue : « Je n’ai plus confiance dans les hommes politiques. »
Tunisie : des manifestations anti-austérité émaillées de heurts
Durée : 01:57
Au fil des minutes, le réduit de la sandwicherie devient une petite arène politique. Chacun y va de son jugement dépité. Voilà Esmahène Hamdi qui entre et s’assoit sur un tabouret. Elle vit en faisant des ménages ou « tout ce qu’[elle] trouve ». « J’aime la Tunisie, clame-t-elle, mais il ne faut pas la laisser entre les mains de ces gens qui la volent. » Elle évoque sa voisine dont le fils a émigré clandestinement en Italie. Le fils d’Esmahène Hamdi a lui aussi tenté l’exil, mais « il n’avait pas assez d’argent pour payer les passeurs », confie-t-elle. Dehors, le soir tombe. Sur le trottoir d’en face, la grille du supermarché Aziza n’est qu’à moitié ouverte. Le vigile est un brin nerveux. On ne sait jamais. Les nuits de Hammam Lif sont chaudes en ce moment.