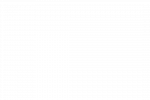Des universités kényanes prestigieuses mais déconnectées du marché de l’emploi

Des universités kényanes prestigieuses mais déconnectées du marché de l’emploi
Par Marion Douet (Nairobi, correspondance)
La classe africaine (5). Chaque année, des dizaines de milliers d’étudiants sont diplômés mais, à la sortie, la claque est rude, et beaucoup acceptent de devenir chauffeur ou livreur.
Au Kenya, l’éducation est presque une religion. Les meilleurs candidats au KCPE, l’examen national qui sanctionne la fin de l’école primaire, font la une des journaux pendant des semaines. Dans ce pays où la réussite scolaire est portée aux nues, l’université tient une place à part : prestigieuse (environ 5 % de la population y accède), chère, elle porte un rêve de réussite professionnelle et de salaire confortable. Mais, à la sortie, la claque est souvent rude.
« C’est un cauchemar », raconte Fella Obala, en recherche d’emploi depuis deux ans dans le domaine des relations internationales, option sécurité. Un secteur qu’elle pensait stratégique et porteur au Kenya, plateforme régionale de nombreuses institutions parmi lesquelles plusieurs agences onusiennes. « A 27 ans, je vis toujours chez ma mère à Greenfields [un quartier du grand est de Nairobi]. » Dans sa spécialité, les offres sont sporadiques. Décrocher un emploi répondant à ses compétences ? « Ce serait le paradis. »
« Immense préoccupation »
Chaque année, 50 000 jeunes kényans quittent les bancs de l’université diplôme en poche. Beaucoup trop pour être absorbés par le « marché formel » qui, dans sa totalité crée actuellement moins de 90 000 emplois annuels tous secteurs d’activité et tous niveaux de qualification confondus. Le problème est reconnu au sommet de l’Etat. Lors d’un forum consacré à l’éducation début 2017, le vice-président William Ruto avait évoqué « l’immense préoccupation que représente le pourcentage élevé de titulaires de licences au chômage ».
Malgré le dynamisme de sa capitale aux faux airs de métropole américaine, avec ses gratte-ciel et sa vibrante économie digitale, le Kenya reste un pays en voie de développement où le secteur informel concentre la majorité des opportunités. Loin de l’idéal de ces diplômés. « Tout le monde veut un bureau, un emploi de “col blanc”. Je ne connais personne qui veuille être charpentier, ou même instituteur », reconnaît Lisa Omwandho, diplômée en marketing de la prestigieuse Université de Nairobi. Mais elle estime que, au-delà du manque de postes, les cours « dépassés » ne préparent pas suffisamment à l’emploi. Elle rit encore d’un module intitulé « Merveilles d’Internet », totalement dépassé dans un pays où le paiement en ligne par téléphone mobile a depuis longtemps ringardisé la carte bancaire.
Dans ce contexte difficile, enchaîner les stages est devenu la norme. Mais ce moyen d’acquérir de l’expérience est difficilement tenable à long terme. D’abord parce qu’ils sont peu ou pas rémunérés, ensuite parce qu’ils débouchent rarement sur un emploi.
Alors, après des années de galère, nombreux sont ceux qui revoient leurs ambitions à la baisse. « Beaucoup de jeunes finissent par accepter des emplois sous-qualifiés, comme chauffeur ou livreur. Seule une minorité, qui en a les moyens, se paie une nouvelle formation vers des emplois demandés par le marché », affirme le professeur Jackson Too, responsable de la recherche à la Commission université du ministère de l’éducation.
Manque d’orientation en amont
Jusqu’ici Caroline résiste. Cette diplômée en sciences politiques et passionnée de droits humains a fait du volontariat, notamment chez Amnesty International, le seul moyen par lequel elle est parvenue à exercer dans ce domaine. Mais elle n’est pas sûre de tenir très longtemps. « Et perdre mes journées à postuler est exténuant », admet cette habitante de Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, que son entourage pousse à changer de voie.
Pour Jackson Too, le problème naît d’un manque d’orientation en amont. « Il y a trop de diplômés en sciences humaines tandis que des déficits existent à l’inverse dans la santé, les TIC [Technologies de l’information et de la communication] ou encore la comptabilité », affirme-il. En 2016, les sciences sociales regroupaient plus de 38 000 étudiants tandis que les filières ingénierie en comptaient moins de 22 000, et les filières mathématiques et statistiques moins de 15 000, selon le ministère kényan de l’éducation.
Pour répondre au phénomène, l’Etat a développé des instituts techniques en plein essor. Des programmes privés ou philanthropiques ambitionnent également d’orienter les jeunes au plus près des besoins, comme Generation, lancé au Kenya par la fondation McKinsey en 2009. Quelque 8 000 élèves ont été formés dans ce cadre, principalement dans la vente et les services financiers.
Siddharth Chatterjee, représentant au Kenya du Programme des Nations unies pour le développement, a fait du chômage des jeunes son combat, estimant qu’il s’agit d’une « menace existentielle » dans le pays. Pour ce haut fonctionnaire indien, résoudre ce défi passera par l’agriculture, à la fois moyen d’éviter l’exode rural et énorme bassin d’emplois. Même pour les diplômés. « Il faut parvenir à la rendre sexy, par exemple par la technologie ou par des réductions de taxes », insiste-t-il, convaincu, depuis son bureau de Nairobi.
Lisa a justement fait ce choix radical. Fini le marketing : elle est partie s’installer à Kisumu, d’où sa famille est originaire, pour élever des poulets. Sa décision a sidéré ses parents, tous deux universitaires : « Ma mère a eu une attaque. Elle a grandi au village, pour elle il est inconcevable d’y retourner. » Est-ce leur influence ou, plus largement, la pression sociale ? Bien que « très heureuse », Lisa continue de postuler à des emplois formels au moins cinq fois par semaine.
Sommaire de notre série La classe africaine
De l’Ethiopie au Sénégal, douze pays ont été parcourus pour raconter les progrès et les besoins de l’éducation sur le continent.