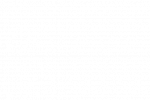Les Etats-Unis et l’UE en dissonance sur le conflit israélo-palestinien
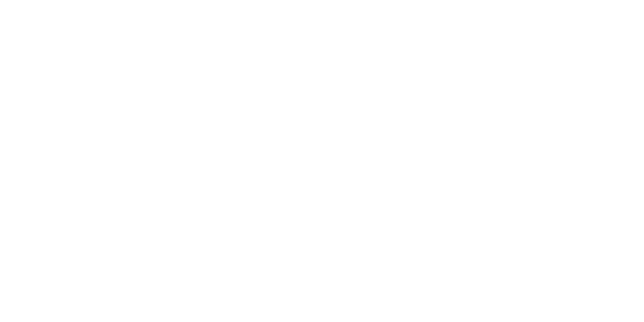
Les Etats-Unis et l’UE en dissonance sur le conflit israélo-palestinien
Par Piotr Smolar (Jérusalem, correspondant), Jean-Pierre Stroobants (Bruxelles, bureau européen)
En visite en Israël, le vice-président américain, Mike Pence, annonce le déménagement de l’ambassade à Jérusalem avant la fin de 2019.
A bientôt 83 ans, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est rompu à l’adversité. Mais qu’espérer face à une administration américaine qui se place sous les auspices d’Abraham, Isaac et Ismaël, pour déclarer sa flamme à Israël ? Dans un discours devant les députés à la Knesset (le Parlement israélien), lundi 22 janvier, le vice-président Mike Pence a certes prôné le « compromis » pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il a même évoqué la solution à deux Etats, « si les deux parties sont d’accord ».
Mais cette intervention ne cherchait pas l’équilibre. Elle a été marquée par son empreinte chrétienne, par des références bibliques multiples ne servant pas à faire décor, mais à justifier une politique. « Les premiers colons dans mon pays se voyaient aussi comme des pèlerins, envoyés par la Providence pour construire une nouvelle Terre promise », a résumé Mike Pence, dans un tissage des deux récits originels. Il n’y eut aucune référence explicite à l’occupation, aux droits des Palestiniens, à leurs aspirations à un Etat. « L’Amérique se tient aux côtés d’Israël, parce que votre cause est notre cause, vos valeurs sont nos valeurs, vos combats sont nos combats. Nous croyons dans la prévalence du vrai sur le faux, du bien sur le mal, de la liberté sur la tyrannie », a-t-il dit.
« Travail inachevé »
Pendant que Mahmoud Abbas se trouvait à Bruxelles auprès de l’Union européenne, l’ancien gouverneur de l’Indiana, héraut de la droite évangélique américaine, recueillait des ovations enthousiastes à la Knesset. Le grand écart n’était pas seulement géographique. Il y avait d’un côté les Européens, cramponnés à une approche diplomatique traditionnelle du conflit, malgré l’avancée de la colonisation israélienne. Des Européens trop divisés pour prétendre à un rôle moteur, mais qui continuent à défendre une solution négociée à deux Etats, sur les bases des frontières de 1967.
De l’autre, il y avait le vice-président américain, enjambant les siècles, donnant un sens messianique à la rupture qu’a représentée la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par Donald Trump, le 6 décembre 2017. Cette initiative, selon le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, « figure parmi les décisions politiques les plus importantes dans l’histoire du sionisme ». Malgré cela, les Etats-Unis, qui préparent en secret un plan de paix de plus en plus incertain, prétendent toujours à un rôle de médiateur unique entre les parties. Un rôle dont l’Autorité palestinienne ne veut plus entendre parler.
Parlant d’un « travail inachevé » après la reconnaissance d’Israël en 1948 par les Etats-Unis, Mike Pence s’est félicité que Donald Trump ait choisi « les faits plutôt que la fiction », en admettant enfin Jérusalem comme capitale. Pour la première fois, le vice-président a précisé le calendrier. L’ambassade des Etats-Unis « ouvrira avant la fin de l’année prochaine » à Jérusalem. « Le président Trump a donné pour instruction au département d’Etat d’engager immédiatement les préparatifs », a-t-il dit.
« Le discours messianique de Pence est un cadeau aux extrémistes, prouvant que l’administration américaine fait partie du problème plutôt que de la solution », a réagi Saeb Erekat, négociateur historique côté palestinien. Comme prévu, les députés israéliens de la Liste arabe unie ont fait un coup d’éclat au début de l’allocution, en brandissant des affiches illustrées par la mosquée Al-Aqsa, symbole de la souveraineté palestinienne espérée sur Jérusalem-Est. Les agents de sécurité les ont évacués, tandis que le reste de l’assistance couvrait le chahut avec une salve d’applaudissements.
A la satisfaction de M. Nétanyahou, Mike Pence s’est aussi exprimé au sujet de l’Iran. « L’accord sur le nucléaire iranien est un désastre et les Etats-Unis ne certifieront plus ce texte mal conçu », a prévenu le vice-président. Le 12 janvier, Donald Trump a demandé aux Européens de « remédier aux terribles lacunes » de cet accord d’ici au 12 mai, sous peine de s’en retirer. C’est là un sujet de tension majeur entre l’UE et Washington, qui applique dans ce dossier la stratégie des « ultimatums » envers ses alliés historiques, selon le mot utilisé par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.
Maintien de l’aide financière
C’est dans ce contexte que Federica Mogherini et les 28 ministres des affaires étrangères de l’UE ont accueilli Mahmoud Abbas à Bruxelles, comme l’avait été Benyamin Nétanyahou le 11 décembre. Le « raïs » a réclamé une reconnaissance « rapide » de la Palestine, qui n’a été consentie que par neuf pays sur 28, dont aucun poids lourd. Faute de mieux, Paris, Madrid et quelques autres capitales avaient donc évoqué l’hypothèse d’un accord d’association avec les Palestiniens. La discussion a été brève, le débat reporté.
Selon plusieurs Etats membres, l’initiative supposerait une reconnaissance unanime de la Palestine en tant qu’Etat. « Il y a plus de treize ans que je débats de ces questions et, au bout de 50 réunions, j’avoue qu’il m’est difficile de rester rationnel, soupire le ministre luxembourgeois Jean Asselborn. Nous n’avons pas de ligne commune. L’important aujourd’hui est de faire en sorte que la solution à deux Etats ne devienne pas impossible. »
Les Européens sont condamnés à attendre l’improbable plan de paix américain. Ils essaient de convaincre la direction palestinienne de ne pas brûler tous les ponts. « Nous resterons engagés », a répondu le président palestinien, qui rêve d’un cadre multilatéral. M. Abbas quitte Bruxelles avec une assurance : les Européens continueront à payer. Ils maintiendront leur aide financière après le gel partiel des fonds américains à l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Et ils organiseront à Bruxelles, le 31 janvier, une réunion du groupe international des donateurs pour la Palestine.