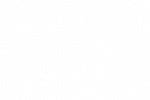DVD : Rome, ville monstre dans le regard de Fellini

DVD : Rome, ville monstre dans le regard de Fellini
Par Mathieu Macheret
Le film « Fellini Roma » ressort en édition collector, accompagné d’un documentaire sur le maestro.
« Sans transition ». Ce pourrait être le maître mot de Fellini Roma, le film le plus libre du grand Federico Fellini, qui ressort dans une édition collector enfin digne de sa luxuriance effrontée. Car ce qui frappe encore aujourd’hui dans ce portrait affectif de la Ville éternelle, où fusionnent, en une truculente orgie de contraires, l’ancien et le moderne, le sublime et l’ordure, le réel et le fantasme, le studio et le reportage, le corruptible et l’impérissable, c’est justement sa facture composite, qui fait tenir ensemble une multitude de fragments, de vignettes, de sketches et de vues dépareillées.
Dans ce film construit comme une série d’apparitions successives, sans autre protagoniste que la conscience accueillante de l’auteur, rien n’est cédé à l’ordonnancement de la dramaturgie ordinaire, tout aux logiques capricieuses de la mémoire, des affects, des visions qui semblent surgir dans le désordre.
C’est en effet le souvenir qui nous ouvre les portes et nous plonge parmi les cercles concentriques de la Rome intime de Fellini. Tout d’abord, les réminiscences d’une enfance provinciale : un maître d’école qui rejoue avec solennité le franchissement du Rubicon, une diapositive érotique projetée par mégarde en classe, provoquant l’euphorie des élèves et la panique des prêtres… Puis le temps du fascisme et des portraits de Mussolini placardés sur les murs, avec l’arrivée du jeune double de Fellini (Peter Gonzales) à Rome, Stazione Termini, son installation dans une grouillante pension de famille, sa découverte des grands dîners collectifs sur les places de la ville, des théâtres de variétés, des bordels plus ou moins chics.
Survient entre-temps la Rome moderne (celle du début des années 1970), bardée de hippies et d’étudiants politisés, lors d’une époustouflante virée sur le périphérique dont les embouteillages s’invitent jusqu’aux pieds du Colisée. Ou encore à l’occasion du percement problématique du métro, sans cesse interrompu par l’exhumation de nouveaux vestiges (une villa patricienne dont les fresques murales s’effacent au contact de l’air). Rome saisie entre deux époques, entre hier et aujourd’hui, mais dont les strates empilées à l’air libre renvoient le visiteur toujours plus loin dans le passé.
Une parade d’humanités polymorphes
Dans ce torrent d’images, Fellini montre une attention insatiable pour le capharnaüm – bastringues, boxons et beuglants sont ses univers privilégiés –, les carrefours fourmillants que sa caméra balaye comme pour en extirper les faciès truculents, les corps extraordinaires, les scènes insolites. Une ville, ça n’est peut-être rien d’autre que cela, une bousculade, un défilé ininterrompu, une parade d’humanités polymorphes, dont on finit par ne percevoir que les contrastes, les caractères débordants ou, pour le dire autrement, la monstruosité.
Rome, ville monstre, vortex temporel débouchant en tout point sur l’Antiquité, accueille aussi une incessant déploiement de monstres (femmes mythologiques, prostituées vulpines, meute de motards, ecclésiastiques pommadés, obèses proliférants, vieillards rachitiques). La mise en scène de Fellini est de nature cumulative : elle ne fait jamais rien avancer, mais s’installe dans une situation pour lui ajouter sans cesse de nouveaux éléments (dévoiler une nouvelle créature, un nouveau caractère, un nouveau geste), jusqu’à saturation du système.
Ce qui se joue là-dedans, c’est la création d’un regard omnipotent, capable de saisir à chaque instant ce qui fait l’essence du monde extérieur, à savoir son absolue hétérogénéité. Non seulement la pulsion scopique est le moteur du film, mais Fellini Roma n’a d’autre centre que ce regard, ce pouvoir de vision de l’auteur, qui organise tout ce capharnaüm autour de lui, comme si la caméra était le point focal où se répercutent tout le désordre et la trivialité du réel. C’est d’ailleurs pour cela que Fellini intègre au film son propre tournage et montre la caméra comme un personnage, une créature à part entière.
On a beaucoup ramené l’œuvre carnavalesque de Fellini au cirque, qui fut l’une de ses grandes passions. Mais il faut aussi comprendre cet attrait pour le cirque dans sa transposition alors la plus contemporaine, qui n’était autre que la télévision (une grande foire), dont les procédés, eux-mêmes « sans transition », sont repris et sublimés par Fellini. Il y a, dans Fellini Roma, un art du coq-à-l’âne qui préfigure le zapping, un sens de l’instantané qui s’apparente au reportage, une succession de gueules et de « numéros » qui lorgne le télécrochet. Le monde et sa représentation s’y confondent dans un grand chaos de formes.
Et si l’Italie est un grand laboratoire d’images, archaïques et actuelles, Fellini demeure le plus génial des savants fous ayant orchestré leur carambolage. Pour s’en convaincre, le documentaire Zoom sur Fellini, présenté en bonus, revient pendant plus de trois heures sur l’apport essentiel du maestro.
FELLINI ROMA (trailer) - en édition collector le 23 janvier 2018
Durée : 02:41
« Fellini Roma » (1972), coffret collector 3 DVD + 1 Blu-ray, Rimini Editions, 29,99 €.