Dans les revues
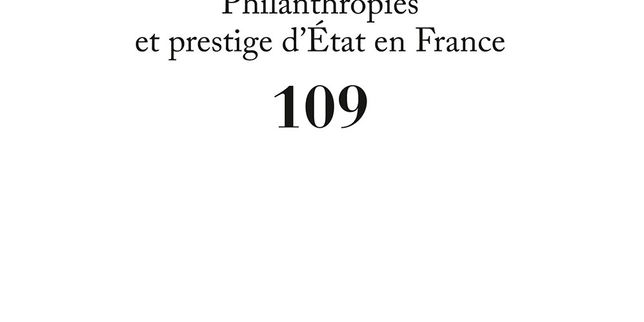
Dans les revues
Par Julie Clarini
Outre la publication de plusieurs articles sur la philanthropie en France, le nouveau numéro de la revue Genèses consacre un sujet sur les attentats parisiens du 13 novembre 2015 sous-titré « Plaidoyer pour des sciences sociales ordinaires ».
Il peut sembler curieux de prendre le parti de la « banalité » quand on travaille, en sciences sociales, sur les attentats parisiens du 13 novembre 2015. Au contraire, face à la violence du choc, la grande majorité des études, notamment celles lancées dans le cadre du CNRS – et validées pour 66 d’entre elles –, se sont focalisées sur la trace de l’événement, interrogeant le « traumatisme » et la « résilience » des victimes puis des riverains, cherchant à décrire la coupure et les recompositions biographiques entre l’avant et l’après.
Dans le nouveau numéro de la revue Genèses, Sylvain Antichan, chercheur postdoctorant à la Fondation Maison des sciences de l’homme, à Paris, propose, à l’opposé de ces attendus, d’investiguer les attentats de manière la plus ordinaire possible : en ethnographe muni de son calepin, arpentant les lieux. Bien que son enquête ne soit qu’une esquisse, elle suggère immédiatement que l’image sociale de l’événement est façonnée par des mécanismes de tri des « témoins ». Surtout, elle brise le cercle vicieux de l’enquête sur le trauma qui tend à faire surgir des récits qui confortent l’hypothèse du traumatisme.
Mise en garde
Son volet le plus intéressant concerne la fréquentation des mémoriaux ou autels de rue qui ont émaillé Paris, qui montre qu’il faut se garder de tirer des conclusions trop rapides sur la relation que les individus entretiennent à l’événement. Sous-titré « Plaidoyer pour des sciences sociales ordinaires », l’article se veut aussi une mise en garde face à la méthodologie innovante de certaines enquêtes (entretiens filmés dans les studios de l’INA, par exemple, avec des témoins préalablement maquillés) qui s’écartent des protocoles de recherche habituels. Prenons garde au risque de fabriquer ce fameux traumatisme qu’on présuppose, suggère Sylvain Antichan.
Mais c’est à un tout autre sujet que le numéro de Genèses consacre son dossier principal. Réunissant, sous la houlette du sociologue Nicolas Duvoux, plusieurs articles sur la philanthropie en France, venus de disciplines diverses (histoire, sociologie ou science politique), la revue dévoile une situation française assez paradoxale. L’Etat français a régulièrement intégré les contributions privées à ce qui lui semblait être l’intérêt général – là où, aux Etats-Unis, la justification de la philanthropie est précisément le maintien du pluralisme sur la question. Ainsi, en France, la philanthropie a-t-elle contribué « à la construction d’un Etat qui n’a cessé de la minorer, symboliquement mais aussi pratiquement » – jusqu’au renversement des années 1990, où il l’a encouragée dans le domaine culturel. On découvrira avec intérêt comment les dons de ces acteurs privés sont à la fois stimulés et invisibilisés, là encore selon une habitude toute française.
« Philanthropies et prestige d’Etat en France », Genèses. Sciences sociales et histoire (Belin, nº 109, 176 p., 25 €).






