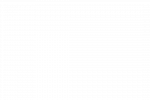Froid : le centre d’urgence Monceau, « une solution temporaire » pour les familles à la rue

Froid : le centre d’urgence Monceau, « une solution temporaire » pour les familles à la rue
Par Faustine Vincent
A Paris, une ancienne école transformée en centre d’hébergement social d’urgence accueille les femmes et les familles pendant l’hiver.
Un jeune afghan joue dans la salle de classe aménagée en chambre qu'il partage avec sa famille. / Cyril Marcilhacy pour «Le Monde»
La salle de classe a été transformée en dortoir, mais le tableau noir est resté. Les nouveaux occupants des lieux l’ont recouvert d’inscriptions à la craie, où les formules mathématiques côtoient des messages plus personnels : « Je t’aime maman. Sonia est ma puce, Awa est ma carte mémoire. Seigneur Dieu tout puissant, aide-nous. »
Depuis mi-décembre, une centaine de femmes et de familles vivent dans cette ancienne école du quartier chic de la rue de Monceau, à Paris. La mairie de Paris l’a transformée en centre d’hébergement d’urgence temporaire dans le cadre du plan Hiver – destiné à mettre à l’abri du froid les personnes sans toit –, avant le début des travaux pour construire des logements sociaux. Le bâtiment, dont le grand escalier repeint en mauve dessert six étages, dispose également de 40 places depuis janvier pour des hébergements d’une seule nuit, particulièrement convoitées en cette période de grand froid.
Quand vient l’heure de déjeuner, une trentaine de femmes et d’enfants s’attablent à la cantine, où de grands dessins égayent les murs. Syllam’mah, qui contemple la neige à travers les vitres, mange sans quitter son écharpe et son bonnet. Depuis son arrivée en décembre par le biais du Samusocial, cette Guinéenne sans-papiers de 42 ans se dit « soulagée ». A Nanterre, dans le centre d’hébergement précédent, elle devait cohabiter avec « les clochards, les malades et les fous ». Ici, au moins, elle se sent en sécurité.
Les centres dédiées aux femmes isolées et aux familles ont vu le jour progressivement, à mesure que les profils des sans-abri évoluaient. Depuis 2010, ce sont les familles qui sont les plus nombreuses à appeler le Samusocial. « On a aussi des travailleurs pauvres et des migrants, ce que l’on ne voyait pas il y a vingt ans », précise Emmanuelle Guyavarch, directrice de la régulation au service social de Paris.
Dans une salle de classe aménagée en chambre, occupée par une famille d’origine afghane. / Cyril Marcilhacy/Item pour «Le Monde»
Scolariser les enfants, un défi
Le nombre croissant de familles s’accompagne d’un autre défi pour les services sociaux : la scolarisation des enfants. A Monceau, ceux qui ne sont là que pour une nuit ne sont pas pris en charge. Les travailleurs sociaux s’efforcent en revanche d’inscrire ceux qui occupent les lieux plusieurs mois. Mais l’affaire n’est pas simple, car il faut rassembler des documents – acte de naissance, certificat de vaccination, etc. – dont les parents ne disposent pas la plupart du temps. « Les familles arrivent souvent sans-papiers. C’est un gros travail d’enquête », affirme Antonin Castell, travailleur social en poste au centre.
A défaut d’avoir déjà pu être scolarisés, Rachid, un petit garçon de 9 ans aux yeux noirs, et ses deux petites sœurs gardent la chambre où ils vivent avec leurs parents depuis leur arrivée d’Afghanistan. Le mur du fond de la pièce, en ordre parfait, est tapissé de leurs dessins de sapins de Noël, de tour Eiffel et de maisons colorées. Les trois enfants jouent au milieu des lits en attendant le retour de leurs parents. Un certain nombre d’adultes sont absents la journée, occupés par des petits boulots.
Dans le dortoir voisin de la famille afghane, Karine s’emploie à changer son bébé sur un coin de lit. Cette jeune Camerounaise a trouvé refuge à Monceau en décembre. Sa tante lui avait promis un poste de nounou bien payé. La jeune femme a tout vendu au Cameroun et pris un aller simple pour la France. Mais une fois sur place, elle n’a jamais réussi à la joindre, et s’est retrouvée pendant six mois à la rue, à dormir dans le métro ou les hôpitaux.
Les nuits ont été difficiles. A plusieurs reprises, des hommes, eux aussi sans domicile, l’ont fouillée et lui ont volé ses affaires. Ici, elle se sent bien, mange à sa faim trois fois par jour, et a trouvé du réconfort. Comme tous les occupants, Karine devra quitter les lieux lorsque le centre fermera ses portes, le 31 mars. Mais cette perspective l’angoisse tellement qu’elle préfère ne pas y penser.
« La rue c’est effrayant, pour les femmes »
F. est une femme isolée présente dans le centre d'hébergement depuis plusieurs semaines. Depuis qu’elle est à la rue, cette femme de 60 ans, a pourtant enchaîné les hébergements temporaires. Celui de Monceau est le quatrième. / cyril marcilhacy / item pour "Le
« Il faut que les personnes gardent à l’esprit que c’est une solution d’urgence, rappelle Jean-Brice Muller, porte-parole de l’association France Horizon, qui gère le centre. En général, elles ne sont là quelques mois. » Paris compte 1 400 places d’hébergement dans les centre d’hébergement temporaires comme celui de Monceau, auxquelles s’ajoutent 4 780 places dans les centres pérennes, selon le Samusocial de la capitale. Lorsque les premiers ferment, leurs occupants sont réorientés, autant que possible, vers des solutions d’hébergement plus durables.
Depuis qu’elle est à la rue, Fatima, franco-algérienne et fille de harki âgée de 60 ans, a pourtant enchaîné les hébergements temporaires. Celui de Monceau est le quatrième. Son expérience lui permet de comparer : « Celui de Nanterre, oh lala, Seigneur… Je préférerais rester dans la rue que d’y retourner. Romain-Rolland, par contre, c’était super. Il y avait même un médecin. Et ici, je me sens bien. Les gens sont à l’écoute et font de leur mieux. »
Vivre dehors a été si dur qu’elle a appelé le 115 à chaque fois pour éviter d’y rester. « La rue c’est effrayant, pour les femmes », dit-elle. Elle aussi s’est fait voler ses affaires. Même ses lunettes. Depuis, cette autodidacte ne voit plus rien, « ni de près ni de loin », et regrette de ne plus pouvoir se plonger dans les romans de Paulo Coelho pour s’abstraire de la vie en communauté qu’impose le centre.
Paris, le 6 février 2018. Dans le centre d'hébergement d'urgence (CHU) France Horizon, situé dans une ancienne école. / Cyril Marcilhacy/Item pour «Le Monde»
Tombée à la rue après une dépression et des problèmes d’argent, cette ancienne gardienne d’un immeuble huppé ne compte pas enchaîner les centres d’hébergement encore longtemps. « Je ne veux pas vivre au crochet de l’Etat », lance-t-elle. Pas question non plus de demander de l’aide à ses deux grands enfants. Ils ne savent même pas qu’elle vit depuis des mois entre la rue et les centres d’urgence. « Je ne veux pas leur dire, ni qu’ils se sentent obligés de quoi que ce soit. Ils m’ont tellement mise sur un piédestal. » Elle leur racontera ce qui lui est arrivé, bien sûr, mais après. « Une fois que tout ça sera fini. »