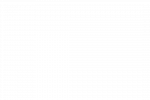Violences faites aux femmes : Twitter, Facebook et YouTube accusés de laxisme

Violences faites aux femmes : Twitter, Facebook et YouTube accusés de laxisme
Par Perrine Signoret
Dans un rapport publié mercredi, Facebook, Twitter et surtout YouTube sont accusés de ne pas être suffisamment réactifs en matière de violences faites aux femmes.
Lors d’un test effectué par le HCE, seuls 7,7 % des contenus signalés ont été supprimés. / QUENTIN HUGON / LE MONDE
Les auteurs de violences faites aux femmes en ligne bénéficient d’une « très grande impunité » sur Facebook, Twitter et YouTube. C’est la conclusion d’un rapport publié le 7 février par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE).
En juin et juillet 2017, cette instance consultative a signalé auprès de ces plates-formes 545 contenus insultants, menaçants ou constituant une forme de harcèlement moral ou sexuel envers des femmes. Seuls 7,7 % d’entre eux ont été supprimés. Le HCE s’est associé, pour ce testing, à trois associations féministes : le collectif Féministes contre le cyberharcèlement, la Fondation des femmes et l’association En avant toutes. Cet organisme placé sous l’égide du premier ministre s’attaque à un phénomène d’ampleur : dans un rapport de l’ONU publié en septembre 2015, 73 % des femmes interrogées avaient déclaré avoir été confrontées à des violences en ligne ou en être les victimes.
YouTube n’a supprimé aucun des contenus
Le plus mauvais élève en la matière est YouTube, qui n’a retiré aucun contenu malgré les 198 signalements effectués. Facebook arrive en seconde position, avec 11 % des messages violents censurés (soit 17 sur 154). Twitter en dénombre 13 % (25 sur 193).
Selon le rapport, certains types de message sont davantage supprimés que d’autres. Pour Facebook, 100 % des menaces de violence crédibles sont mises hors ligne. Ce n’est, en revanche, le cas que pour 15,4 % des contenus sexuellement explicites, et 9 % pour du harcèlement ou de l’incitation à la haine envers un genre ou une orientation sexuelle. Concernant Twitter, la violence « évidente » est aussi largement prise au sérieux, avec un taux de 100 %. L’incitation à la haine sexiste n’affiche, elle, qu’un score de 17,4 %, et le harcèlement ciblé 8,2 %.
Pourtant, de telles paroles sont bien proscrites par la loi comme par les règles d’utilisation des trois plates-formes. Celles de Facebook interdisent, par exemple, les discours « incitant à la haine », et « tout contenu qui attaque directement des personnes en raison de leur sexe ou de leur identité sexuelle ». Des dispositions similaires ont cours sur Twitter et YouTube.
La modération, « insuffisamment exigeante » et « aléatoire »
Le rapport relève d’abord des faiblesses concernant le signalement des messages violents. Le HCE regrette qu’on ne puisse pas sélectionner plusieurs « motifs » (par exemple, pour des propos à la fois racistes et sexistes, il faut choisir entre les deux qualifications) ou encore qu’il n’existe pas d’outil suffisamment adapté pour notifier d’un « raid », c’est-à-dire d’un déferlement de messages envoyés à une cible par plusieurs internautes.
Le Conseil critique également la modération, selon lui, « insuffisamment exigeante, aléatoire et non graduée ». Il préconise pour remédier à ces défauts de nouer des partenariats avec des associations féministes et faire d’elles des « tiers de confiance », dont les signalements sont étudiés avec une attention particulière.
Ce type de dispositif, associant des structures de lutte contre le racisme ou l’antisémitisme par exemple, est déjà en place chez Twitter et YouTube mais n’inclut pas de structures féministes. Facebook, en revanche, a noué des liens directs avec plusieurs associations spécialisées. Ces dernières peuvent leur signaler directement des contenus sans passer par les procédures « classiques » : le traitement de ces photos ou commentaires est alors plus rapide que si un utilisateur quelconque s’était chargé du signalement.
Autre proposition du rapport : l’automatisation du repérage des contenus sexistes récurrents (un tiers de ceux signalés dans le cadre de cette étude contenaient le mot « pute ») grâce à un algorithme, et de leur suppression.
Sur ce point, les plates-formes se montrent encore frileuses. Toutes utilisent déjà des systèmes automatiques. Mais à part Facebook, qui s’en sert pour repérer et censurer des images de « vengeance porno », ils ne servent qu’à épauler les modérateurs dans leur travail. Des outils existent aussi pour permettre à l’utilisateur lui-même de « supprimer certains mots-clés » des messages qu’il reçoit, explique un porte-parole de YouTube.
Une façon, justifient les plates-formes, d’éviter les « zones grises ». Anton Battesti, responsable des affaires publiques à Facebook France, détaille :
« L’un des principaux enjeux sur la modération de ces propos est la prise en compte du contexte, pour ne pas confondre la dénonciation de la violence avec une insulte ; une critique légitime avec une injure interdite. Il existe aussi des mots dont le sens peut changer en fonction des époques et des circonstances, comme le mot “salope” qui a servi au Manifeste des “343 salopes” [nom donné à un texte signé par des centaines de femmes ayant avorté]. C’est la raison pour laquelle nous investissons dans des moyens humains et techniques, avec un renforcement de nos équipes de modération et des recherches sur l’intelligence artificielle. »
« Nous devons aller plus loin »
« Nous avons conscience que nous devons aller plus loin et sommes déterminés à faire partie de la solution à ces problématiques complexes », assure YouTube. Twitter, de son côté, préfère se concentrer sur le positif : « nous agissons quotidiennement sur dix fois plus de comptes jugés abusifs qu’à la même période l’année dernière », estime Audrey Herblin-Stoop, directrice des affaires publiques de la branche française du site.
Le rapport du HCE évoque le rôle des pouvoirs publics dans les violences faites aux femmes en ligne et formule plusieurs recommandations à destination du gouvernement, par exemple de prendre en charge l’intégralité des soins somatiques et psychosomatiques des victimes de violences sexistes en ligne. Les auteurs du rapport regrettent aussi que les lois ne soient pas plus dures en la matière et aimeraient notamment qu’un délai maximal soit imposé aux plates-formes pour la suppression des commentaires signalés. C’est le cas en Allemagne, où les hébergeurs ont vingt-quatre heures à partir du moment où ils sont notifiés d’un contenu problématique. S’ils dépassent ce délai, le gouvernement peut leur infliger des amendes allant jusqu’à 50 millions d’euros.