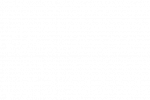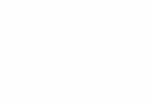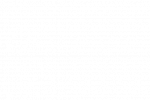Classement 2018 des écoles d’ingénieurs : quand les écoles privées défient Polytechnique

Classement 2018 des écoles d’ingénieurs : quand les écoles privées défient Polytechnique
Par Soazig Le Nevé
Plusieurs écoles d’ingénieurs privées font une percée dans le classement annuel réalisé par le magazine « L’Usine nouvelle », grâce à des salaires de sortie comparables à ceux des diplômés de X.
Des étudiants de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire, 96e au classement de « L’Usine nouvelle ». / INSA via Campus
Jamais les écoles privées d’ingénieurs ne s’étaient hissées si haut dans le classement annuel du magazine L’Usine nouvelle, dont l’édition 2018 est parue jeudi 15 février. Elles sont deux dans le top 10 et six dans le top 20 (voir le tableau en fin d’article). Si la pole position revient toujours à « l’inamovible École polytechnique », « on assiste à un vrai chamboule-tout » à sa suite, résume la note de présentation du palmarès, qui passe 130 écoles d’ingénieurs publiques et privées au crible de quatre critères principaux.
A la différence d’autres comparatifs, celui de L’Usine nouvelle attribue un fort coefficient (35) à l’insertion professionnelle, et autant à l’international, devant la recherche (coefficient 25) et l’entrepreneuriat (coefficient 5). « L’insertion et l’international sont deux boosters pour les écoles privées, qui y sont souvent bien meilleures » que leurs homologues du public, selon Joël Courtois, directeur général de l’Epita, école privée spécialisée dans l’informatique. 26e dans les deux précédentes éditions, celle-ci termine 12e au classement général, basé cette année sur les données publiques et certifiées de la Commission des titres d’ingénieur (CTI).
L’Epita est même 3e si l’on retient le seul critère de l’insertion professionnelle, qui prend en compte le salaire annuel brut médian un an après la sortie d’études (coef. 20), la part de diplômés de l’avant-dernière promotion en CDI (coef. 7), celle ayant trouvé un emploi en moins de deux mois (coef. 4), ainsi que la durée obligatoire des stages en entreprises (coef. 4).
3e pour l’insertion professionnelle, 125e pour la recherche
A l’inverse, lorsqu’un classement met l’accent sur la recherche, les écoles privées descendent mécaniquement. Le palmarès de L’Usine nouvelle ne déroge pas à la règle : au regard du seul critère de la recherche, alors que Polytechnique brille à la deuxième place après l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI), l’Epita se retrouve 125e, soit aux toutes dernières places du classement. « Nous faisons une recherche de bonne qualité mais quantitativement faible, analyse Joël Courtois. Les écoles publiques en font plus car elles bénéficient de très gros financements. »
« Le classement, ce n’est pas mon souci et je tiens à rester humble. La seule chose qui m’intéresse, c’est de placer mes étudiants », réagit de son côté Jean-Michel Durepaire, directeur délégué de l’Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (Estaca), qui dispose de deux campus, à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Laval. Alors qu’elle était 25e ces deux dernières années, l’école est désormais classée 8e au classement général et 5e pour l’insertion. Moins de quatre mois après avoir obtenu leur diplôme, 100 % de ses élèves travaillent et, dans 92 % des cas, il s’agit d’un CDI.
Le classement repose largement sur le salaire des diplômés un an après leur sortie, recueilli par la Conférence des grandes écoles et la CTI. 141 des 200 élèves de la promotion sortante de l’Epita et 100 % des sortants de l’Estaca ont ainsi répondu. L’école privée affichant les meilleurs salaires est l’Ecole supérieure d’ingénieurs Léonard-de-Vinci (Esilv), située à La Défense, en bordure de Paris : un an après sa sortie, un diplômé peut en moyenne prétendre à 44 000 euros… soit autant qu’un diplômé de Polytechnique. Avec 41 500 euros, un diplômé de l’Epita peut aussi rivaliser.
« Le résultat de ce classement me réjouit, car il montre qu’on n’éduque pas les X uniquement dans le souci de gagner de l’argent. C’est moralement très satisfaisant », réagit Jacques Biot, le président de l’école Polytechnique, évoquant aussi les 30 % de diplômés qui font le choix de poursuivre en thèse. Pour lui, « le sujet, ce n’est pas juste la feuille de paie, mais aussi l’intérêt du travail, la capacité à influer, la capacité à rebondir dans un monde où l’on changera d’emploi plusieurs fois, la capacité à intervenir sur la vie de la cité : les X incarnent un positionnement collectif et non celui d’un salaire individuel moyenné. » Et ils n’auront jamais « le couteau entre les dents pour obtenir les meilleurs salaires ».
« Le nombre de diplômés ne suffit pas aux besoins »
Portée par un secteur informatique en plein essor, l’Epita se voit proposer entre 6 000 et 7 000 offres d’emploi par an pour 200 étudiants… L’établissement a ouvert quatre antennes en région (Lyon, Toulouse, Rennes et Strasbourg) afin de diplômer, dans cinq ans, 600 élèves. « Parfois, certaines entreprises se plaignent de n’avoir embauché aucun de nos étudiants depuis trois ans », rapporte Joël Courtois. Et de citer le ministère des Armées, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (Anssi) ou encore Cap Gemini, qui interviennent pendant la scolarité pour « exister aux yeux des étudiants » et ainsi attirer les meilleurs. Même constat à l’Estaca, où « le nombre de diplômés ne suffit pas » face aux énormes besoins de l’aéronautique, de l’automobile, du spatial et du transport guidé, dans les cinq à dix ans qui viennent.
Classée 18e pour l’insertion professionnelle, Polytechnique se voit donc doublée par ces écoles privées en plein boom. « Certes, il existe une niche numérique où la tension est conjoncturellement forte en matière d’emploi. Les diplômés des écoles privées spécialisées dans ce secteur exploitent cette tension. Mais si l’on se projette à cinq, dix ou quinze ans ? Qui aura une influence sur notre monde ? Ce seront les Polytechniciens », affirme-t-il avec aplomb, évoquant des élèves qui deviennent ambassadeurs, ministres, universitaires, scientifiques, économistes… Et d’assurer qu’il peut « faire appel à eux en étant assuré de leur soutien financier en cas de levée de fonds, ce qui montre bien qu’ils ont réussi professionnellement et humainement ».
Autre donnée à prendre en compte : les frais de scolarité s’élèvent à plus de 9 000 euros par an à l’Epita, 7 650 euros à l’Estaca. Après cinq années d’études, l’investissement dans la première de ces écoles s’élève donc tout de même à 47 000 euros, soit plus qu’une année de salaires après la sortie de l’école… Pendant ce temps-là, en tant qu’élève officier de l’École polytechnique, les élèves français perçoivent une rémunération de l’ordre de 800 euros par mois.
« Le coût de la scolarité est relativement indolore », fait de son côté valoir Joël Courtois, à l’Epita : le cursus comptant treize mois de stage, rémunérés 1 800 euros par mois, ces périodes permettent de rembourser deux ans de scolarité. « Le coût total est donc plus proche des 30 000 euros, un montant couvert par les prêts bancaires » – auxquels recourent entre 40 % et 50 % d’une promotion. Et d’expliquer que l’école compte 19 % de boursiers (contre 29,8 % en moyenne dans l’ensemble des écoles d’ingénieurs) et qu’en cas de difficultés financières, l’école autorise à étaler le remboursement sur les deux ou trois ans qui suivent l’obtention du diplôme.