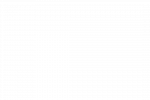Embarrassante promotion express à Bruxelles
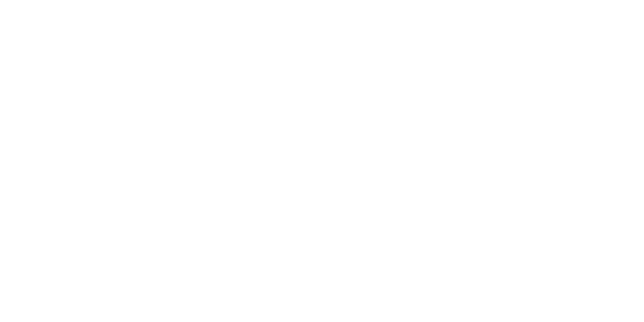
Embarrassante promotion express à Bruxelles
Editorial. La précipitation avec laquelle le directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr, a été nommé au poste-clé de secrétaire général de la Commission européenne, est du plus mauvais effet sur l’image des institutions européennes.
Editorial du « Monde ». La promotion express, fin février, du directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr, au poste-clé de secrétaire général de la Commission européenne, a provoqué une fronde sans précédent, à Bruxelles comme à Strasbourg. Lundi 12 mars, les eurodéputés de tous bords ont dénoncé cette nomination au sommet de l’administration bruxelloise, dans un concert de critiques dont l’intensité a surpris.
Les compétences de l’intéressé ne sont pas en cause. Pas plus que sa nationalité – allemande – ni ses convictions européennes. C’est la méthode qui est contestée : le fait du prince, un choix personnel du président Juncker en faveur de son conseiller le plus proche, au mépris, sinon de la lettre, du moins de l’esprit des règles. La procédure est peut-être respectée, mais la précipitation avec laquelle M. Selmayr, 47 ans, a été promu, l’absence de compétition et de transparence qui a prévalu dans l’attribution de ce poste stratégique, considéré comme celui du plus puissant des 32 000 fonctionnaires de la Commission, sont du plus mauvais effet sur l’image des institutions européennes.
A un an de la fin de son mandat, M. Juncker n’a pas à rougir de son bilan : il est parvenu, sans grande difficulté il est vrai, à faire oublier son prédécesseur, José Manuel Barroso, lui-même discrédité par son pantouflage au service de la banque Goldman Sachs. L’ancien premier ministre luxembourgeois aime à dire qu’il dirige une Commission plus « politique », présentée comme la Commission de « la dernière chance » lorsqu’il a pris ses fonctions début 2015.
Petits arrangements entre ami
A la différence du précédent collège, l’actuelle Commission n’est pas restée passive face aux graves crises qui n’ont cessé de se multiplier après celle de l’euro, qu’il s’agisse de l’arrivée massive des demandeurs d’asile, du Brexit, ou du défi présenté par l’élection de M. Trump à la tête des Etats-Unis. S’il a pu être à la hauteur, en dépit d’une santé chancelante, M. Juncker le doit en partie à son directeur de cabinet, un juriste de formation apte à brandir les traités européens pour imposer ses vues. Bourreau de travail, Martin Selmayr l’a aidé à affronter les capitales européennes, quitte à prendre le contre-pied des positions de son pays d’origine, l’Allemagne, en particulier dans la gestion de la zone euro.
A ce titre, M. Selmayr ne s’est sans doute pas fait que des amis. Mais le problème est ailleurs : à l’heure où les partis eurosceptiques ont remporté la moitié des suffrages en Italie, où l’extrême droite prospère dans plusieurs Etats de l’UE, où des dirigeants d’Europe centrale remettent en cause l’Etat de droit, la Commission ne peut s’offrir le luxe de ce type de petits arrangements entre amis.
A quatorze mois des élections européennes, dans un contexte de poussée europhobe et antisystème, Bruxelles doit se garder de présenter l’image d’une élite coupée du peuple. L’« affaire Selmayr », celle d’un technocrate qui n’aurait de comptes à rendre à personne sinon à son mentor, donne au pire moment le spectacle d’une administration qui vit dans une bulle, où rivalisent calculs de carrière et vains jeux de pouvoir. Jean-Claude Juncker s’était fixé pour objectif de se concentrer sur les sujets essentiels et d’en finir avec la bureaucratie procédurière, dans laquelle l’Europe perdait son âme et sa popularité. Plus qu’un faux pas, cette nomination montre qu’il a oublié cet engagement. Il n’est pas trop tard pour y remédier.