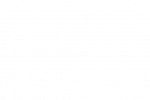André Markowicz : « Traduire, c’est rendre compte de la matérialité de la langue »

André Markowicz : « Traduire, c’est rendre compte de la matérialité de la langue »
Propos recueillis par Cécile Bouanchaud
Alors que s’ouvre le Salon Livre Paris, qui met à l’honneur la Russie, le traducteur et poète revient sur son travail de passeur de la littérature russe en France.
André Markowicz, célèbre pour ses versions dépoussiérées des romans de Fiodor Dostoïevski, pose le 2 janvier 2012 à Rennes. / DAMIEN MEYER/AFP
Mettre la Russie à l’honneur au moment où le torchon brûle entre les capitales occidentales et Moscou relève de la gageure pour le Salon Livre Paris. La plus grande manifestation littéraire de France ouvre ses portes au public à la porte de Versailles, vendredi 16 mars, pour se terminer lundi. Préparé depuis des mois, le Salon Livre Paris met en avant le renouveau des lettres russes, en invitant trente-huit auteurs russes, dont Ludmila Oulitskaïa, lauréate du prix Médicis étranger en 1996.
Le traducteur André Markowicz, qui a retraduit tout Fiodor Dostoïevski (1821-1881), est un passeur de la littérature russe en France ; il revient sur son travail et l’impossibilité de traduire une œuvre « dans l’absolu », emmenant ainsi le lecteur « entre deux mondes ».
Quelles sont les grandes règles de tout travail de traduction ?
Le premier principe, c’est qu’il n’y a pas de principe. Si je devais en trouver, je dirai que c’est rendre sensible à autrui la lecture que je fais d’un texte. C’est une lecture appliquée, la traduction doit rendre compte de la structure du texte et doit prendre en compte tous les éléments de cette construction, c’est particulièrement vrai pour le style. Traduire, c’est rendre compte de la matérialité de la langue.
Les textes que je traduis n’ont pas été pensés en langue française, donc ils ne doivent pas répondre à des règles d’une langue littéraire française préétablies. La traduction est un exercice d’accueil et d’enrichissement des possibilités de la langue française. On ne peut pas juger un texte traduit en fonction de lois qui ne sont pas les siennes.
C’est pour cela que j’ai traduit les œuvres complètes de Dostoïevski, pour que le lecteur puisse s’habituer, qu’il comprenne que ce n’est pas la langue de San Antonio, par exemple, et qu’il n’y a pas à comparer. C’est pour cela que je traduis par cycle, par grands ensembles, aucun livre séparé ne peut exister.
Qu’est-ce qui vous anime dans le travail de traduction ?
Ce qui me plaît, c’est le travail sur la langue. Ou plutôt, le travail sur les langues, celle au départ et celle à l’arrivée. La traduction, c’est toujours un entre-deux, on est ni là ni ailleurs. Il ne faut jamais penser que le livre en français d’un auteur russe équivaut au livre russe. Aucune traduction n’existe d’une façon absolue, c’est à chaque fois des interprétations, des tentatives, non pas pour passer d’un monde à l’autre, mais pour faire comprendre au lecteur que l’on est entre deux mondes.
Je décris cela dans mon nouveau livre, L’Appartement [Inculte], dans lequel j’explique comment un traducteur vit entre deux mondes, entre deux temps, en l’occurrence entre la Russie et la France. La traduction est un lieu physique, qui redevient un lieu mental, puis un nouveau lieu physique.
Est-ce que cela n’est justement pas frustrant de ne jamais pouvoir traduire un texte dans son « absolu » ?
Il ne faut pas prendre cette situation de déplacement comme quelque chose de tragique, mais comme quelque chose de l’ordre de la nature : c’est comme ça. Comme quand il pleut, ce n’est ni bien ni mal, c’est comme ça. Il y a toujours de la frustration et du renoncement. Mais que voulez-vous, plus le temps passe, plus je m’aperçois qu’il y a des personnes plus jeunes que moi, c’est frustrant, mais qu’est-ce que je peux y faire ? Je me plains beaucoup ou je pleure.
Qu’est-ce qui est constitutif de la culture russe et qui vous pose des difficultés en tant que traducteur ?
J’ai commencé à traduire Dostoïevski avec L’Adolescent. Ce personnage a une idée : il veut être Rothschild, non pas pour être l’homme le plus riche du monde, mais pour être l’homme le plus libre. Car Rothschild est le seul à pouvoir faire ce qu’il veut ou à ne pas le faire. La liberté russe, ce n’est pas la liberté de l’action, c’est un accord libre et sans contrainte avec un ordre préexistant. Un Occidental américanisé a du mal à comprendre cette idée. Par ailleurs, dans la culture russe, la prise en compte de l’individu n’existe pas, elle est toujours secondaire.
Un autre exemple que l’on retrouve dans la culture russe : dans la vie de tous les jours, il y a une exacerbation des sentiments et des choses, une sorte de violence extrême et en même temps une sorte de grande chaleur humaine. Une confrontation tragique entre la conscience de l’histoire et la conscience de la valeur d’une vie humaine, dans laquelle Fiodor Dostoïevski n’entre pas, à l’inverse de Léon Tolstoï, Mikhaïl Boulgakov ou Vassili Grossman.
Dans La Fille du capitaine, d’Alexandre Pouchkine, quand Pougatchev prend une forteresse et va pendre les officiers de celle-ci, les hommes chargés de les traîner à la potence, leur disent « ça va aller ». Tout cela est dit avec compassion, gentiment, mais ils les pendent. Cet état d’esprit est une caractéristique russe. Evidemment, la Russie ne se résume pas à cela. D’ailleurs, je ne sais pas ce que c’est la Russie, je n’ai absolument pas envie de le savoir, il n’y a pas d’essence sur le sujet de la culture.
Y a-t-il des mots russes qui sont particulièrement difficiles à traduire ?
Les difficultés fondamentales de traduction sont dans Dostoïevski. Dans Crime et Châtiment, un personnage mineur, qui n’apparaît que deux fois sans être nommé, aperçoit Raskolnikov, et lui dit un seul mot : « assassin ». Mais ce n’est pas exactement cela, il s’agit d’un mot russe, imprégné de langue populaire et de légende biblique, et qui ne signifie pas exactement qu’il est un assassin, mais qu’il a enfreint le commandement de Dieu en tuant. Si je traduis « assassin », je traduis l’intrigue du roman, mais pas l’idée, pas le sens. C’est pour cela que j’ai délibérément mal traduit, en disant : « tu as tué ». C’est cela qui compte. Ces difficultés-là, c’est constant, il y en a des centaines auxquelles les traducteurs se confrontent.