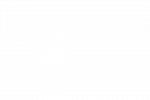Aminata Sow Fall : « On obtient plus de résultats quand on apprend aux femmes à se battre »

Aminata Sow Fall : « On obtient plus de résultats quand on apprend aux femmes à se battre »
Propos recueillis par Gladys Marivat (contributrice Le Monde Afrique)
L’auteure sénégalaise vient de publier « L’Empire du mensonge », un plaidoyer pour la solidarité et l’éducation de la jeunesse.
Elle est la doyenne des lettres sénégalaises. Née à Saint-Louis en 1941, Aminata Sow Fall est l’auteure d’une dizaine de nouvelles et de romans, dont le plus connu, La Grève des bàttu (1979), a été traduit dans de nombreux pays et porté à l’écran par le cinéaste malien Cheick Oumar Sissoko. Dans ce livre, un homme politique ambitieux déstabilise la société sénégalaise lorsqu’il interdit aux mendiants d’utiliser leur « battù », la calebasse dans laquelle ils recueillent leurs oboles. Le goût du lucre au mépris des valeurs traditionnelles, la corruption des puissants, la vie des petites gens, la dictature et les migrations sont au cœur d’une œuvre distinguée en 2015 par le Grand Prix de la Francophonie de l’Académie française.
Distante du courant de la négritude et du féminisme, Aminata Sow Fall se veut au plus près de la réalité de son pays et de son peuple. Son nouveau roman, L’Empire du mensonge, imagine le destin de trois familles voisines d’un quartier populaire, bientôt séparées par des inondations. Il résonne comme un plaidoyer pour la solidarité et l’éducation de la jeunesse. De passage au Salon du livre de Paris, qui s’est tenu du 16 au 19 mars, l’écrivaine sénégalaise évoque l’importance des valeurs traditionnelles, ses rapports avec le féminisme et l’avenir de la jeunesse.
Dans vos romans, les traditions sont souvent ce qui permet aux personnages de résoudre leurs problèmes. Le point de départ de « L’Empire du mensonge » est le rituel du repas dominical.
Aminata Sow Fall Le temps du manger est un temps de paix. C’est ce que j’ai vécu chaque jour de mon enfance. C’est un moment de joie, de partage, un instant sacré. Les discussions autour du manger forment un espace de liberté, un lieu où se forge la solidarité entre des gens de conditions très différentes. A table, nous avons tous le même statut.
Vous parlez dans votre roman de l’importance de se souvenir d’où l’on vient. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela ne veut pas dire savoir à quelle famille ou à quel milieu on appartient, mais savoir ce qu’on nous a transmis. Je voulais insister sur le fait qu’il faut former les enfants dans le sens des valeurs essentielles : l’estime de soi, la dignité et la générosité. La générosité, ce n’est pas l’argent que l’on donne, c’est l’amour de l’humain. C’est ce que transmet Mapaté, l’un des héros de mon livre, à ses enfants. Sans ces valeurs, on se perd facilement. Et pas seulement chez nous. Aujourd’hui, les gens sont trop accaparés par les événements du monde pour se préoccuper d’éduquer les enfants. Je ne parle pas de punitions ou de corrections, mais de donner des repères pour les aider à résister aux choses qui pourraient leur faire mal.
Tous vos romans montrent des personnages de femmes fortes. Pourquoi ?
Je n’ai pas été éduquée dans l’idée que les femmes sont inférieures aux hommes. Dans ma famille, toutes les filles fréquentaient l’école. L’école coranique d’abord, à partir de 4 ans puis, à 7 ans, l’école occidentale. On nous disait aussi qu’on devait être les meilleures. C’était une question d’honneur et c’est cela qui nous a permis d’avoir confiance en nous. Petite, j’étais très attentive à ce qui se passait autour de moi et je voyais comment les femmes étaient puissantes, notamment grâce à leur intuition et à leur position, loin de l’agitation, qui leur permet d’être des grandes observatrices. Aux Etats-Unis, où j’enseignais comme professeure invitée, je me souviens d’une enseignante qui avait interdit à l’un de ses étudiants de faire sa thèse sur La Grève des bàttu, car elle trouvait que je traitais mal les femmes dans mon roman. Les féministes m’accusaient de ne pas être féministe.
Et l’êtes-vous ?
Pas au sens de l’idéologie. Je ne fais pas de militantisme tout simplement parce que je ne me pense pas inférieure aux hommes. Toutefois, j’ai toujours dit aux féministes que si elles voulaient défendre les femmes, il fallait plutôt les aider à s’instruire, leur apprendre comment soigner son enfant. Au lieu de seulement crier : « Je suis féministe ! » On obtient bien plus de résultats quand on met les femmes dans les conditions de s’épanouir, quand on leur apprend à se battre. C’est bien plus concret que l’idéologie !
Je me souviens d’une discussion avec Amadou Hampâté Bâ qui me racontait qu’avant, quand les autorités villageoises se rejoignaient pour discuter de choses importantes, aucune décision n’était réglée sous l’arbre à palabres. Les hommes se séparaient en disant : « On va réfléchir sur l’oreiller. » La décision revenait en fait à l’épouse, à la sœur aînée ou à la mère. Les femmes ont cette autorité indétrônable qu’elles exercent sans jamais hausser la voix. Elles sont les gardiennes de la famille et préfèrent agir en douceur pour ne pas faire éclater le foyer. Ça ne veut pas dire qu’elles ont un esprit plus étroit que l’homme.
La montée d’un islam plus rigoriste au Sénégal ne risque-t-elle pas de remettre en question la position des femmes ?
J’ai posé la question à des personnes très imprégnées de l’islam, très savantes, et elles m’ont dit qu’elles avaient interprété le Coran dans le sens du respect de la femme. La femme est sacrée, car c’est la mère qui enfante, qui agrandit. Le voile ne rend pas les femmes inférieures. Je vois des femmes voilées car c’est leur interprétation de l’islam ou celle de leur milieu, mais ça ne les empêche pas d’être de grandes intellectuelles ou d’enseigner.
L’Empire du mensonge, d’Aminata Sow Fall, éditions Le Serpent à plumes (128 pages, 15 euros).