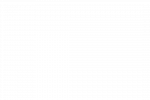« La mort de Sudan nous rappelle que ces animaux peuvent disparaître à l’échelle d’une vie humaine »

« La mort de Sudan nous rappelle que ces animaux peuvent disparaître à l’échelle d’une vie humaine »
Propos recueillis par Marion Douet (Nairobi, correspondance)
La zoologue Kes Hillman-Smith a coordonné, pendant vingt ans, un programme visant à relancer la population de rhinocéros blanc du Nord.
Après le décès de Sudan au Kenya, le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle connu, la zoologue spécialiste de cette sous-espèce Kes Hillman-Smith a répondu avec émotion aux questions du Monde. Cette Britannique devenue kényane a coordonné pendant vingt ans un programme visant à relancer leur population dans le parc de la Garamba, en République démocratique du Congo, leur dernier habitat naturel connu. Après une hausse, on estime aujourd’hui que la guerre a finalement eu raison d’eux au début des années 2000. Mais pour l’auteure de Garamba, Conservation in Peace & War (« Garamba, la préservation en temps de paix et de guerre », 2015, non traduit), il existe toujours, malgré tout, un espoir.
Que ressentez-vous après la mort de Sudan ?
Je suis profondément triste. Evidemment c’était attendu, tôt ou tard. Mais c’est un sentiment terrible d’avoir si bien connu un animal et qu’il soit parti, sachant qu’il est le dernier mâle recensé. J’ai assisté à leur arrivée [avec trois autres rhinocéros, en 2009] à la réserve d’Ol Pejeta. C’était incroyable, il y avait tellement d’espoir à cette époque. C’est frustrant de savoir combien nous avons essayé, par différents moyens, de préserver cette sous-espèce. Il faut en retenir que des animaux aussi extraordinaires peuvent disparaître à l’échelle de temps d’une vie humaine…
Comment en est-on arrivé là ?
C’est uniquement le résultat de la guerre, de la politique. Autrefois, les rhinocéros blancs du Nord vivaient dans l’actuelle République démocratique du Congo, l’actuel Soudan du Sud [notamment la réserve de Shambe, où Sudan a été capturé], la République centrafricaine et jusqu’au sud du Tchad. Prenons l’exemple du parc de la Garamba, en République démocratique du Congo. Dans les années 1960, il y en avait plus de 1 000. Environ 90 % sont morts au cours de la rébellion Simba, en 1964. Puis il y a eu la guerre civile au Soudan, juste de l’autre coté de la frontière, ainsi que de grandes vagues de braconnage en Afrique de l’Est et du Centre. En 1984, il n’y avait plus que 15 individus recensés à Garamba. Et l’on estimait déjà qu’il s’agissait de la principale population.
Sudan a été capturé en 1976, puis envoyé au zoo de Dvur Kralové, en République tchèque. Ces pratiques ont-elles contribué au déclin des populations ?
Pas vraiment, et cela a permis de mieux connaître les animaux. Et même si c’est terrible, il n’y aurait plus aucun individu vivant si elles n’avaient pas eu lieu. Il nous reste ses descendantes. De plus, il faut admettre que la préservation des espèces est un concept très éloigné des gens. La possibilité d’aller voir Sudan, Najin et Fatu [ses descendantes] en République tchèque, de les approcher, de les nommer a aussi œuvré à porter le message des défenseurs de la préservation. Nommer quelqu’un est beaucoup plus parlant que n’importe quelle statistique.
Quel a été le résultat de votre travail dans le parc de la Garamba, dans les années 1980 et 1990 ?
Nous sommes parvenus à doubler la population. De 15 individus au départ en 1984, nous sommes passés à 30 huit ans plus tard.
Que faut-il faire, finalement, pour amener des rhinocéros à se reproduire ?
Le travail consistait à protéger l’ensemble du parc, à le réhabiliter, car le déclin des populations de rhinos et d’éléphants avait entraîné son abandon. Il a fallu relancer les activités de lutte contre le braconnage, rendre du matériel aux rangers, les soutenir, comprendre où étaient les menaces, car des braconniers venaient du Soudan voisin. Ensuite, la nature marche très bien toute seule ! Il y avait constamment des naissances, nous pouvions les suivre dans leur vie, dans leur propre descendance. C’était une période incroyable.
Pourquoi n’a-t-il pas alors été envisagé de conduire une partie de cette population dans un pays plus sûr ?
Ils étaient bien protégés in situ : la préservation dans la nature reste le but ultime. Et si l’on enlevait les rhinos, plus personne n’allait protéger la Garamba dans son ensemble, où vivaient d’autres espèces comme les éléphants et les girafes. En outre, il a été prouvé que les animaux se reproduisent mieux dans la nature. D’ailleurs, à la même époque, ceux qui vivaient dans des zoos déclinaient.
Nous sommes parvenus à garder la population stable, même pendant la guerre en République démocratique du Congo, puis au Soudan, mais en 2004, après le cessez-le-feu, le départ de groupes armés installés près de la frontière a laissé la place à des chasseurs traditionnels, à cheval, venus du nord du Soudan. Ils sont entrés dans la Garamba et les rhinocéros ont été massacrés.
Aujourd’hui, un projet vise à tenter d’obtenir des bébés rhinocéros blancs du Nord via fécondation in vitro, mais les scientifiques ne pourront travailler que sur les gamètes de quelques individus. Est-il possible de relancer une espèce sur cette base ?
L’idée est, avant tout, de préserver autant que possible les adaptations génétiques qui différencient les rhinocéros blancs du Nord de ceux du Sud – elles ne sont d’ailleurs pas très grandes. Mais inévitablement, il va falloir, je pense, les croiser avec des rhinocéros blancs du Sud. Nous avons eu toutes ces avancées technologiques qui aujourd’hui nous permettent de faire des tentatives extrêmes de reproduction pour tenter de garder leur ADN.
Cela en vaut-il la peine ? Il y a peu, l’ONG Save the Rhino appelait à mobiliser l’argent pour d’autres espèces de rhinocéros qui comptent encore suffisamment d’animaux…
Je ne crois pas qu’il y ait de « détournement » de l’argent. Par exemple, les fonds utilisés par le Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research [un laboratoire allemand de zoologie qui travaille sur ce processus] pour ses recherches, ne seront jamais mis dans la préservation in situ. Ce n’est pas le même type de financements.
Pour répondre à votre question, oui, sans aucun doute. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Cela implique aussi de continuer à chercher dans la nature.
L’espèce y est pourtant estimée éteinte depuis les dernières recherches à la Garamba, au milieu des années 2000…
Il n’y a pas vraiment d’espoir dans le parc. Mais il est entouré de larges forêts, des zones tampons, appelées les « domaines de chasse », un terme hérité de l’époque où cette pratique était encore autorisée. Il est toujours difficile d’être certain que tout a été vu, qu’il s’agisse d’un travail par avion ou au sol, notamment parce que ces domaines sont très boisés. Ensuite, pendant une longue période il n’y a plus eu beaucoup de patrouilles dans la zone. J’y suis retournée en 2016. Sur place, certains rangers étaient persuadés qu’il pouvait encore y avoir des rhinocéros. Le montant exact nécessaire pour reprendre des recherches n’a pas été établi clairement, mais l’on parle, dans un premier temps, d’une dizaine de milliers d’euros au plus. De même au Soudan du Sud, c’est toujours possible, mais complexe à prouver, car il est difficile de rejoindre certaines zones actuellement.