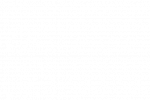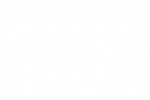Mai 68 : « Le mouvement du 22 mars à Nanterre peut être perçu comme un détonateur »

Mai 68 : « Le mouvement du 22 mars à Nanterre peut être perçu comme un détonateur »
Propos recueillis par Jérémie Lamothe
L’historienne Michelle Zancarini-Fournel rappelle que le mouvement des étudiants de Nanterre, menés par Daniel Cohn-Bendit, s’inscrivait dans un contexte plus large de contestation étudiante.
Il y a cinquante ans, le 22 mars 1968, près de cent cinquante étudiants, menés par Daniel Cohn-Bendit, décident d’occuper la tour centrale administrative de la faculté de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Cette action sera analysée comme le point de départ du mouvement de Mai 68, qui bloquera la France durant plusieurs semaines.
L’historienne Michelle Zancarini-Fournel, auteure de nombreux ouvrages sur Mai 68*, explique toutefois qu’il est compliqué de déterminer un point de départ précis à ces événements, d’autant que la contestation étudiante, en cette année 1968, avait fait son apparition depuis plusieurs mois déjà dans plusieurs facultés françaises. Elle considère que le mouvement né dans la faculte de Nanterre plutôt « comme un détonateur, comme une mèche allumée d’un feu qui se consumait déjà ».
Quelles sont les raisons de l’occupation de la faculté de Nanterre, ce 22 mars 1968 ?
Le mouvement avait démarré à la rentrée universitaire précédente, en 1967. Il y avait cette idée, chez les militants étudiants, que des listes noires avait été constituées par des appariteurs pour dénoncer les agitateurs. L’occupation du 22 mars devait aussi notamment servir à dénoncer ça.
Mais la première revendication était la libération d’un militant du Comité Vietnam (CVN) qui avait été arrêté quelques jours avant lors d’une manifestation anti-américaine contre l’American Express à Paris. Et les étudiants souhaitaient également la libre circulation des filles et des hommes dans les résidences universitaires. Ils le percevaient comme un droit à l’égalité et à la liberté de la sexualité.
Mais cette revendication était déjà portée depuis quelques mois dans d’autres facultés, comme Aix-en-Provence, Grenoble ou Nantes.
L’occupation de la faculté de Nanterre peut-elle être considérée comme le point de départ du mouvement de Mai 68, comme cela est généralement expliqué ?
Je suis toujours méfiante sur le mythe des origines d’un événement. On ne peut pas dater à un moment précis l’origine du mouvement. Mais on peut le percevoir comme un détonateur, comme une mèche allumée d’un feu qui se consumait déjà.
Pendant plusieurs semaines ensuite, il y aura des débats qui vont être organisés à Nanterre, des commissions vont être créées par les étudiants pour évoquer la suite.
Le mouvement de contestation était déjà parti de la faculté de Strasbourg, en 1963, dans le département de sociologie : les revendications portaient notamment sur la fin des examens, la suppression des notations, l’établissement d’un contrôle continu.
Quand les situationnistes (organisation révolutionnaire contre le capitalisme notamment) prennent le contrôle de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) à Strasbourg, ils diffusent des textes qui circulent dans les milieux militants d’extrême gauche des universités françaises.
Les étudiants contestataires à Nanterre avaient-ils des relations avec d’autres universités en France ou à l’étranger ?
Oui, ce n’était pas un mouvement nombriliste. Ils avaient des liens avec des étudiants et des ouvriers à Prague, à Varsovie, avec aussi les Provos hollandais (mouvement révolutionnaire, libertarien) et des groupes libertaires en Italie, des étudiants sur les campus américains… Ce n’était pas seulement un mouvement contre l’impérialisme américain mais c’était aussi contre l’impérialisme soviétique, contre le système administratif et politique et la bureaucratie communiste en Europe de l’Est.
Par ailleurs, en avril, il y a eu aussi des manifestations en Europe, en Italie et en Allemagne notamment, qui avaient fait l’objet d’un reportage à la télévision française. Ce mouvement français n’était donc pas isolé.
Qu’est-ce qui va faire que le mouvement étudiant va prendre de l’ampleur dans tout le pays ?
C’est au moment où, lors de la tenue d’un meeting dans la cour de la Sorbonne, des étudiants de Nanterre et de la Sorbonne ont été emmenés par la police, le vendredi 3 mai. Près de six cents personnes vont alors être arrêtées.
Les premiers affrontements ont lieu au Quartier latin, à Paris. Il est tout de suite question de la « répression » et de violences policières contre le mouvement étudiant. Un mot d’ordre est ensuite constant : « Libérez nos camarades ».
Le mouvement prend également dans d’autres régions de France, le 6 mai, par exemple, avec l’occupation de la faculté des sciences de Lyon. Dans certaines facs, le mouvement ne démarre pas immédiatement : c’est le cas lorsque le syndicat UNEF est dirigé par des étudiants communistes, comme au collège universitaire de Saint-Etienne. Ces derniers étaient, au début, très réticents contre ce mouvement considéré comme « gauchiste ».
Comment va réagir le pouvoir en place à ce mouvement ?
Il n’a pas pris la mesure tout de suite de la gravité de la situation, de la diffusion du mouvement dans la France entière. Le ministre de l’éducation nationale, Alain Peyrefitte, disait au départ que c’était « une poignée d’enragés ». A Strasbourg, une « université autonome » avait pourtant été déclarée dès le 9 mai.
Le premier ministre, Georges Pompidou, se rend compte de la situation à son retour d’un voyage en Iran, le 11 mai. Il va alors prononcer un discours d’apaisement à l’Assemblée nationale et évoquer une « crise de civilisation ».
Le général de Gaulle, alors président de la République, n’intervient pas publiquement. Il ne reprend véritablement la main que le 30 mai, avec un discours à la radio dénonçant un danger totalitaire et annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale et de nouvelles élections.
* Philippe Artières et Michelle Zancarini-Fournel, 68, une histoire collective, (La Découverte, 2008).
Les vraies couleurs de mai 1968, par Bruno Barbey