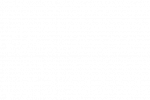Procès de Tarnac : Yildune Lévy et Julien Coupat, ensemble et séparément

Procès de Tarnac : Yildune Lévy et Julien Coupat, ensemble et séparément
Par Henri Seckel
Le procureur doit présenter ses réquisitions mercredi après-midi, après dix jours d’audiences que les deux principaux prévenus, qui répondent pourtant des mêmes charges, auront traversés bien différemment.
Les débats sur le fond de l’affaire de Tarnac sont terminés, place aux longs monologues : plaidoiries des parties civiles (la SNCF) puis réquisitoire du procureur, mercredi 28 mars à 13 h 30, plaidoiries de la défense jeudi et vendredi au même horaire. Les huit prévenus auront la parole en dernier vendredi ; ils l’ont prise une avant-dernière fois mardi, à l’invitation de la présidente du tribunal, Corinne Goetzmann, qui souhaitait les entendre parler d’eux et de la façon dont cette histoire longue de dix ans les avait affectés.
Yildune Lévy est venue à la barre en premier, où elle est restée moins de cinq minutes : « Cette affaire a marqué mon prénom si rare du sceau de l’accusation, alors aujourd’hui, je me fais parfois appeler par un autre prénom pour me payer un peu de ce luxe de l’anonymat que j’ai perdu », a-t-elle dit. Julien Coupat lui a succédé, il est resté là plus vingt minutes : « Nous avons fait face à quelque chose, nous l’avons combattu, et nous n’aurions pas eu le culot que nous avons eu si nous n’étions pas sûrs de notre fait », a-t-il dit. Ou comment résumer en deux phrases la façon dont les deux principaux prévenus auront traversé leur procès.
Le « couple » Coupat-Lévy, officieux à l’époque des faits en novembre 2008, marié au cours de l’instruction, divorcé désormais, n’en a pas du tout été un en audience. On a parfois oublié que ces deux-là étaient accusés des mêmes délits – dégradations, association de malfaiteurs, refus de prélèvement ADN – pour lesquels ils espéraient le même jugement – la relaxe, alors qu’ils encourent cinq ans de prison –, tant leurs défenses ont divergé. Ce procès laisse la curieuse impression que Yildune Lévy et Julien Coupat étaient dans le même bateau, mais ne ramaient pas à la même cadence.
Ambitions différentes, attitudes différentes
L’une s’est contentée de participer à son procès, l’autre a passé son temps à faire celui de l’instruction, de l’antiterrorisme, et de la procédure pénale française depuis le XVe siècle. L’une avait surtout envie de prouver son innocence, l’autre souhaitait plus encore démontrer la culpabilité des responsables policiers, politiques et judiciaires à qui il attribue la paternité du bazar de Tarnac. L’une était pressée d’en finir pour regagner ses pénates, l’autre n’aurait sans doute pas été contre quelques heures supplémentaires dans la chambre des criées. Ce procès aura duré trois semaines, et ce n’est pas à cause de Yildune Lévy.
Ambitions différentes, attitudes différentes. L’une ne s’est exprimée que quand on lui a donné la parole, l’autre l’a confisquée plus souvent qu’à son tour – et n’est pas passé loin de l’expulsion de la salle, à force d’interrompre la présidente. L’une demandait la permission pour aller se rasseoir au deuxième rang, l’autre se levait de manière intempestive au premier pour intervenir, entre deux gorgées de maté. « Ce n’est pas facile pour moi de prendre la parole et encore moins ici », fut la première déclaration de Yildune Lévy. Julien Coupat, lui, a passé son temps à invoquer son « esprit d’escalier » pour ajouter « encore juste une petite chose », alors qu’on pensait tel chapitre clos. Combien de fois a-t-on, alors, vu Yildune Lévy lever les yeux au ciel ?
Ton sage d’un côté, parfois espiègle ; ton docte de l’autre, souvent hautain. Mais des accents de révolte communs en évoquant la broyeuse dans laquelle ils ont passé dix ans. En commun aussi : tous deux ont refusé de toucher le crochet du sabotage dont ils sont accusés lorsqu’il a circulé dans les rangs ; tous deux sont restés debout avant chaque audience (comme leurs six coprévenus) pour ne pas avoir à se lever à l’arrivée de la présidente ; et tous deux ont affiché leur détestation du procureur Olivier Christen – qui a longtemps soutenu, avant son abandon en 2017, la qualification « terroriste » initiale de cette affaire. Détestation matérialisée par le silence de l’une, qui a même refusé de le regarder, par le verbe de l’autre, qui a frôlé l’outrage à magistrat en l’apostrophant par son patronyme (« Et bin alors Christen ! ») ou en expliquant que son « acharnement » relevait du « déni psychiatrique ».
Les prévenus ressemblent à leurs avocats
Les deux prévenus auront chacun été défendus par un avocat qui leur ressemble – modeste, sensible et concise pour Me Marie Dosé ; flamboyant, fanfaron et bavard pour Me Jérémie Assous. On n’a pas comptabilisé le temps de parole de l’une et de l’autre, mais le rapport aura au moins été de 1 à 10 – Me Assous s’est d’ailleurs fait gronder, en fin de première semaine, parce qu’il perturbait les débats à force d’intervenir.
Fatalement, à tant s’exprimer, celui qui défend sept des huit prévenus aura parfois plongé le tribunal dans des abîmes de perplexité – les assesseures notamment, qui arrivent au procès sans avoir lu le dossier – lorsque, promettant de mettre en lumière une incohérence de l’accusation, il finissait par ensevelir l’auditoire sous un flot d’explications nébuleuses au sujet de points que la présidente n’avait pas encore abordés. Mais il a fait montre d’un aplomb et d’une obstination spectaculaires dans son entreprise de démolition (réussie) du fameux « PV 104 », qui servira aussi Yildune Lévy.
De son côté, Me Dosé a préféré constater que la présidente du tribunal avait elle-même enterré cette pièce centrale de l’accusation en remettant en cause sa valeur probante, et s’est donc concentrée sur le non moins fameux retrait bancaire de 2 h 44 effectué la nuit du sabotage par la carte bleue de sa cliente, alibi puissant, qui servira aussi Julien Coupat.
L’ordre des plaidoiries de la défense doit encore être défini. Une chose est déjà certaine : Me Assous va prendre son temps, et aura enfin la certitude de ne pas être interrompu par son propre client, lui qui a parfois semblé accablé par son interventionnisme extrême. Scène cocasse, mardi, alors qu’il était en train de mener l’interrogatoire d’un témoin et que Julien Coupat lui soufflait une question : Jérémie Assous a fini par craquer et lui signifier – gentiment – de se taire (« Pfff, eh, oh ! ») avant de se placer juste devant le procureur et de suggérer en souriant qu’il pourrait faire le réquisitoire à sa place.