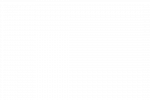Tarnac : les leçons d’un naufrage

Tarnac : les leçons d’un naufrage
Editorial. En relaxant les huit prévenus dans « l’affaire de Tarnac », la juge Corinne Goetzmann a rappelé les bases de l’Etat de droit et nous tend un miroir édifiant sur dix années de dérive de l’antiterrorisme.
Editorial du « Monde ». Il y aurait une certaine commodité à considérer le naufrage judiciaire de l’affaire de Tarnac comme un épisode isolé. Il serait rassurant et confortable de n’y voir qu’un accident de l’histoire déclenché, en 2008, par la guerre des polices ou par les emballements fantasmatiques de responsables politiques, au premier rang desquels la ministre de l’intérieur de l’époque sarkozyste, Michèle Alliot-Marie. Mais le jugement prononcé jeudi 12 avril par le tribunal correctionnel de Paris envers huit personnes, militants de la gauche radicale ou supposés l’être, nous tend au contraire un miroir édifiant sur dix années de dérives ininterrompues de l’antiterrorisme français.
Car la juge Corinne Goetzmann, en relaxant les prévenus des accusations de sabotage d’une ligne TGV et d’association de malfaiteurs – la dimension « terroriste » avait été abandonnée avant le procès mais elle a accompagné toute l’instruction –, n’a pas uniquement accablé une enquête menée en dépit du bon sens, dénoncé les « stratagèmes » utilisés lors de l’instruction et enterré une dernière fois la « fiction » du groupe de Tarnac. Elle a aussi rappelé les bases de l’Etat de droit.
En substance, ce jugement rappelle que les services de renseignement ne peuvent s’immiscer dans une enquête judiciaire. Ces policiers étant protégés par le secret-défense, le juge judiciaire ne peut « contrôler et vérifier [leurs] constatations », et les éléments qu’ils fournissent sont donc « dépourvus de toute valeur probante ». Or, dans le dossier Tarnac, il ne fait pas de doute que l’utilisation excessive de la toute neuve direction centrale du renseignement intérieur (DCRI, devenue DGSI depuis) a biaisé l’enquête judiciaire. Non, assène la juge, une bibliothèque, si radicaux soient les ouvrages qui la composent, n’est pas un « élément de preuve ». Non, enfin, « le fait de se concerter sur l’organisation d’une manifestation (…) ne caractérise pas en soi un projet de commettre un délit ».
Principes battus en brèche
Or ces grands principes ont été battus en brèche par l’arsenal antiterroriste mis en place ces dernières années. La loi du 30 octobre 2017, dans la lignée de l’état d’urgence, permet au ministre de l’intérieur d’assigner à résidence et de perquisitionner sur de simples renseignements, sous le contrôle minimal et bienveillant du juge administratif ou, au mieux, sous celui, superficiel, du juge des libertés et de la détention. On pourrait également citer les multiples condamnations pour « apologie du terrorisme » sur la foi du contenu d’un ordinateur ou les poursuites pour « association de malfaiteurs » visant des manifestants à Rennes en 2016 ou autour du site d’enfouissement de Bure, dans la Meuse, en 2017.
Le débat récurrent relancé encore une fois après les attentats du 23 mars à Carcassonne et Trèbes (Aude), sur la rétention des « fichés S », qui revient à dévoyer un simple outil de renseignement « dépourvu de toute valeur probante », pour reprendre les mots de la juge Goetzmann, démontre qu’en la matière les risques de surenchère sont sans fin.
Il ne fait pas de doute que la lutte – évidemment nécessaire et légitime – contre un terrorisme meurtrier et aveugle a rendu difficilement audible la moindre opposition, fût-elle fondée sur l’invocation de principes élémentaires. C’est le mérite du jugement rendu le 12 avril. Il rappelle que la fin ne justifie pas tous les moyens et que le juge judiciaire est un maillon essentiel de la démocratie. Il invite les responsables politiques et le législateur à toujours inscrire leur action dans le respect de l’Etat de droit.