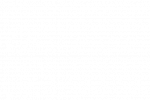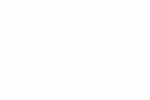Succession en trompe-l’œil à Cuba

Succession en trompe-l’œil à Cuba
Editorial du « Monde ». La voie est étroite pour Miguel Diaz-Canel, qui devrait arriver au pouvoir après soixante ans de castrisme, s’il veut engager des véritables réformes.
Editorial. En démocratie, cela pourrait s’appeler « le changement dans la continuité », mais Cuba n’est pas une démocratie. Dans les régimes dictatoriaux, la dose de continuité l’emporte généralement sur le changement : la journée de jeudi 19 avril à La Havane, où Raul Castro, 86 ans, frère du défunt Fidel, devait céder la présidence du Conseil d’Etat à Miguel Diaz-Canel, unique candidat, ne fait malheureusement pas exception à cette règle.
A 57 ans, Miguel Diaz-Canel, né après la révolution, n’a connu que le castrisme. Il affiche le parcours classique des apparatchiks des régimes hérités de l’également défunte Union soviétique : ingénieur en électronique, professeur d’université, il a gravi méthodiquement tous les échelons du Parti communiste cubain (PCC) depuis trente ans, puis intégré sa direction ces dernières années. Premier secrétaire du parti dans sa province de Villa Clara, au centre de l’île, il rejoint le bureau politique en 2003 : en 2012, il prend l’une des huit vice-présidences du conseil des ministres et, l’année suivante, est directement promu numéro deux du conseil d’Etat, ce qui le place en position de successeur désigné. Tout a été verrouillé pour éviter l’émergence d’un Gorbatchev cubain au sein du parti. Quant aux chances de voir une alternative naître légalement en dehors du parti, elles sont réduites à zéro, puisque l’opposition n’a pas droit de cité à Cuba.
Creusement des inégalités
Que le suspense haletant de la succession de Raul Castro – qui reste président du PCC – ne suscite pas de passion au sein de la population cubaine ne devrait donc étonner personne. Près de soixante ans après la révolution des « barbudos », Cuba reste un pays hors du temps, où affluent les touristes mais dont la population, accaparée par les difficultés quotidiennes malgré les acquis sociaux de la révolution, semble résignée à l’immobilisme politique. La liberté accordée aux Cubains, depuis 2013, de voyager à l’étranger est, finalement, l’une des principales ouvertures du règne de Raul Castro.
L’introduction limitée de l’économie privée n’a pas tenu ses promesses : incomplète et mal menée, elle a produit un effet pervers spectaculaire, celui du creusement des inégalités, favorisé par la coexistence de deux monnaies, dont seule l’une est convertible en devises étrangères et qu’il va maintenant falloir unifier. L’écart des revenus s’est multiplié par dix en l’espace de trente ans. Après avoir accordé plus d’un demi-million de licences de travail indépendant, le pouvoir a freiné l’entreprise individuelle en 2017. Evitant de prendre l’audacieux virage chinois vers le marché, Raul Castro s’est borné à « actualiser le modèle socialiste ».
M. Diaz-Canel se risquera-t-il à aller plus loin ? N’ayant pas participé lui-même à la révolution de 1959, le nouveau numéro un cubain, peu connu à l’extérieur, peut tenter de justifier sa réputation de pragmatique. Son ascension à lui s’est faite dans le contexte de l’effondrement de l’URSS, qui tenait à bout de bras l’économie cubaine. Le contexte actuel ne lui est pas beaucoup plus favorable : le Venezuela, rare régime ami de Cuba qu’il fournissait en pétrole, s’est à son tour effondré, et le rapprochement avec les Etats-Unis, lancé en fanfare par le président Barack Obama il y a deux ans, n’a pas survécu à l’arrivée de Donald Trump. Entretenir l’immobilisme promet un étouffement économique à petit feu ; lancer de vraies réformes comporte une part de risque politique : la voie est étroite pour le successeur des Castro.