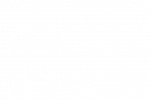« Bottle Rocket » : aux racines texanes de Wes Anderson

« Bottle Rocket » : aux racines texanes de Wes Anderson
Par Thomas Sotinel
Le premier film du cinéaste, échec commercial en 1996, sort pour la première fois en France.
En France, l’histoire de Wes Anderson commence avec Rushmore, sorti fin 1999. Pour être exact, il faut situer l’origine de la trajectoire exorbitante du cinéaste cinq ans plus tôt, au Texas, avec la projection au Festival de Dallas d’un court-métrage intitulé Bottle Rocket. Interprété par une fratrie alors inconnue, les Wilson (Owen, Luke et Andrew), ce bref film fit son chemin jusqu’à Sundance, où il attira l’attention d’une productrice bienveillante, Polly Platt, collaboratrice du cinéaste James L. Brooks.
Sous le haut patronage du réalisateur de Tendres Passions (et producteur des Simpson), Wes Anderson mena à bien la transmutation de son court-métrage en un premier long-métrage qui creusa comme peu de films l’ont fait le fossé entre la critique (qui souvent l’encensa) et les spectateurs (qui restèrent chez eux par millions).
Chemin parcouru de Houston au Japon
Plus de deux décennies après cette sortie américaine, glorieuse et calamiteuse, voici enfin Bottle Rocket sur les écrans français. Si l’on vient de voir le neuvième long-métrage de Wes Anderson, L’Ile aux chiens, on pourra s’amuser à mesurer le chemin parcouru de Houston, ville natale du réalisateur, au Japon, théâtre de sa dernière fantaisie.
De toute façon, on trouvera en cet essai un exemple juvénile, d’un comique tendre et maîtrisé, de cette effervescence qui a saisi le cinéma indépendant américain au tournant du siècle avec l’émergence de Paul Thomas Anderson, Spike Jonze, Darren Aronofsky…
On a du mal aujourd’hui à discerner les racines texanes de Wes Anderson dans la marqueterie Mitteleuropa du Grand Budapest Hotel ou l’orientalisme minutieux de L’Ile aux chiens. Son premier long-métrage a, entre autres mérites, celui de proposer la genèse du petit monde que le cinéaste a bâti de film en film.
Bottle Rocket s’ouvre sur une évasion. Anthony (Luke Wilson) séjourne dans un établissement de soins psychiatriques pour – on l’apprendra plus tard – « épuisement ». Dignan (Owen Wilson, également coscénariste) a décidé de l’aider à s’en évader, au mépris du fait qu’Anthony a été hospitalisé de son plein gré et qu’il est libre de ses mouvements. Pour ne pas contrarier celui qui est plus qu’un ami, un frère, le patient sort par la fenêtre à l’aide de draps noués, avec l’accord du médecin chef. La lumière que jette cette ouverture absurde sur les deux héros vaut tous les dialogues d’exposition. Anthony est un garçon fragile et séduisant, toujours soucieux de ménager les uns et les autres. Dignan ne vit que par un code d’honneur du hors-la-loi, sans doute hérité des grands bandits texans, qui seul peut donner à sa vie la structure rigoureuse et la dimension épique auxquelles il aspire.
Un projet millimétré
Lorsque, quelques plans après l’évasion, Dignan fait lire à Anthony un cahier calligraphié sur lequel il a détaillé son plan de vie pour les soixante-quinze années à venir – une existence faite de braquages audacieux et d’associations avec des malfaiteurs de haut vol –, on ne peut s’empêcher de penser que Wes Anderson (qui n’avait alors pas encore 30 ans) trimballait lui aussi un projet millimétré qui prévoyait aussi bien sa collaboration au long cours avec Bill Murray que sa fortune critique et publique en France.
Pour donner corps à ces chimères, les deux amis recrutent un troisième larron, cambriolent le domicile familial d’Anthony, se cachent dans un motel où ce dernier tombe irrémédiablement amoureux d’une femme de chambre paraguayenne avant de solliciter et d’obtenir le patronage d’un truand chevronné, Mr. Henry, incarné par James Caan, sous l’égide duquel ils dévalisent un entrepôt frigorifique. Au fil de séquences dont l’enchaînement semble obéir à un compromis historique entre l’horlogerie et la science des rêves, on aperçoit ou on entend quelques présages des films à venir : un portrait de Jacques-Yves Cousteau, des rangées de soldats de plomb, une chanson méconnue des Rolling Stones (2000 Man).
L’enchantement évoqué ci-dessus fut chichement partagé en 1996. La Columbia, que James L. Brooks avait convaincue de financer le film, enregistra, lors des projections tests, les réactions les plus négatives de l’histoire du studio. Et malgré quelques critiques dithyrambiques, Bottle Rocket ne rapporta qu’une fraction des 5 millions de dollars de son confortable budget. Mais Wes Anderson, comme Dignan, avait un plan, son film suivant, Rushmore, le prouva.
Bottle Rocket - Trailer
Durée : 01:30
Film américain de Wes Anderson (1996). Avec Owen Wilson, Luke Wilson, James Caan (1 h 31). Sur le Web : www.parkcircus.fr/films/5996-bottle-rocket