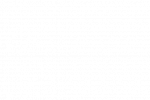En Tunisie, des élections municipales historiques accueillies sans enthousiasme

En Tunisie, des élections municipales historiques accueillies sans enthousiasme
Par Frédéric Bobin (Metlaoui, envoyé spécial)
Le 6 mai, la démocratie va enfin pouvoir s’ancrer au niveau local. Mais dans les régions intérieures sinistrées, la résignation semble l’emporter.
Il n’y a pas beaucoup de fièvre autour de l’ancien « quartier européen » de Metlaoui, dans l’ouest de la Tunisie. Un village dans la ville, enclave de maisons de toits de tuile rosâtre d’où émerge une église désaffectée. On l’appelait le « Petit Paris » à l’époque de l’âge d’or du phosphate, mis en exploitation par les Français à la fin du XIXe siècle. Le quartier est bordé d’un convoyeur, long boyau de tôle qui serpente au-dessus de la cité fanée par les poussières acides, l’un des quatre centres d’extraction du bassin minier de Gafsa. Autour s’étend la vaste steppe caillouteuse qui annonce, plus au sud, le Sahara tunisien.
On quête une ferveur électorale, des panneaux d’affichage, des processions politiques. Mais il n’y a qu’une torpeur vaguement résignée. Dimanche 6 mai, les Tunisiens sont invités à voter pour des élections municipales pourtant historiques. Depuis la révolution de 2011 qui a mis à bas le régime autocratique de Ben Ali, la transition démocratique va enfin pouvoir s’ancrer au niveau local, le chaînon qui manquait au « laboratoire tunisien ». Après les élections constituantes de 2011 et le double scrutin législatif et présidentiel de 2014, la Tunisie post-révolution va connaître sa quatrième consultation. « On respire l’air de la liberté », se félicite Sihem Dinari, une architecte que le parti islamiste Ennahda a choisie comme tête de liste.
« Il faut secouer nos dirigeants »
L’enjeu de proximité – élire 350 conseils municipaux – confère au scrutin un relief particulier. Après la dissolution en 2011 des anciens conseils municipaux élus sous Ben Ali, le pouvoir local incombait à des « délégations spéciales » composées de citoyens non élus et dirigées par un sous-préfet (le « délégué »). Ce déficit démocratique devrait en principe être comblé par le scrutin du 6 mai. L’inquiétude sourd néanmoins : la participation sera-t-elle au rendez-vous alors que les difficultés économiques et sociales – chômage à 15 %, inflation à 7 % – brouillent la perception que les Tunisiens ont de leur démocratie tant louée à l’étranger ?
La quarantaine énergique, Mohamed Dinari, tête de la liste indépendante Metlaoui notre avenir, veut démentir le scepticisme ambiant. « Il faut secouer nos dirigeants », clame-t-il alors qu’il pose pour une photo de groupe, flanqué de ses colistiers. A ses yeux, « secouer » le pouvoir de Tunis, c’est adresser un avertissement aux partis Nidaa Tounès (qualifié de « moderniste ») et Ennahda (« islamiste »), alliés au sein d’une coalition gouvernementale depuis 2015.
L’alternative pourtant tarde à se dessiner. Selon toute vraisemblance, les deux partis, qui concourent séparément, devraient se partager l’essentiel des municipalités. Ennahda – dont la rhétorique officielle s’est éloignée de son islamisme originel – dispose d’un enracinement à travers le pays et d’une machine militante sans équivalent. Quant à Nidaa Tounès, le parti du chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi, il a récupéré les réseaux de notables issus du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, dissout), l’ex-parti-Etat de Ben Ali. « Ils ont de l’expérience, souffle Mohamed Dinari. Ils savent faire de la politique. »
Sentiment victimaire
A Metlaoui, une préoccupation domine : l’avenir de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), l’entreprise hégémonique dans toute la région, véritable Etat dans l’Etat. Villages ouvriers, écoles, santé, salaires élevés, loisirs : la CPG, nationalisée en 1962 après l’indépendance, a longtemps dispensé un paternalisme social aujourd’hui en crise. « La population conserve une profonde nostalgie pour l’âge d’or de la CPG », soupire Façal Ahmidi, un cadre à la retraite.
A Metlaoui, comme ailleurs dans le bassin minier, les jeunes chômeurs s’agitent régulièrement pour décrocher un emploi au sein de la CPG ou de ses entreprises satellites, dont les effectifs ont bondi, depuis la révolution, de 9 000 à près de 30 000 salariés. Ces protestations récurrentes se nourrissent d’un sentiment victimaire, celui d’une population s’estimant spoliée par les élites de Tunis et du Sahel (littoral de Hammamet à Mahdia). « Les gros poissons nous volent notre ressource », grince Mohamed Housan Chebeb, porte-parole de la liste d’Harak Tounes Al-Irada, le parti de l’ancien président Moncef Marzouki (2011-2014).
Mais au-delà de cette cause commune, Metlaoui est traversée de lignes de fracture, les plus importantes étant de nature tribale. Celles-ci ne risquent-elles pas de s’approfondir avec la future affirmation d’un pouvoir municipal ? Sur les dix listes en lice à Metlaoui, trois émanent de partis politiques (Nidaa Tounès, Ennahda et Harak Tounes Al-Irada) et les sept autres sont « indépendantes ». Parmi ces dernières, les affiliations tribales sont assez marquées. Trois grandes tribus dominent à Metlaoui : les Awled Bouyahya, les Awled Jrediya et les Awled Slama.
Une coloration tribale
Hors les quartiers du centre-ville, chaque communauté vit dans son propre faubourg. Dans ses recrutements, la CPG a toujours pratiqué une politique non dite de quotas tribaux afin de préserver la paix sociale. Dans la foulée de la révolution de 2011, de violents heurts avaient pourtant opposé les Awled Bouyahya, « autochtones » qui tiennent à une forme de légitimité historique, aux Awled Jrediya, « immigrés » originaires des villes voisines de Tozeur et Nefta. Les affrontements, au fusil et à l’arme blanche, avaient fait une vingtaine de morts. Une manipulation d’éléments de l’ancien régime déchu avait alors été évoquée par nombre d’habitants.
Sept ans plus tard, la situation s’est apaisée, mais les identifications communautaires demeurent. « Malheureusement, ce fait tribal est une vérité », observe Ezzedine Bacouri, tête d’une liste indépendante. Tous les candidats l’admettent, tout en relativisant son importance. « Oui, le facteur tribal existe, mais il ne sera pas décisif », dit Mohamed Dinari, de Metlaoui notre avenir. « Les habitants ont oublié les affrontements de 2011 », souligne Abderahman Shimi, tête de liste de Nidaa Tounes. « Nous sommes dans l’obligation d’oublier car nous sommes voisins », abonde Basset Hlayem, tête d’une liste indépendante.
A sa manière, la gravité du conflit de 2011 a vacciné Metlaoui contre le péril d’un tribalisme débridé. Mais dans les autres régions de la Tunisie intérieure, aucune mémoire traumatique de ce type ne vient jouer le rôle de garde-fou et la crainte que des enjeux municipaux prennent une coloration tribale est réelle. « Le fait tribal dans ces élections est ambigu, analyse Hamza Meddeb, chercheur à l’Institut universitaire européen de Florence. D’un côté, il assure une représentativité démocratique des groupes sociaux. Mais de l’autre, il porte en germe le risque d’une conflictualité autour de la distribution des ressources, surtout en période de rareté ».