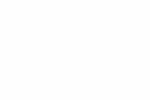Alerte à l’homophobie

Alerte à l’homophobie
Editorial. Alors que le nombre d’actes à caractère homophobe a augmenté en 2017, force est de constater le manque d’initiatives des politiques pour lutter contre ce phénomène.
Editorial du « Monde ». Depuis une trentaine d’années, l’homosexualité est passée de l’ostracisme – au mieux une maladie, au pire un « fléau social » ou un crime –, à la reconnaissance. Cette longue marche vers l’égalité a été jalonnée par la dépénalisation de l’homosexualité en 1982, l’instauration du pacs en 1999 puis celle du mariage entre personnes du même sexe en 2013. Depuis 2004, enfin, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité mentionne l’homophobie parmi les motifs de discrimination et pénalise les propos haineux, diffamatoires ou injurieux proférés en raison de l’orientation sexuelle.
L’homophobie, ses archaïsmes et sa violence n’ont pas disparu pour autant. Les chiffres en témoignent. En 2017, l’association SOS-Homophobie a encore enregistré 1 650 témoignages faisant état d’actes ou d’agressions physiques à l’encontre d’homosexuels ou de transsexuels. De son côté, le ministère de l’intérieur a recensé un peu plus d’un millier de crimes et de délits à caractère homophobe. Dans le pays de la liberté et de l’égalité, il n’est toujours pas possible de vivre son homosexualité librement et sans crainte.
Le constat est paradoxal. En effet, la France fête, le 17 mai (Journée internationale de lutte contre l’homophobie), le cinquième anniversaire de la loi sur le mariage entre personnes du même sexe. Malgré les polémiques virulentes soulevées à l’époque, le mariage pour tous est entré tranquillement dans les mœurs et a contribué à banaliser l’homosexualité. Militants et observateurs espèrent donc, chaque année, une baisse des plaintes pour actes homophobes.
Il n’en est rien. Certes, la libération de la parole peut expliquer en partie l’augmentation constatée ces dernières années par SOS-Homophobie. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, les agressions homophobes, de moins en moins tolérées, sont de plus en plus visibles et dénoncées. Les visages tuméfiés de victimes s’affichent. Les récits détaillés d’agressions ou d’injures sont relayés. Pourtant, par méconnaissance ou manque de temps, le caractère homophobe de certains actes, qui est une circonstance aggravante de nombreuses infractions, n’est pas toujours pris en compte. C’est évidemment préjudiciable pour les victimes, mais aussi pour la connaissance et la maîtrise du phénomène.
Embarras du gouvernement
Le constat doit alerter les pouvoirs publics. Certes, la lutte contre l’homophobie fait des progrès. Les circonstances aggravantes et délais de prescription pour les actes à caractère homophobe ou commis en raison de l’identité de genre sont désormais alignés sur ceux des actes racistes ou antisémites. Depuis 2016, la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (Dilcrah) a vu ses compétences étendues à la haine anti-LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels). La Dilcrah soutient 212 projets de lutte contre l’homophobie au niveau local.
Mais force est de constater que le sujet continue, peu ou prou, à embarrasser. En février, Joël Deumier, président de SOS-Homophobie, a dû dénoncer le « silence coupable » du gouvernement avant que le premier ministre ne condamne une série d’agressions homophobes. Ce combat n’a pas non plus fait l’objet de campagnes de communication à destination du grand public. Quant aux responsables des mondes politique, économique ou même culturel et médiatique qui revendiquent leur homosexualité, ils restent peu nombreux en France. Signe, hélas !, que la crainte des discriminations homophobes et les vieux tabous persistent.