Cannes 2018 : le jury s’est montré sensible aux causes à défendre
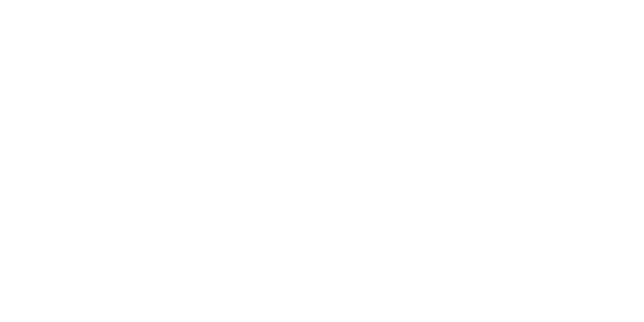
Cannes 2018 : le jury s’est montré sensible aux causes à défendre
Par Jacques Mandelbaum
Mise à part la Palme d’or attribuée au Japonais Hirokazu Kore-eda, le cinéma asiatique, qui a brillé lors de la 71e édition, n’a pas été récompensé à sa juste mesure.
Cannes 2018 : le palmarès en images
Durée : 03:29
Comme l’aura dit Edouard Baer lors de la cérémonie de clôture du 71e Festival de Cannes, samedi 19 mai : « On remballe ». Après douze jours de haute tension, d’amour, de misère et de souffrance imprimés en plus grand que la vie sur les écrans, de chefs-d’œuvre et de croûtes suspendus à un même rai de lumière, de tapis rouge et de défilés néo-babyloniens sur les marches du Palais, de selfies interdits mais contagieusement accrochés aux sourires de starlettes-minutes, de cortèges officiels conduits à cent mètres de là par des motards de la police chauffés à blanc, d’escabeaux et de badauds jetés en vrac sur la chaussée, d’agapes inaccessibles au commun des mortels.
Un contenu de cette page n'est pas adapté au format mobile, vous pouvez le consulter sur le site web
On décroche les panneaux publicitaires, on désagrège les sigles des firmes ornant les balcons, on karchérise les détritus générés par les visiteurs, on balaie la poussière de la scène du Grand Théâtre Lumière où l’actrice Cate Blanchett et son jury ont fait, comme chaque année, quelques heureux et au moins autant de malheureux, parmi lesquels les quatre représentants de la « French Team » (Stéphane Brizé, Yann Gonzalez, Christophe Honoré et Eva Husson). Tout cela passera vite, avant que cela ne recommence, presque aussi vite, pour la prochaine Palme d’or.
Le réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda sur la plage du Martinez à Cannes, le 13 mai 2018. / STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE »
Films à sujets
Il faut d’autant plus prestement, à l’approche de la nuit froide de l’oubli qui va ensevelir ses dernières braises, donner une image, un cliché lui-même promis à une courte vie, de cette édition 2018. Le palmarès rendu par le jury en constitue la version officielle, qui se révèle particulièrement sensible aux films à sujets et aux causes à défendre. Enfance saccagée pour la Palme d’or (Un air de famille, du Japonais Hirokazu Kore-eda) et le prix du jury (Capharnaüm, de la Libanaise Nadine Labaki). Revanche afro-américaine avec le Grand Prix (BlacKkKlansman, de Spike Lee). Apurement des comptes soviétiques avec le prix de la mise en scène (Cold War, de Pawel Pawlikowski). Soutien à un créateur assigné à résidence et parabole christique sur l’injustice du monde pour le double prix du scénario (Trois visages, de l’Iranien Jafar Panahi et Heureux comme Lazzaro, de l’Italienne Alice Rohrwacher).
La réalisatrice libanaise Nadine Labaki à l’hôtel Majestic à Cannes, le 17 mai 2018. / STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE »
Il n’est pas jusqu’aux prix d’interprétation attribués à l’actrice kazakhe Samal Yeslyamova (Ayka, du Russe Sergey Dvortsevoy) et à l’acteur italien Marcello Fonte (Dogman, de l’Italien Matteo Garrone) qui ne récompensent, en même temps que la prestation de leurs récipiendaires, l’engagement social et politique des films qui les portent. Quoique décernée par un autre jury, la Caméra d’or n’a pas échappé à cette fibre militante, en récompensant le premier long-métrage « LGBT », Girl, du Belge Lukas Dhont, porté par l’équivoque incandescence de son jeune acteur Victor Polster. Il ne restait qu’à accorder à Jean-Luc Godard et à son Livre d’image une « Palme d’or spéciale », qui confirme davantage qu’elle ne la lève sa marginalité dans la profession.
L’actrice kazakhe Samal Yeslyamova à l’hôtel Marriott à Cannes, le 18 mai 2018. / STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE »
Tout dans ce palmarès atteste donc d’une volonté d’ouverture aux maux du monde et d’une intention fortement revendicative, soulignée tant par les postures que les discours, au point que l’actrice italienne Asia Argento a littéralement tétanisé la salle par une intervention historiquement inouïe en ces lieux, dominée par la colère froide et l’appel, sinon à la vengeance, du moins à la justice. Rappelant avoir été violée par le producteur américain Harvey Weinstein durant le Festival de Cannes en 1997, elle a pointé un doigt sur la salle en prononçant cette diatribe : « Toute une communauté lui a tourné le dos, même ceux qui n’ont jamais dénoncé ces faits. Et parmi vous, dans le public, il y a ceux que l’on devrait pointer du doigt à cause de leur comportement envers les femmes, un comportement indigne de cette industrie, de n’importe quelle industrie. Vous savez qui vous êtes. Plus important encore, nous nous savons qui vous êtes ».
L’acteur italien Marcello Fonte à l’hôtel Majestic à Cannes, le 16 mai 2018. / STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE »
On comprendra que dans ce climat, les préoccupations artistiques aient pu passer au second plan. Non que les films récompensés ne soient pas dignes, pour certains d’entre eux, de leur prix. Le problème est que tous ne le sont pas et que la prime au sujet a manifestement brouillé la boussole esthétique nécessaire à une plus fine mesure du palmarès. Mais si une chose manque ordinairement aux palmarès, c’est bien la cohérence esthétique, rares étant les jurys qui trouvent en eux-même la capacité et l’audace de s’accorder en la matière. On en déduira que la synthèse politique est plus accessible que celle du goût.
Une édition en dents de scie
Cannes 2018 fut en tout état de cause une bonne année pour la compétition. L’édition, en dents de scie, présentait l’avantage de s’offrir à un jugement tranché plutôt qu’à l’indifférence inavouable qui accueille une sélection de basse intensité. Il y eut, en un mot, du meilleur et du pire. Le meilleur marque le grand retour de l’Asie sur le devant de la scène. Non qu’elle avait disparu, mais sa présence ces dernières années dans les festivals internationaux était plus disparate. Elle s’est rassemblée cette année à Cannes, pour apparaître de nouveau comme le plus grand laboratoire de formes cinématographiques en activité.
Le réalisateur chinois Bi Gan sur la plage du Majestic à Cannes, le 15 mai 2018. / STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE »
La Palme d’or accordée au Japonais Hirokazu Kore-eda pour son délicat et impertinent mélodrame sur les fondements de la famille a du moins cette vertu de nous le rappeler. Trois films en compétition – Les Eternels, du Chinois Jia Zhang-ke, Asako I & II, du Japonais Ryusuke Hamaguchi, Burning, du Coréen Lee Chang-dong – ont toutefois, à notre sens, dominé les débats esthétiques, l’intimisme radical qui les caractérise expliquant sans doute l’indifférence du jury à leur beauté. On pourrait d’ailleurs ajouter, hors compétition, le monumental documentaire de Wang Bing, Les Ames mortes, et, dans la section Un certain regard, le film-rêve de Bi Gan, Un grand voyage vers la nuit.
Qu’est-ce qui rend ces artistes asiatiques si forts et si prenants ? Sans doute leur poétique du vide et du plein, ce sens foudroyant de l’ellipse et de la litote qui, accusant l’absence, rend la présence si intense. Nul hasard si les films les plus catastrophiques de cette compétition sont a contrario construits sur une logique de l’accumulation et de la saturation : toujours plus de pathos, d’emberlificotements romanesques, de désinvolture avec le réel, de mauvais spectacle à bon compte. Les Filles du soleil, deuxième long-métrage d’Eva Husson, a concentré à cet égard tous les mécontentements, il y en eut pourtant d’autres.
Sélectionnée pour la première fois en compétition, la jeune réalisatrice gardera sans doute un mauvais souvenir de son passage. C’est que l’effet « montagnes russes » n’a pas non plus épargné les neuf nouveaux venus admis cette année en compétition, raison non suffisante pour disqualifier cette ouverture inédite. Leto, de Kirill Serebrennikov, Asako I & II, de Ryusuke Hamaguchi, Un couteau dans le cœur, de Yann Gonzalez et Ayka, de Sergey Dvortsevoy y furent du moins à leur place.
Le réalisateur russe Sergey Dvortsevoy à l’hôtel Marriott à Cannes, le 18 mai 2018. / STEPHAN VANFLETEREN POUR « LE MONDE »
Disparition et présence évaporée
Enfin, parmi la prolifération des sujets et des figures générés par les films, c’est avec netteté que se détache cette année le motif de la disparition. Disparition d’une mystérieuse blonde à Los Angeles (Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell), d’une fiancée avec laquelle on vient de s’établir (Asako I & II, de Ryusuke Hamaguchi), d’une fille crapuleusement enlevée (Everybody Knows, d’Asghar Farhadi), d’un garçonnet victime de la barbarie islamiste (Les Filles du soleil, d’Eva Husson), d’une amie d’enfance qu’on venait de séduire (Burning, de Lee Chang-dong), d’un nourrisson abandonné à la maternité (Ayka, de Sergey Dvortsevoy), d’un homme pour lequel on s’est sacrifié et qui vous rejette (Les Eternels, de Jia Zhang-ke).
Ce leitmotiv de la présence évaporée s’accorde sans doute avec ce que l’époque comporte d’indéchiffrable. Il n’en reste pas moins quelle est vieille comme le cinéma et dispensatrice d’éclatants chefs-d’œuvre (Sueurs froides, d’Alfred Hitchcock, L’Avventura, de Michelangelo Antonioni) au rayon moderne. Un personnage qui disparaît dans un film est toujours la promesse palpitante d’une quête, en même temps que le signe du constant commerce avec l’absence qui donne son aura à la présence cinématographique. On retrouve ici la raison pour laquelle le cinéma asiatique a si singulièrement brillé sur ce Festival de Cannes, à défaut d’y être récompensé à sa juste mesure.












