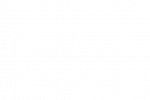Accueil des réfugiés : les habitants de Vichy, entre indifférence et solidarité

Accueil des réfugiés : les habitants de Vichy, entre indifférence et solidarité
Par Pablo Aiquel
Epaulés par un réseau associatif, les réfugiés soudanais installés dans la cité thermale souffrent pourtant du manque de contacts avec la population
Alsadig et Alrachid accompagnés de Pablo Aiquel dans un magasin Emmaüs, en avril 2018. / SANDRA MEHL POUR "LE MONDE"
Le week-end de la Pentecôte sera le dernier pour l’épicerie Les Cop’ins d’abord, à l’angle de la rue Voltaire et du boulevard Carnot, à Vichy. A deux pas de là, les demandeurs d’asile et réfugiés de la résidence Claudius-Petit, un foyer Adoma de près de 90 places, ne le savent pas encore, mais c’est grâce à eux que ce dépôt de pain, le dernier du quartier, n’a pas baissé le rideau plus tôt.
« J’ai été heureuse de les avoir comme clients. Sans eux, j’aurais mis la clé sous la porte il y a deux ans », assure Fabienne Dubois. « Eux », comme elle dit, sont des migrants venant d’Afrique et parfois du Moyen-Orient. Ils sont arrivés par dizaines en 2016 dans la cité thermale, et ont tout de suite représenté 70 % de sa clientèle.
« Ce sont des gens respectueux, je n’ai jamais eu de problèmes avec eux. Au début, on se parlait surtout avec les mains. Je les ai vus s’améliorer en français, assure la responsable de ce petit magasin. Certains sont partis, à Lyon, à Clermont-Ferrand et même à Brive. Ils passent dire bonjour quand ils reviennent. Je suis contente qu’ils puissent avancer. » Fabienne Dubois, elle, n’avancera plus avec Les Cop’ins d’abord. Elle a préféré mettre la clé sous la porte quand elle a appris qu’un supermarché allait ouvrir non loin, avant la fin de l’année.
« Ni pour ni contre »
Tous les commerces du centre-ville ont bénéficié de cette nouvelle clientèle étrangère : la boucherie halal L’Etal de l’Allier, dans cette même rue Voltaire, les tabacs de la gare et surtout le bureau central de la Poste, à une centaine de mètres de leur résidence. « La plupart ont un livret ou un compte chez nous, affirme une chargée de clientèle. Mais ils viennent aussi pour les abonnements téléphoniques avec beaucoup d’Internet et sans engagement. » Elle estime qu’il ne se passe pas un jour sans qu’elle voie des réfugiés, et se dit impressionnée par la solidarité dont ils font preuve. « Les premiers arrivés accompagnent les suivants », explique-t-elle.
Certains habitants de Vichy, membres de l’association Réseau Vichy solidaire, offrent des cours de français aux demandeurs d’asile. D’autres, comme Martine Ghazali, leur ont ouvert leur appartement pour un atelier cuisine. Pour faire leurs courses, les plus démunis vont à la Croix-Rouge, au Secours catholique ou aux Restos du cœur, tous situés à une dizaine de minutes de marche, dans cette petite ville où tout se fait à pied. D’autres préfèrent pousser un peu plus loin, jusqu’aux boutiques discount Lidl ou Aldi. « Au moins les dates des produits ne sont pas dépassées », dit en souriant Abubakr, d’origine soudanaise.
Est-ce à dire que les demandeurs d’asile ont été les bienvenus à Vichy, malgré la réputation de la ville d’être plutôt âgée et conservatrice ? Michel Pourieux, bénévole au Secours catholique. hausse les épaules. « La plupart des gens ne sont ni pour ni contre, il y a surtout de l’indifférence », dit-il.
Une indifférence qui n’a pas échappé aux réfugiés. Faizal, 23 ans, soudanais lui aussi, a suivi les 200 heures de français proposées par l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ainsi qu’une formation de trois mois financée par Pôle emploi afin d’améliorer l’utilisation de la langue en vue d’une insertion professionnelle. Ce qui lui manque le plus ? « L’intégration. C’est difficile de trouver des Français avec qui parler. J’apprends toute la journée mais, le soir, je me retrouve avec d’autres Soudanais, et j’oublie », soupire-t-il.
Comme lui, près d’une vingtaine de réfugiés soudanais ont élu domicile dans les anciens hôtels du vieux Vichy devenus des résidences à meublés, des studios pour les curistes ou les étudiants du Cavilam – une école de français pour les étrangers –, entre la place d’Allier et la rue de la Laure. En attendant de trouver mieux ailleurs. Dans six mois, Faizal espère partir « vers Lyon ou Toulouse, parce que, là, il y a plus de travail », explique-t-il, assis sur le lit de sa chambre au lambris en bois.
Figure d’exception
Anwar, voisin d’un immeuble proche, adore les bords de l’Allier pour jouer au foot dans les parcs ou se balader le long de la rivière. Après sa formation, il a décroché un contrat d’insertion dans une entreprise de recyclage de palettes en bois. « Je vois seulement les Français au travail, après il n’y a pas grand-chose, et je passe de plus en plus de temps sur l’ordinateur. Parfois, je vais manger un kebab dans un restaurant », raconte-t-il, un peu désappointé, après deux années passées à Vichy.
La mairie, à droite depuis toujours, ne fait rien pour faciliter l’intégration des réfugiés, considérant qu’ils relèvent de l’Etat et non de la commune ou de la communauté d’agglomération. Même après l’obtention de leur statut de réfugiés, Anwar, Faizal et leurs semblables n’ont pas été invités aux réceptions annuelles pour les nouveaux habitants de la ville. Avant cela, pendant la longue attente de leur statut, ils n’ont pas eu accès aux services publics locaux, pas même aux forfaits de bus, qui leur auraient été très utiles pour aller jouer au foot au parc omnisports.
De fait, le destin de Poriya, un Iranien de 22 ans, pas encore réfugié mais inscrit en BTS management au lycée Albert-Londres, fait figure d’exception. Sportif, il a intégré le club de kayak de Bellerive-sur-Allier, en rive gauche de la rivière. Surprise : c’est lui, regard concentré, pagayant avec force, qui figure sur l’affiche de la course en ligne prévue le dimanche 3 juin sur le lac d’Allier. Ramer, belle métaphore des efforts d’intégration des réfugiés à Vichy.
Pablo Aiquel, journaliste et exilé solidaire
Dès le biberon, Pablo Aiquel a été nourri à l’exil. Ce journaliste indépendant de Vichy, un des pivots de l’intégration des réfugiés soudanais dans sa ville, est né au Chili en 1974. En 1977, il déménage pour le Venezuela où son père part travailler comme ingénieur naval, avant de venir en France à tout juste 18 ans. « J’avais une bourse du gouvernement vénézuélien pour faire mes études supérieures après une année d’apprentissage du français », explique-t-il.
Le diplôme de l’école de journalisme de Lille en poche, Pablo Aiquel rentre en 1997 au Venezuela où il travaille six années comme correspondant pour RFI, Libération ou Le Monde diplomatique, en parallèle à son travail pour El Universal puis El Nacional, deux médias vénézuéliens de référence. Mais le coup d’Etat du 11 avril 2002 rebat les cartes et fait prendre un virage à sa vie. « Le terme même de “coup d’Etat” a été rapidement quasiment banni des colonnes. Beaucoup de mes collègues sont partis du journal et moi, je me suis retrouvé au service des sports… », explique t-il.
Il décide alors de venir s’installer durablement en France, émigration facilitée par son mariage avec une Française quelques années auparavant. Mais pour Pablo, le rapport à l’exil remonte bien avant, puisque ce franco-vénézuelo-chilien reconnaît faire partie d’« une famille d’éternels déracinés » dont les ancêtres ont quitté le Liban à l’aube du XXe siècle.