« Plan A », « plan B » et « système D » pour contourner les blocages d’examens
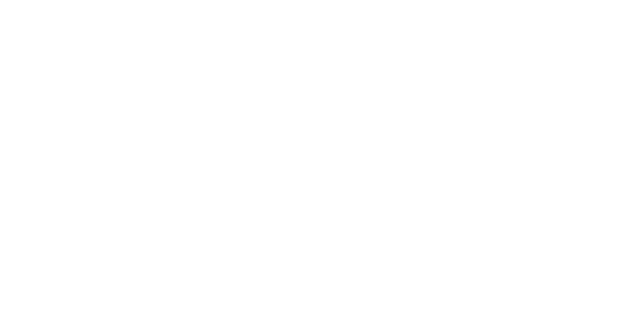
« Plan A », « plan B » et « système D » pour contourner les blocages d’examens
Par Eric Nunès
Malgré les efforts continus des universités pour maintenir les partiels du second semestre 2018, les conséquences sont réelles et souvent pénibles pour les étudiants qui avaient prévu, dès juin, un travail, un déplacement ou une candidature à un master.
Ce sont des flammes que l’on croit voir dans les yeux d’Ines, ce mercredi 4 avril à l’université de Nanterre. Cette jeune femme pressée, étudiante en 3e année de droit, a traversé la banlieue parisienne pour la dernière série de partiels de sa licence. Elle a tout calculé, préparé, prévu : elle terminera ses examens dès le mois de mai, ses bonnes notes lui donneront accès au master sélectif qu’elle a choisi, et en juin elle fera ses premières armes professionnelles dans le cadre d’un stage en entreprise qu’elle vient de décrocher. En juillet, elle bossera, un boulot nécessaire pour envisager quelques semaines de vacances et la prochaine rentrée universitaire avec un peu d’argent de côté.
Mais ce matin de printemps, elle voit les beaux rouages de son plan se gripper. Face à quelques tables et chaises disposées en vrac devant les portes de la salle d’examen et quelques dizaines d’étudiants bloqueurs qui en interdisent l’accès, la future juriste projette, à haute voix, le pire : des examens reportés, un stage qu’il faudra annuler, un diplôme dévalué et ses chances d’intégrer le master compromises. « Je n’ai pas bossé comme une malade pendant trois mois pour être stoppée le jour J ! » s’exaspère-t-elle. Deux mois plus tard, le sombre scénario qu’elle a imaginé s’est déroulé point par point.
A Paris, Toulouse, Nantes, Rennes… Ils sont des dizaines d’étudiants à témoigner sur LeMonde.fr de la cascade de conséquences malheureuses que les blocages de campus et d’examens ont eues sur leurs projets. Dès la première semaine du mois, « nous avons pris acte de l’impossibilité de faire passer les examens sur le campus et décidé la délocalisation », souligne Aurélien Saïdi, vice-président en charge du numérique à l’université de Paris-Nanterre. D’autres tentent de maintenir la tenue des partiels sur les campus. Tous doivent faire une réalité de l’injonction de la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal : « Les examens se tiendront ».
« Conditions catastrophiques »
Pourtant, « sur les sites de Malesherbes et Clignancourt, les partiels sont à chaque fois annulés et décalés du fait de la présence d’une trentaine de bloqueurs, corollaire de la présence des CRS et l’usage de gaz lacrymogène », raconte Joris, étudiant en sociologie à Paris-IV. Idem dans les centres d’examens d’Arcueil (Val-de-Marne) ou ceux qui sont improvisés à Saint-Ouen ou Rungis, au nord et au sud de Paris. Dans le centre René-Cassin où doivent composer les étudiants en philosophie, « nous avons démarré les épreuves dans les vapeurs d’ammoniac déversé par les bloqueurs pour faire annuler la tenue de l’examen », témoigne Diane, étudiante à Paris-I.
Juliette, en deuxième année de LEA à l’université de Nantes, se remémore également des « conditions catastrophiques : la présence de CRS, de gendarmes mobiles à l’entrée. Du bruit, des chants et des hurlements en salle d’examen ». Après trois journées de capharnaüm, « la direction indique que les partiels sont reportés », soupire-t-elle. Pris en étau entre les bloqueurs et la direction de l’université, « nous avons l’impression d’être le punching-ball des deux camps », dénonce Xavier, en troisième année de sciences politiques à Paris-I.
Quand le « plan A » du passage des examens dans les campus a échoué, que le « plan B » d’une délocalisation des examens s’est heurté également aux bloqueurs, les directions d’université s’échinent à trouver de nouvelles alternatives. « Le système D », reconnaît Aurélien Saïdi, lorsque chaque université compose en fonction de ses moyens et de la bonne volonté des enseignants impliqués.
« Nouvelles modalités »
A l’université de Nantes, « notre priorité a été de tenir le calendrier initial afin de ne pas pénaliser les étudiants qui avaient prévu, dès juin, un travail, un déplacement ou une candidature à un master. Fort de ça, chaque UFR a décidé des nouvelles modalités d’examens », explique-t-on à la direction de l’université de Nantes. Pour voir validé leur second semestre, certains étudiants doivent rendre des dossiers, d’autres passer des épreuves en « distanciel » sur la plate-forme numérique de l’établissement.
Idem à Nanterre, où, suite au blocage du centre d’examen d’Arcueil le 11 mai, « on a décidé de faire passer les examens en ligne », explique Aurélien Saïdi. Mais pas seulement. En effet, l’université est parvenue à esquiver l’action des bloqueurs en faisant passer des examens en « présentiel » à des petits effectifs d’étudiants en toute discrétion, comme en mathématiques par exemple ou des étudiants ont pu passer leur partiel sur le campus de Jussieu.
A Toulouse-Le Mirail également, la plupart des examens sont réalisés à distance. Joy, 21 ans, en deuxième année d’anthropologie, doit rendre dans les prochaines semaines plusieurs dossiers qu’elle composera depuis son lieu de vacances ; et d’autres épreuves ont lieu sur Internet. Selon la direction de l’établissement, 14 % des examens seulement sont maintenus sous la forme classique du devoir sur table.
Noémie, étudiante en L3 de lettres modernes au Mirail, fait partie de cette minorité qui va devoir se soumettre aux conditions traditionnelles d’un examen. Une satisfaction pour la jeune femme, selon qui « garder les partiels, c’est s’assurer de la valeur du diplôme ».
« Il n’y aura pas d’examens en chocolat », assurait Emmanuel Macron, président de la République, lors de son intervention télévisée du 12 avril. Les examens sur dossier ou à distance « ne sont pas des examens allégés », jure-t-on également à la direction de l’université de Toulouse, qui doit pourtant composer avec un autre facteur : « celui de ne pas pénaliser les étudiants », déjà harassés par un semestre où ils ont été bringuebalés, semaine après semaine, par les injonctions contradictoires des manifestants, des enseignants et des directions d’université.
« Un quart des cours dispensés »
Quid de la valeur de leur diplôme selon les premiers concernés ? « Aucune, répond sèchement Marine, étudiante en L3 de sociologie à Nantes. Les cours sur lesquels j’ai bûché, je n’ai pas été évaluée dessus et au second semestre, seulement un quart des cours ont été dispensés. » Même effarement pour Xavier, en troisième année de sciences politiques à Paris 1, qui passe ses épreuves en distanciel lors d’un partiel « maintenu, même sans cours ». Incompréhension totale également pour Juliette, en deuxième année de LEA à Nantes : « Dans certaines matières je n’ai jamais eu de cours, je ne sais même pas quel est le sujet ! »
Que ce soit à distance, en « présentiel » ou sur dossier, sur quoi les étudiants peuvent-ils être évalués dans ce contexte chahuté ? « Les étudiants seront notés sur leur connaissance des contenus auxquels ils ont eu accès », répond un cadre universitaire nantais. « Il faut tenir compte des circonstances exceptionnelles de cette année universitaire », poursuit un autre, à Toulouse.
Une « souplesse » qui n’est pourtant à l’ordre du jour dans toutes les universités… Diane, étudiante à Paris-I en philosophie, a reçu mercredi 6 juin, après 11 h, une convocation pour passer ses partiels le lendemain à 14 h 30. « J’ai appelé l’administration : ceux qui ont un contrat de travail ou une convention de stage devront aller au rattrapage si jamais ils ne se présentent pas », affirme la jeune femme. Interrogée par Le Monde, la direction de l’université n’était pas en mesure de confirmer ou d’infirmer.
Enfin, les conséquences d’un semestre blanc ou en pointillé auront des conséquences au-delà de cette année 2017-2018. « Pour m’inscrire dans un master sélectif, on me demande les résultats de l’année entière, que je n’ai pas », s’étrangle Maria, en troisième année de droit à Nanterre et qui, comme beaucoup d’autres étudiants, se sent victime collatérale d’une réforme qui, au départ, ne la concernait pas.







