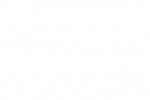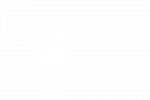Au Mali, un projet de loi d’entente nationale qui suscite la controverse

Au Mali, un projet de loi d’entente nationale qui suscite la controverse
Par Morgane Le Cam (Bamako, correspondance)
Le texte préconise l’abandon des poursuites pénales contre les auteurs de crimes et de délits commis lors de la crise qui a débuté en 2012.
Le premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, en visite à Menaka, dans le nord-est du pays, le 9 mai 2018. / SEBASTIEN RIEUSSEC / AFP
Quel est le prix de la réconciliation ? Faut-il, pour assurer la concorde civile, amnistier les auteurs de crimes commis au Mali depuis 2012 ? Depuis l’adoption en conseil des ministres du projet de loi d’entente nationale, le 31 mai, cette lancinante question est à nouveau posée. La version du texte que Le Monde Afrique s’est procurée prévoit en effet « l’exonération des poursuites pénales engagées ou envisagées contre les personnes ayant commis ou ayant été complices (…) de crimes ou délits (…) survenus dans le cadre des événements liés à la crise née en 2012 ». La disposition devrait s’appliquer à ceux qui ont cessé les hostilités depuis la signature de l’accord de paix, en juin 2015, mais pas seulement. L’article 15 du projet de loi élargit l’exonération des poursuites à toute personne déposant les armes dans un délai maximum de six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte.
Cependant, tous les actes ne sont pas effacés. Les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de viols et de « tout autre crime réputé imprescriptible » demeurent dans le collimateur de la justice. Mais, pour Ramata Guissé, d’Amnesty International Mali, la définition des faits dont les auteurs pourraient, selon le texte, être amnistiés est trop large : « Avec cette loi, ce sont de grands criminels qui vont être exonérés de poursuites. Ce n’est pas une loi d’entente nationale mais de mésentente nationale. Ce texte va diviser encore davantage les Maliens. Imaginez ce que vont penser les victimes, soupire-t-elle. Elles vont perdre espoir et pourraient chercher à se venger ! »
« Du sang sur les mains »
En janvier, le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta (dit « IBK ») s’était pourtant voulu rassurant en révélant l’imminence de ce projet de loi. Celui-ci « ne constitue ni une prime à l’impunité, ni un aveu de faiblesse. Encore moins un déni du droit des victimes », assurait-il, tout en affirmant que ceux qui ont « du sang sur les mains » ne seraient pas graciés.
Mais comment identifier ces derniers si les poursuites judiciaires sont abandonnées ? « Les enquêtes sont un préalable nécessaire afin de se préserver de l’arbitraire que constituerait la délivrance d’une amnistie sans fondement », ont affirmé trente-deux organisations de défense des droits humains, dans une lettre ouverte adressée au président de la République, en mars. L’avant-projet de loi venait alors d’être remis au premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga. Ce dernier, « soucieux du caractère inclusif de ce [texte] important » selon son entourage, a demandé au ministre de la réconciliation nationale de recevoir les organisations signataires de cette lettre ouverte, la semaine prochaine.
Pour les défenseurs des droits humains, la réconciliation et la paix ne pourront prospérer sans justice. « Nous ne voulons pas que ce texte arrive à l’Assemblée nationale, fulmine Drissa Traoré, coordinateur du programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et de l’Association malienne des droits de l’homme (AMDH). Nous ne sommes pas contre une loi d’entente nationale, mais il faut que cela vienne après les enquêtes judiciaires. Or ces enquêtes piétinent. »
« Une loi purement politique »
Drissa Traoré affirme qu’un des seuls dossiers ayant abouti devant la justice malienne est celui d’Aliou Mahamane Touré, condamné en août 2017 à dix ans de prison. L’ancien commissaire islamique de Gao avait été reconnu coupable d’« association de malfaiteurs », de « détention illégale d’armes de guerre et de munitions », d’« atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » et de « coups et blessures aggravés ». Mais la chambre d’accusation ne l’avait pas inculpé de « crime de guerre ». Aliou Mahamane Touré aurait donc pu bénéficier de cette loi d’entente nationale, si elle avait été en vigueur. « Ce cas est une jurisprudence de référence, dans le mauvais sens du terme, estime le défenseur des droits humains. Cela montre tout le problème de cette loi d’entente. Tout dépend de la qualification des charges que les juges vont retenir. »
Selon son analyse, le calendrier de préparation du texte ne doit rien au hasard : « C’est une mesure d’apaisement, un signal envoyé aux groupes armés à moins de deux mois de l’élection présidentielle [dont le premier tour a été fixé au 29 juillet]. Ce texte est peut-être une manière de relâcher des prisonniers dont ils revendiquent la libération et ainsi de récupérer leur électorat », analyse Drissa Traoré. « C’est une loi purement politique, tranche Ramata Guissé. IBK veut coûte que coûte se faire réélire et compte, par ce texte, courtiser les gens du Nord afin qu’ils aillent voter pour lui. »
Cette crainte rappelle le dilemme qui traverse la classe politique malienne. Jusqu’où faut-il négocier avec les groupes armés, y compris djihadistes, pour mettre un terme au conflit ? La conférence d’entente nationale qui s’était tenue du 27 mars au 2 avril 2017 avait recommandé de « négocier avec les extrémistes religieux du Nord, en l’occurrence Iyad Ag-Ghali, tout en préservant le caractère laïc de l’Etat ». Cette option a depuis été publiquement écartée par le pouvoir.
Mais à l’aube de la présentation du projet de loi devant l’Assemblée, les mots prononcés à l’époque par le ministre de la réconciliation résonnent un peu plus fort. A l’issue de la conférence d’entente nationale, Mohamed Al-Moctar avait déclaré : « Tout enfant de ce pays qui veut déposer les armes ou quitter cette engeance extrémiste, djihadiste, est le bienvenu chez lui. »