Non, Rafael Nadal n’a pas rendu Roland-Garros ennuyeux
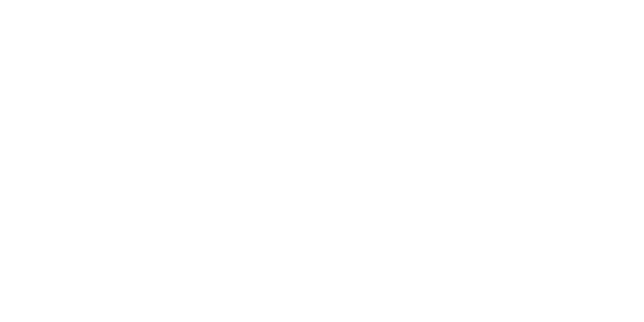
Non, Rafael Nadal n’a pas rendu Roland-Garros ennuyeux
Par Elisabeth Pineau
Vainqueur pour la onzième fois, Rafael Nadal aurait tué tout suspense et spectacle. Mais c’est être peu reconnaissant face à la contribution de l’Espagnol au tennis, estime notre journaliste Elisabeth Pineau.
Billet. Gagner la décima, c’était pour lui « très spécial ». Gagner la undécima, ce fut donc logiquement « très, très spécial ». Rafael Nadal a remporté dimanche 10 juin un onzième titre à Roland-Garros et « c’est sans doute l’un des plus grands exploits de l’histoire du sport », dixit le vaincu, Dominic Thiem. C’est presque le double de Björn Borg, longtemps détenteur d’un record qu’on croyait imbattable (6). Et autant que Lendl, Wilander, Kuerten, Federer et Djokovic réunis. Voilà pour le vertige.
Mais tous les lecteurs n’apprécient pas la statistique à sa juste valeur. « Je regarderai de nouveau le tournoi de Roland-Garros quand Nadal aura pris sa retraite, que j’espère imminente », commentait l’un d’eux hier soir. « Roland-Garros n’a jamais été aussi peu intéressant que depuis l’ère Nadal. Plus de suspense, jeu ennuyeux et stéréotypé du fond du court, adversaires frileux. Bref, Nadal a vraiment tué ce tournoi », écrivait un autre des contempteurs de l’Espagnol.
Pour le jeu stéréotypé de fond de court, on repassera. Notre ami lecteur a dû laisser la télé à la cave depuis dix ans. « Le taurillon des premiers sacres n’a plus grand-chose à voir avec le Nadal de 32 ans. Le joueur qui pilonnait l’adversaire jusqu’à ce que faute s’ensuive et galopait comme un dératé après chaque balle prend désormais le temps d’analyser. Les interminables rallyes ont laissé place à des schémas de jeu réduits. Lui, le défenseur-né, est aussi devenu un des meilleurs volleyeurs du circuit », écrivions-nous encore il y a quelques jours pour expliquer comment, en treize ans, Nadal avait réinventé Nadal.
« Demolition party »
Passons. Aujourd’hui, l’objet du débat n’est pas là. Pour le manque de suspense, en revanche, on peut difficilement lui donner tort. Comme en 2017, comme en 2013, comme en 2011, comme en 2010, comme en 2008… bref comme ce fut le cas presque invariablement, la finale d’hier a été le plus souvent léthargique (on surprit même un confrère piquer un roupillon au milieu du premier set, mais peut-être était-ce les effets de la digestion ou tout simplement le contrecoup de la quinzaine ?).
Dimanche à l’heure de l’apéro, le court Philippe-Chatrier, qui vivait ses dernières heures avant d’être en partie détruit, organisait sa « demolition party ». La deuxième de la journée, après celle orchestrée un peu plus tôt par le bulldozer Nadal face à Thiem (6-4, 6-3, 6-2). Pour avoir sa dose de dramaturgie et assister à une finale alliant niveau de jeu, audace et retournements de situation, comme ces dernières années, il fallait se tourner du côté des dames – en l’occurrence de Sloane Stephens et Simona Halep (victorieuse en trois sets 3-6, 6-4, 6-1).
Mais banaliser les onze victoires de Rafael Nadal, c’est nier combien l’Espagnol est un modèle d’abnégation en faveur de son sport. Avec Roger Federer, aujourd’hui sur le circuit, il est le seul à ne pas s’habituer à la victoire (les Français aussi ne s’habituent pas à la victoire, mais ne nous y attardons pas). Ou, plus exactement, à exécrer à ce point la défaite. Toni Nadal ne disait pas autre chose il y a quelques semaines : « Ce qui singularise la génération des Djokovic, Rafael, Federer et les autres, c’est qu’ils étaient prêts à faire plus de concessions. Leur engagement est total, c’est pour ça qu’ils ont gagné plus que les autres. »
Et qu’ils continuent de le faire, la trentaine passée (Nadal a fêté ses 32 ans le 3 juin) ou bien tassée (Federer aura 37 ans le 8 août). Comme on a pu le voir encore durant cette quinzaine et de façon patente contre Schwartzman, Del Potro et Thiem, Nadal n’est jamais rassasié. Il ne veut pas seulement gagner le match, il veut gagner tous les points. Il ne veut pas seulement tuer le match, il veut achever l’adversaire. Le scénario est peut-être inéluctable et le spectacle déprimant, il est tout à la fois fascinant. Quand la proie halète, quand elle essaie de se sortir la tête de l’eau, l’Espagnol lui saute à la gorge, le lift chaque fois un peu plus tranchant en coup droit. Il démoralise sa victime, l’assomme puis l’asphyxie jusqu’à ce que mort s’ensuive.
ALL the feels for @RafaelNadal.
#RG18 https://t.co/SD4f0mKSFa
— rolandgarros (@Roland-Garros)
Une fois l’affaire pliée, Nadal reprend instantanément forme humaine. Il fallait voir ses sanglots sur le podium, hier, au moment où les 15 000 spectateurs lui ont réservé une standing ovation. L’émotion, sincère, avait été la même en 2005 à l’heure de conquérir son premier titre. « Mais c’est normal, la victoire n’a rien de facile, il sait trop bien tous les efforts que ça demande pour y parvenir », réagit l’oncle Toni, de retour dans le box pour l’occasion, à la place qui fut la sienne pendant vingt-sept ans.
Reconnaissance par ses pairs
Tout au long de la semaine, son neveu n’a jamais voulu se projeter et à mesure que la finale approchait, il a catégoriquement rejeté le terme de « routine ». « Le fait d’être toujours présent et de se hisser en finale de Roland-Garros, c’est tout de même extraordinaire, même si sur le papier ça vous paraît logique. Il ne faut surtout pas voir les choses ainsi, sinon on rentre dans une espèce de routine, de spirale…, a-t-il insisté après sa demi-finale contre Del Potro. Au contraire, il faut profiter en pensant à toutes les blessures et tous ces moments compliqués par lesquels vous êtes passé. » C’est précisément pour avoir inlassablement pris point après point, set après set et match après match depuis le début de sa carrière, que le numéro un mondial s’est forgé son mental et a fortiori son palmarès.
A Roland-Garros, depuis 2005, il y a Nadal et les autres, relèvent avec grande acuité les plus critiques des observateurs. On déplore le manque de concurrence pour relancer l’intérêt du tournoi ? Mais tenir l’Espagnol pour unique responsable, c’est lui faire un curieux procès d’intention : c’est à ses adversaires de hisser leur niveau de jeu, pas à Nadal de baisser le sien.
La reconnaissance par ses pairs, elle, en revanche, est unanime à en juger par les messages venus saluer sa 17e victoire en Grand Chelem. « Ce qui m’impressionne le plus dans tout ça, c’est qu’il affiche encore la même faim, il a même encore plus d’appétit que la première fois qu’il a gagné. Sa motivation est intacte et ça c’est juste hallucinant. On ne reverra plus jamais ça », disait Robin Söderling, son bourreau de 2009, cette semaine. Au lieu de le déplorer, peut-être faut-il simplement en mesurer la portée ?
The year is 2038. 58 year old Rafa Nadal has won The French Open again. https://t.co/IT3w2Addh3
— ekotchi (@Eric Kotchi)







