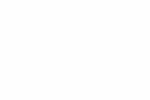Europe : le président français a-t-il bien choisi sa bataille ?

Europe : le président français a-t-il bien choisi sa bataille ?
Par Cécile Ducourtieux (Bruxelles, bureau européen)
En ralliant Angela Merkel à sa cause sur « son » budget de la zone euro, Emmanuel Macron a engrangé une victoire symbolique, sans enrayer pour autant la crise migratoire qui menace la cohésion de l’UE.
La chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, Emmanuel Macron, à Meseberg, le 19 juin. / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS
Emmanuel Macron savoure manifestement le moment, mardi 19 juin, au château de Meseberg, où il tient sommet avec Angela Merkel. Enfin ! Après neuf mois d’intenses tractations, et trois discours majeurs sur l’Union, il l’a décroché cet accord de la chancelière à « son » budget de la zone euro !
Certes, on n’en connaît pas encore les montants, on n’a pas encore vraiment compris à quoi il servira. Le chef de l’Etat français a dû abandonner en chemin son vaste dessein d’un « superbudget » pour la zone euro, d’un ministre des finances et d’un parlement spécifiques. Et, accessoirement, cette prometteuse esquisse devra décrocher l’aval des autres Etats de la zone euro, ce qui n’est en rien gagné.
Il tient quand même une belle victoire symbolique, Emmanuel Macron. Il a réussi à convaincre Angela Merkel, qui ne voyait pas l’intérêt de bouger, surtout en temps de croissance retrouvée. Emmanuel Macron a en tout cas obtenu bien davantage de Berlin que son prédécesseur, qui, à la fin du printemps 2012, était rentré bredouille de Bruxelles, sans presque avoir livré bataille. François Hollande avait eu droit, en annexe au traité budgétaire, à un « pacte de croissance », sans grande valeur juridique et très vite oublié.
Une victoire à relativiser
On est pourtant pris d’un doute, au vu de l’hystérie collective qui s’est emparée de l’Union ces derniers jours, à cause du débat empoisonné sur la migration. L’espace de libre circulation Schengen menace à nouveau de s’effondrer comme un château de cartes, la coalition d’Angela Merkel ne tient plus qu’à un fil, son ministre de l’intérieur menaçant en l’absence de solution européenne de n’écouter que lui-même et de refouler les réfugiés à la frontière bavaroise… On se croirait revenu au plus fort de la crise de 2015.
Et si le président Macron s’était trop focalisé sur ce seul combat ? S’il avait mis trop de capital politique à obtenir son embryon de budget, alors que l’urgence était ailleurs, du côté de la migration, évidemment ?
Sur le papier, sa vision pour la zone euro est cohérente : cette dernière a besoin de davantage d’intégration économique et politique, tous les économistes le disent. Mais sans montants importants (des centaines de milliards d’euros et pas ces quelques dizaines de milliards qu’a évoquées Mme Merkel), le « budget Macron » sera incapable de faire seul barrage à une crise économique d’envergure.
Par ailleurs, les Européens sont-ils rassurés de savoir que Paris et Berlin travaillent activement à cette enveloppe commune, dont les médias ont encore du mal à expliquer le fonctionnement ? L’information calmera t-elle leurs angoisses face aux bouleversements géopolitiques, aux flux migratoires et à la mondialisation ? Dissuadera-t-elle ceux et celles qui sont tentés par le vote populiste de mettre ce type de bulletin dans l’urne lors des prochaines élections européennes ?
A Bruxelles, tout le monde se fait déjà peur en évoquant un raz de marée d’eurodéputés « antisystème » en mai 2019. Car la migration risque d’éclipser tous les autres thèmes de la future campagne. Et quels leadeurs européens entend-on le plus sur ce créneau électoral porteur ? Qui fait des propositions ? Matteo Salvini, le leadeur de la Ligue italienne, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, ou Sebastian Kurtz, le juvénile chef du gouvernement autrichien, en coalition avec l’extrême droite…
Si, pour paraphraser la chancelière Merkel, « les fondations de l’UE sont en danger tant que la question migratoire n’est pas résolue », pourquoi le président Macron, qui brigue la tête de l’Union, n’a-t-il pas pris cette question à bras-le-corps ?
Il est toujours un peu facile de réécrire l’histoire. La migration n’était plus un sujet de débat à Bruxelles quand Emmanuel Macron est entré à l’Elysée. Il ne pouvait pas non plus prévoir l’arrivée au pouvoir des extrêmes en Italie, ni la prise en otage de la chancelière allemande par l’aile la plus droitière de sa coalition à propos de sa politique d’accueil de réfugiés.
Mais le feu couvait sous la glace : dans le huis clos des discussions à vingt-huit, le blocage sur la question des quotas de réfugiés à se répartir était total depuis la fin de 2015. La preuve que la crise était latente, il a suffi que M. Salvini refuse l’accès des ports italiens à l’Aquarius pour qu’elle reparte de plus belle.
La France silencieuse à Bruxelles sur la crise migratoire
Le président français a préféré s’inscrire dans les pas de François Hollande. La France, à Bruxelles, est restée aussi discrète que possible, se gardant de trop intervenir dans les débats. Avec toujours deux obsessions : la crainte des attentats et celle de passer pour un pays d’accueil, alors qu’elle veut rester un pays de transit.
Pourtant, entre le mutisme et les propositions choquantes de l’extrême droite en passe de s’imposer dans la discussion à vingt-huit (des centres de « débarquement » de migrants dans des ports méditerranéens hors Union), il y a encore peut-être la place pour un discours médian. Et pour un gros travail de pédagogie, que le chef de l’Etat français aurait pu davantage porter.
Car s’ils ont été lents à la détente, les Européens ont beaucoup travaillé pour mieux protéger leurs frontières extérieures ces trois dernières années. En 2015, c’est vrai, les migrants étaient peu ou mal enregistrés à leur arrivée en Grèce ou en Italie. Depuis, le corps de gardes-frontières européen Frontex a été considérablement renforcé et, il pourrait passer à dix mille membres dans les années à venir.
Contrairement à ce que prétendent les droites dures, l’Europe n’est plus une « passoire ». Et depuis des mois, les capitales peaufinent des textes afin d’uniformiser et d’humaniser les procédures d’asile nationales ou d’éviter les « mouvements secondaires » de réfugiés dans l’Union. Des nouvelles règles, nécessaires, qui n’attendent que la levée des veto de Budapest et de Varsovie sur le volet « solidarité » (accueil des réfugiés mieux réparti dans l’Union) pour s’appliquer.