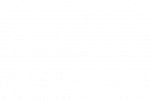« La création documentaire au Maroc et en Afrique a totalement explosé »
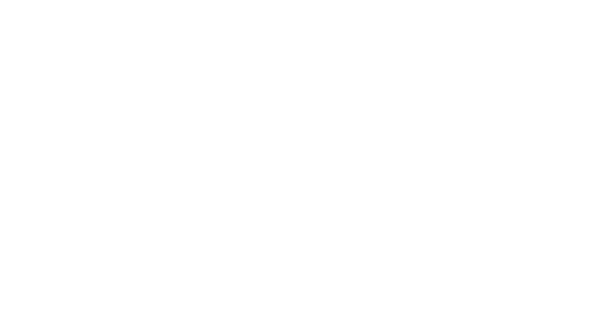
« La création documentaire au Maroc et en Afrique a totalement explosé »
Propos recueillis par Dorothée Myriam Kellou (contributrice Le Monde Afrique)
Hicham Falah, délégué général du Fidadoc, mesure le chemin parcouru depuis la création du festival d’Agadir, il y a dix ans.
Hicham Falah, délégué général du Festival international du film documentaire d’Agadir / Elise Ortiou Campion
La dixième édition du Festival international du film documentaire d’Agadir (Fidadoc), au Maroc, s’est achevée samedi 23 juin, décernant son Grand Prix Nouzha-Drissi à Demons in Paradise, du réalisateur sri-lankais Jude Ratnam. Un jury composé d’étudiants a remis le prix du Court-Métrage au jeune réalisateur marocain Ayoub Aït Bihi pour son film Simane, âme dans le ciel et âme sur la Terre.
Au fil des années, le Fidadoc s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent créer, produire, diffuser ou voir des films documentaires dans le royaume et, plus largement, en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest. Remettre sur les grands écrans un genre cinématographique quasiment disparu au Maroc, le documentaire de création, c’était en 2008 le pari un peu fou de feue Nouzha Drissi, productrice de documentaires et fondatrice du Fidadoc.
Le Franco-Marocain Hicham Falah, réalisateur et chef opérateur de formation, est depuis 2012 le délégué général du festival. Entretien avec un inlassable voyageur qui travaille à tisser des liens entre les mondes arabe, subsaharien et européen. Mais pas seulement, comme le démontre l’attribution du Grand Prix.
Quel est le bilan de ces dix années de travail au Fidadoc ?
Hicham Falah Il y a dix ans, le documentaire était pratiquement absent de notre paysage audiovisuel. A l’exception de quelques individualités, surtout des Marocains basés à l’étranger, la pratique et la diffusion du cinéma documentaire avaient disparu au Maroc. Le travail de fourmi du Fidadoc a eu impact considérable puisque le mot « documentaire », « wathai’qi », est à nouveau rentré dans le langage commun. Il y a eu une transformation totale de la place du documentaire dans notre pays. Aujourd’hui, tout le monde s’en réclame, tout le monde veut en faire, tout le monde veut en diffuser. L’avance sur recettes du Centre cinématographique marocain s’ouvre aux longs-métrages documentaires et la chaîne de télévision 2M consacre depuis 2012 une première partie de soirée à la diffusion de documentaires.
Avec les « printemps arabes » et la deuxième phase de libération en Afrique depuis les indépendances, la création documentaire sur le continent a totalement explosé. L’existence de petites caméras et de téléphones pour filmer, de YouTube et des réseaux sociaux pour diffuser, a encouragé une nouvelle génération à filmer sa réalité. Cette multiplication de films arabophones a permis au Fidadoc de développer sa mission de diffusion culturelle de proximité qu’il avait démarrée dès sa première édition, avec des projections ambulantes dans les quartiers d’une ville, Agadir, qui ne compte plus de vraie salle de cinéma.
Quelle est la place du cinéma documentaire africain dans la sélection 2018 ?
La sélection officielle comporte une compétition internationale de longs-métrages de dix films, avec seize nationalités représentées. Alors que la sélection de 2017 comptait quatre longs-métrages d’Afrique de l’Ouest de très haut niveau, nous n’en avons choisi cette année qu’un seul : Boxing Libreville, du Gabonais Amédée Pacôme Nkoulou, qui a reçu le Prix spécial du jury. A cela s’ajoutent deux films courts concourant dans la catégorie courts-métrages africains et arabes ».
La production reste très irrégulière dans tous les pays du continent. L’année 2017 avait été exceptionnelle, avec Les Héritiers de la colline, du Malien Ousmane Samassekou, qui raconte l’état de décomposition avancée de l’université à Bamako et avait reçu le Grand Prix Nouzha-Drissi. Le Fidadoc est résolument tourné vers tout le continent, mais on ne sélectionne pas un film parce qu’il est arabe ou subsaharien. On le choisit parce qu’il est bon. Or la production de longs-métrages n’est pas toujours au niveau de qualité exigé à international, en premier lieu à cause d’un manque de formations.
Comment le Fidadoc contribue-t-il à améliorer le niveau de la création et de la production documentaire africaine ?
Depuis 2012, nous avons mis en place un programme de formation et d’accompagnement de projets, la Ruche documentaire. Nous nous sommes inspirés de ce qui existait déjà sur le continent : les résidences d’écriture organisées dans le cadre du réseau Africadoc ou les ateliers de formation à l’écriture, au tournage et au montage de Bejaïa Doc en Algérie. La Ruche documentaire apprend aux jeunes cinéastes la base du métier : écrire un projet qui réponde aux exigences des producteurs nationaux ou étrangers. C’est un programme de formation ouvert en premier lieu aux étudiants en cinéma au Maroc, quelle que soit leur nationalité.
Nous sommes fiers d’avoir accompagné dès leur genèse des projets et des auteurs qui ont obtenu une reconnaissance internationale, à l’instar des Héritiers de la colline, mais aussi d’Amal, de l’Egyptien Mohamed Siam, qui a ouvert la dernière édition du Festival international du film documentaire d’Amsterdam, d’Atlal, de l’Algérien Djamel Kerkar, qui a été trois fois récompensé au Festival international de cinéma de Marseille en 2016, ou encore de We Could Be Heroes, de la Marocaine Hind Bensari, qui vient de remporter le Prix du meilleur documentaire international au Festival international canadien du documentaire Hot Docs.
En 2017, nous avons également créé en partenariat avec le Festival des 3 Continents, à Nantes, un atelier de formation à la coproduction internationale, Produire au Sud Agadir-Sahara, qui, pour sa deuxième édition, accueillera douze réalisateurs et producteurs marocains, tunisiens, algériens et burkinabés, encadrés par dix professionnels internationaux expérimentés en matière de coproduction internationale.
En 2017, vous rendiez hommage à Jean Rouch, cinéaste et ethnographe de l’Afrique. Cette année, vous mettez à l’honneur le cinéma documentaire marocain. Pourquoi un tel choix ?
Alors que notre production nationale a longtemps été exclusivement documentaire, le cinéma du réel a disparu à partir des années 1970. Les pionniers du cinéma marocain étaient des fonctionnaires du Centre cinématographique marocain, mais ils ont très vite subverti la commande de l’Etat et réalisé des films critiques sur la réalité sociale, comme en témoigne l’œuvre du grand poète et cinéaste Ahmed Bouanani, que le réalisateur Ali Essafi a contribué à exhumer. Comment faire des films sans connaître son histoire et la cinématographie de son pays ? On ne peut créer une cinématographie sur le vide. C’est pourquoi nous avons invité Ali Essafi à évoquer devant les participants de notre Ruche documentaire les autres pionniers du cinéma marocain, qui sont des inconnus pour la nouvelle génération de cinéastes.
C’est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi pour marraine de cette dixième édition la réalisatrice Fatima Jebli Ouazzani. Nous avons ouvert le festival avec son chef-d’œuvre, Dans la maison de mon père, un documentaire très personnel, oscillant entre fiction et réalité, qui interroge le mythe de la virginité dans une société musulmane. Ce film n’a pas été vu depuis vingt ans au Maroc et la jeune génération n’a pas idée qu’un tel film ait pu y être réalisé. Que bien avant eux, des cinéastes ont pris le risque de défier la censure et l’autocensure. Leur montrer ces films, leur permettre de rencontrer tous ces réalisateurs doit les nourrir, les inspirer. Le renouveau du cinéma au Maroc et en Afrique est en marche.
Le palmarès du Fidadoc 2018
Le jury de la compétition internationale a attribué...
- Le Grand Prix Nouzha-Drissi à Demons in Paradise, de Jude Ratnam (Sri Lanka). Un film dans lequel le réalisateur tamoul convoque les souvenirs de ses compatriotes sur la guerre civile sri-lankaise pour ouvrir la voie à une possible réconciliation.
- Le Prix des droits humains à Amal, de Mohamed Siam (Egypte), qui a suivi pendant six ans la lutte d’une adolescente en rebellion qui cherche à exister en tant que femme libre dans une Egypte en transition.
- Le Prix spécial du jury à Boxing Libreville, d’Amédée Pacôme Nkoulou (Gabon), portrait intimiste de Christ, un jeune boxeur qui s’entraîne sans relâche le jour et est veilleur la nuit dans des discothèques pour gagner sa vie. En toile de fond, l’élection présidentielle au Gabon de 2016.
- Une mention spéciale à Terra Franca, de Leonor Teles (Portugal), qui filme pendant quatre saisons la vie du pêcheur portugais Albertino, entouré de sa femme Dalia et de ses filles, dont l’aînée s’apprête à se marier.