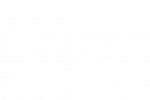Tour de France : les sprinteurs ou l’art de jouir

Tour de France : les sprinteurs ou l’art de jouir
Par Olivier Haralambon
Durant le Tour, l’écrivain Olivier Haralambon décrit et analyse pour « Le Monde » le style des vedettes du peloton. Aujourd’hui, les sprinteurs Mark Cavendish et Andre Greipel, à l’occasion de l’arrivée à Chartres.
Durant le Tour de France, l’écrivain Olivier Haralambon, ancien coureur amateur, analyse et décrit le style des vedettes du peloton.
André Greipel, au centre, entouré de Peter Sagan (en vert) et Fernando Gaviria (en bleu), à l’arrivée de la 4e étape du Tour de France 2018 remportée par Gaviria. / JEFF PACHOUD / AFP
Chronique. Le rideau s’est donc levé sur une scène plate, mollement balayée par le vent. Par convention, le premier acte du Tour appartient toujours aux sprinteurs.
Mais avant que ne s’abatte sur la dernière ligne droite la houle écumeuse du peloton, avant que n’émerge du chaos terminal et ne se dresse, sur fond de visages crucifiés par la douleur et la déception, la face unique et radieuse du vainqueur, on ne sait pas grand-chose de ce à quoi s’emploient ces hommes-là. Leur comportement diurne est mal connu ; ils ne chassent qu’au crépuscule de l’étape. En vérité les sprinteurs sont inobservables.
En effet, non seulement, blottis dans la durée, ils se cachent, mais ils ne laissent rien paraître de leurs pouvoirs. Tout le jour, le sprinteur économise ses moyens. Il pédale mou. Sa vertu cardinale, c’est l’avarice. Son capital tient en quelques gouttes concentrées et, pour s’embraser comme une torche à moins de cinq cents mètres, il doit avoir préservé ce maigre per diem.
La phrase des corps
Il faut donc s’y résoudre, on ne dispose que de quelques secondes pour déchiffrer leur(s) geste(s). A cette difficulté s’en ajoute une autre : les corps des sprinteurs sont des emblèmes incertains. Déjà l’expression d’un visage peut tromper, eh bien ! c’est encore pire avec les corps. Immobiles, réduits à leur dimension plastique, ils sont comme les lettres de l’alphabet qui en elles-mêmes n’enferment aucun sens ; il n’apparaît qu’entre elles, n’émerge que de leurs positions relatives. Seul le mouvement, la succession des postures, déroule la phrase des corps.
Cette opacité est particulièrement flagrante avec les sprinteurs, dont il n’existe ni archétype ni gabarit. Par exemple, peut-on imaginer figures et allures plus éloignées que celles de ces deux personnifications du sprint que sont Mark Cavendish et André Greipel ?
Tout chez Cavendish est plus rond et continu. Greipel n’est pas tant plus grand et lourd, il est plus anguleux, il est tout en brisures. Le premier, profilé, inspire la métaphore balistique, quand le second, carré, se ruant sur la ligne, évoque plutôt le fracas imminent de l’armoire défenestrée.
Mark Cavendish, au centre avec le casque blanc, à l’arrivée de l’étape de Villars-les-Dombes sur le Tour 2016. / Christophe Ena / AP
Un tourment d’affamé
L’homme de Man sprinte les yeux ronds et les coudes écartés, ouverts comme les fentes brachiales d’un poisson qui étouffe sur la grève. Le basculement du corps vers l’avant est
maximal, on jurerait que le menton va venir frotter le pneu, mais le visage est relevé. Cette hyperextension cervicale place la bouche ouverte dans le prolongement de la colonne aplatie, et Cavendish semble aspirer à la ligne d’arrivée, tel l’apnéiste qui, trop longtemps resté là-dessous, aspire à la surface.
Le natif de Rostock avance par saccades. Sa roue oscille moins amplement et le pied écrase plus à plat. Surtout, au maximum de l’effort, sa tête est baissée, qu’il ne relève qu’une seconde de-ci de-là, pour vérifier sa trajectoire et la distance qui le sépare de la ligne. Entre des membres inférieurs et une ceinture scapulaire d’une force herculéenne, le torse à peine enroulé est la seule zone de résilience. Le visage se plisse, triste et douloureux, pendant que, ayant agrippé le cintre, il semble l’attirer à lui à chaque coup de boutoir.
Au fond, c’est peut-être une capacité à la soudaineté du désespoir qui réunit Greipel et Cavendish. Ils n’ont en commun que ce tourment d’affamé. Cet effort si singulier, qui consiste à saisir le bon moment pour tout lâcher — on ne sprinte pas les yeux sur son capteur de puissance : on dépense aveuglément —, puis à prolonger tant bien que mal cet abandon. Cet effort qui, plus que tout autre, ressemble à la jouissance et place sous la banderole une petite mort, pourquoi après tout n’assimilerait-il pas toutes sortes de corps, pourvu que quelque impérieuse panique les meuve ?
Olivier Haralambon est l’auteur de « Le coureur est son ombre » (Premiers Parallèles, 2017)