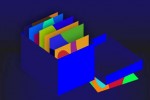Suivez notre série L’hépatite C, la grande oubliée
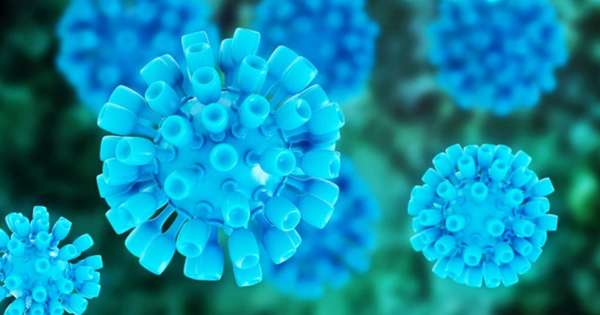
Suivez notre série L’hépatite C, la grande oubliée
Par Florence Rosier
On estime à 19 millions le nombre de personnes infectées en Afrique. Des traitements existent. Mais leur coût et le manque de prise de conscience politique des gouvernements retardent la prise en charge des malades.
Représentation en 3D du virus de l’hépatite C. / CC 2.0/iStockphoto
C’est l’une des grandes oubliées parmi les fléaux infectieux qui frappent l’humanité. Pourtant, l’hépatite C, avec l’hépatite B, tue davantage que le sida ou même le paludisme. En 2013, 1,45 million de personnes seraient mortes des suites d’une hépatite virale, indique l’étude « Global Burden of Disease », financée par la Fondation Bill et Melinda Gates (partenaire du Monde Afrique) et publiée en 2016 dans la revue The Lancet. En comparaison, en 2016, le VIH a tué 1 million de personnes, le paludisme 445 000 et la tuberculose, 1,7 million. C’est pourtant sur ces trois pandémies que la lutte mondiale s’est concentrée.
« Je suis toujours surpris de voir que les hépatites virales ont si peu attiré l’attention », confie le professeur Arnaud Fontanet, qui dirige l’unité d’épidémiologie des maladies émergentes à l’Institut Pasteur de Paris. Comment l’expliquer ? « Longtemps, les hépatites virales ont peu touché les pays développés. Et quand elles sont arrivées dans les pays riches, c’est par l’usage de drogues injectables. »
Maladie silencieuse
Le virus de l’hépatite C (VHC), qui se transmet par le sang, n’a été découvert qu’en 1989. L’épidémie de VHC est donc liée à de mauvaises pratiques : partage du matériel d’injection de drogues, réutilisation ou mauvaise stérilisation du matériel médical, transfusion de sang et de produits sanguins qui n’ont pas fait l’objet d’un dépistage.
Après une contamination, jusqu’à un tiers des personnes infectées se débarrassent spontanément du virus. Les autres deviennent, en l’absence de traitement, « chroniquement » infectées : elles hébergent durablement mais « silencieusement », le VHC.
Car l’hépatite C met deux, voire trois décennies à déboucher sur les complications les plus graves : une cirrhose ou un cancer du foie. « Il est donc difficile de sensibiliser les gouvernements à ces infections qui ne représentent pas un risque grave immédiat pour les sujets infectés », explique Arnaud Fontanet. Avant cela, les malades connaissent des épisodes chroniques de perte d’appétit et de poids, de douleurs musculaires et articulaires, de fatigue, de troubles du sommeil, de nausées, de vomissements, de diarrhées, de maux de tête et de troubles dépressifs. Mais en l’absence de diagnositic, ces signes ne sont pas forcément imputés à l’hépatite C.
Tandis qu’un vaccin existe contre l’hépatite B, le problème de l’hépatite C est très différent. Sa fréquence est très hétérogène selon les zones géographiques et les groupes de population. « Dans certaines grandes villes comme Mombasa, au Kenya, ou Dakar, au Sénégal, il existe des foyers d’infection chez les usagers de drogues, chez qui les taux de prévalence [nombre de personnes infectées] peuvent atteindre 25 % », souligne la professeure Karine Lacombe, infectiologue à l’hôpital Saint-Antoine de Paris. Certains pays sont particulièrement touchés, comme le Pakistan, la Géorgie ou la Mongolie. Mais c’est l’Egypte qui a longtemps présenté le taux de prévalence de l’hépatite C le plus élevé au monde. A cause d’une contamination massive due à des campagnes de traitement contre la bilharziose menées avec des seringues mal stérilisées dans les années 1960 et 1970. Aujourd’hui, le pays fait figure de modèle pour sa politique de lutte contre cette infection.
Traitement curatif hors de prix
En Afrique, on estime à « 19 millions le nombre de personnes chroniquement infectées par le virus de l’hépatite C, explique Arnaud Fontanet, dont l’équipe a réalisé les dernières évaluations. Théoriquement, pour toutes ces personnes, l’espoir d’une guérison rapide est permis depuis l’arrivée de nouvelles molécules en 2014. « Des traitements révolutionnaires qui guérissent cette infection en seulement douze semaines », se réjouit Lelio Marmora, directeur exécutif d’Unitaid, organisation internationale spécialisée dans le financement des innovations en santé et leur diffusion dans les pays en développement.
Les premiers traitements de l’hépatite C avaient de nombreux effets indésirables. Et ils ne guérissaient que la moitié des sujets infectés au bout d’un an minimum. « On est passés de ces traitements lourds et longs, à l’efficacité partielle, à des traitements par voie orale qui guérissent 95 % des gens en seulement trois mois. Et ce, quel que soit le stade d’évolution de la maladie », résume Arnaud Fontanet.
Les premiers de ces traitements révolutionnaires ont été le sofosbuvir (Gilead) et le daclatasvir (BMS). « En Afrique du Sud et au Cambodge, Médecins sans frontières (MSF) a récupéré les données sur l’efficacité de l’association de ces deux molécules. En 2017, cette étude a montré leur efficacité sur tous les génotypes du virus », ajoute Lelio Marmora. Depuis, d’autres molécules sont apparues. Mais, surtout, des médicaments génériques ont été développés. Car le coût de ces nouveaux traitements, astronomique dans les pays du Nord – 50 000 à 100 000 euros par patient ! – les rendait inaccessibles aux pays du Sud.
Eviter le monopole des fabricants
« Le premier grand défi est donc d’apporter les bénéfices de ces traitements aux pays moins favorisés », assure Lelio Marmora. C’est là qu’entre en jeu la capacité des pays et des organisations internationales à faire produire ces médicaments à des coûts abordables. L’Egypte, encore elle, a ainsi réussi ce tour de force : produire ces nouveaux traitements au prix le moins cher au monde – 76 euros par patient – par un fabricant local de génériques, Pharco Pharmaceuticals.
La Big Pharma Gilead, de son côté, a annoncé que leur molécule serait à terme accessible dans 101 pays du Sud à 1 000 dollars environ par patient. « Ces accords sont signés Etat par Etat : cela prend du temps », relève Arnaud Fontanet. En pratique, très peu de pays d’Afrique ont aujourd’hui accès à ces traitements innovants. Pourtant, « Il y a un vrai travail réalisé pour faire baisser leurs prix, souligne Isabelle Andrieux-Meyer, de Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDI), une organisation à but non lucratif spécialisée dans la recherche et le développement. Mais il faut aussi créer des compétitions entre fabricants de médicaments génériques. » Faute de quoi, certains pourraient se retrouver en situation de monopole, et faire repartir les coûts à la hausse.
De plus, les accords négociés avec les fabricants laissent de côté les pays à revenus intermédiaires, comme le Maroc, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, les pays d’Amérique latine, qui n’ont pas les moyens de se payer ces médicaments au prix fort. De nouvelles solutions thérapeutiques sont donc explorées. En avril, les résultats intermédiaires d’un essai clinique (STORM-C-1) ont été annoncés par DNDI. Ils montrent par exemple que « l’association sofosbuvir/ravidasvir est comparable aux meilleurs traitements actuels contre l’hépatite C, mais son coût est plus abordable. Elle pourrait fournir une alternative thérapeutique aux pays exclus des programmes d’accès des sociétés pharmaceutiques », a déclaré Bernard Pécoul, directeur exécutif de DNDI.
Autre enjeu : « Il faut que chaque pays mette en place une politique nationale de prise en charge des hépatites, avec un budget dédié. Cela aussi prend du temps », souligne Isabelle Andrieux-Meyer. D’où l’intérêt d’une initiative d’Unitaid : « Nous avons financé un projet de plaidoyer, Coalition Plus, à destination de tous les décideurs en santé des pays concernés, pour les convaincre de prendre au sérieux cette maladie », renchérit Lelio Marmora.
Le dépistage, un enjeu majeur
Mais, avant de traiter une personne infectée, encore faut-il pouvoir la diagnostiquer, et donc la dépister. C’est un frein majeur. Car un dépistage à grande échelle de l’hépatite C suppose la mise en place de tests de diagnostic simples, rapides, à coût abordable. « C’est ce qui manque à notre arsenal », reconnaît Arnaud Fontanet.
Aujourd’hui le diagnostic d’une infection chronique par le VHC s’effectue en deux étapes. D’abord par recherche d’anticorps sur un prélèvement sanguin dont le test est peu cher. Mais si la présence d’anticorps VHC est avérée, il faut confirmer l’infection chronique par biologie moléculaire qui nécessite des machines d’analyse difficilement utilisables sur le terrain et très coûteuse.
Il faudrait donc pouvoir disposer d’un test « clés en main », permettant de dépister en quelques heures, en une seule étape, une infection à partir d’une goutte de sang prélevée au bout d’un doigt, comme pour le virus de l’hépatite B. C’est une quête du Graal.
En 2016, Unitaid a établi un partenariat avec la Fondation suisse FIND pour développer des tests de diagnostics de l’hépatite C plus simples, à coûts réduits. Leur projet, financé à hauteur de 38 millions de dollars sur trois ans, concerne six pays : Cameroun, Géorgie, Inde, Malaisie, Birmanie et Vietnam. « Nous cherchons à développer des systèmes de dépistage simultanés de plusieurs maladies, en une seule visite », indique Lelio Marmora. Un système qui permettrait, si le test est positif, d’entreprendre immédiatement un traitement. Mais « au final, conclut Lelio Marmora, le plus important reste la décision politique des pays de structurer une réponse cohérente et responsable vis-à-vis de cette infection. » Là aussi, les avancées prennent du temps et se heurtent parfois à d’insondables résistances.
Le Monde Afrique propose une série de reportages, décryptages, portraits et entretiens pour raconter l’état d’avancement de la lutte contre l’hépatite C sur le continent.
Cet article fait partie d’une série réalisée dans le cadre d’un partenariat avec Unitaid.