La « graduation », clap de fin traditionnel à Oxford
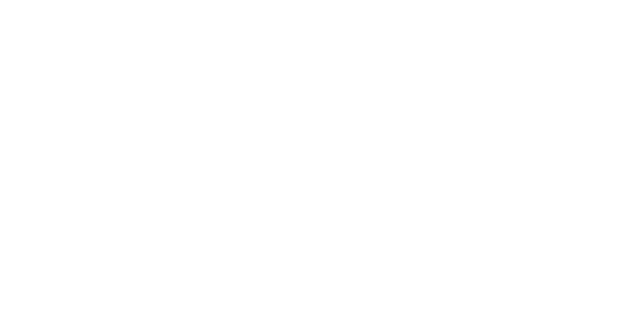
La « graduation », clap de fin traditionnel à Oxford
Passage obligé pour clôre son master, Noé Michalon raconte, dans le dernier épisode de sa chronique, sa cérémonie de remise de diplôme, colorée par les traditions de longue date de l’université.
La traditionnelle photo du jeté de chapeaux après la remise de diplôme. / NOÉ MICHALON / « LE MONDE »
Chronique d’Oxford. Diplômé de Sciences Po, Noé Michalon tient une chronique pour Le Monde Campus, afin de raconter son année à l’université d’Oxford, où il suit un master en études africaines.
Après neuf mois à s’imbiber des traditions les plus rocambolesques, ce n’était pas une surprise : la « cérémonie de graduation », qui fit de moi un étudiant officiellement diplômé d’Oxford, ne manquait pas de piquant, samedi dernier.
Bouquet final de vieilles coutumes, cette journée est un véritable concentré de ce qu’Oxford fut pour moi cette année : une machine à souvenirs, un mélange de modernité et de pratiques quasi médiévales, et le dernier rassemblement des habitants d’une bulle prête à éclater. Non, pas de parchemin en main, mais un chapeau carré, et une robe universitaire qu’on troque pour une autre plus longue et plus colorée, voilà en somme l’étrange processus par lequel on rejoint la millénaire famille des alumni (« anciens élèves ») de la ville aux clochers rêveurs.
Tout commence par une procession matinale : une fois briefé dans mon collège avec les autres étudiants pour qui c’était le grand jour – étrangement, on se fait « graduer » en compagnie des camarades de collège et non de cursus – nous nous mettons en marche, en rang, pour rejoindre le majestueux Sheldonian Theatre en forme de fer à cheval. Une dernière fois, nœud papillon blanc au col, nous avons l’impression d’incarner l’université pour quelques minutes : les touristes, pléthoriques en juillet, nous mitraillent avec leurs appareils photo et smartphones, se prennent en selfie, déséquilibrés par le lourd sac de souvenirs qu’ils tiennent dans l’autre main. Une fois installés sur les majestueux sièges du rez-de-chaussée de l’enceinte – les familles sont à l’étage, le sourire éclairé par la lumière de leur smartphone bien sollicité ce jour-là – le déferlement de traditions commence.
Quelques mots en latin
Sous les orgues retentissants – et préenregistrés, me révélera un parent d’élève spécialiste, le représentant du vice-chancelier fait une entrée magistrale dans l’hémicycle, suivi et précédé de proctors, les membres de l’administration chargés de faire régner l’ordre dans l’université. Des membres de cet aréopage portent une sorte de sceptre avec eux, avant de prendre place sur les trois sièges en hauteur qui dominent la salle.
« Je vais bientôt parler en latin, avertit tout de go le maître de cérémonie. Non pas parce que nous sommes conservateurs, mais pour vous rappeler les neuf cents ans d’histoire de cette école. » Ni une ni deux, voilà l’orateur qui change de langue, mais pas d’accent. De quoi rendre plus inaccessibles encore mes souvenirs de la langue de Brutus, noyés dans ceux de trop superficiels exposés passés en salle informatique du lycée. Tout juste reconnais-je avec amusement quelques latinisations assez évidentes, comme ce cher « collegium Kellogg » qui fut le mien ou quelque chose comme « magistris in commercio administratio » pour le MBA (les vrais latinistes ne manqueront pas de me corriger dans les commentaires).
J’apprendrai par la suite que le latin était encore plus présent lors des interminables cérémonies d’antan. « Certains s’amusaient à faire des blagues ou des jeux de mots dans cette langue, s’attendant à voir rire une salle qui restait pourtant bien silencieuse », m’expliquera peu après l’un des membres de l’administration de mon collège. Bref, c’est donc dans cette ambiance quasi vaticanaise – plus jeune et moins masculine, mais tout aussi parée de robes, internationale et encerclée de colonnes en pierre – que nous entrons en scène.
Lors de la cérémonie de remise de diplôme de Noé Michalon à Oxford. / NOÉ MICHALON / « LE MONDE »
Appelés un à un, nous défilons en rang devant le triumvirat assis sur son perchoir : phrase en latin, on s’incline vers l’orateur de gauche, phrase en latin, courbette à droite, phrase en latin, courbette au centre, et c’est à notre tour de dire deux mots : « Do fidem. » (« Je jure », mais que jurons-nous ? C’est resté nébuleux.) D’un pas solennel, nous sommes alors priés de quitter le théâtre pour rejoindre une salle annexe, qui n’est autre que celle ayant servi de décor à l’infirmerie de Poudlard, pour revêtir les coûteuses robes de graduates qui nous attendent.
Plus lourdes et donc très chaudes pour l’été, ornées d’un ruban dont la couleur est spécifique au type de notre diplôme, nous les louons pour la journée. Ainsi vêtus, nous entrons à nouveau dans le théâtre, sous les applaudissements des familles venues du monde entier pour immortaliser le moment. Nouvelles inclinations et congratulations en latin, et nous voilà sommés de prendre la porte, à nouveau. Nous sommes alors disposés en haie d’honneur à l’extérieur, et saluons la sortie de nos hôtes universitaires, leur présentant ces énigmatiques mortarboards, les fameux chapeaux carrés.
Une bulle confortable
La solennité s’estompe en un clin d’œil. Les selfies reprennent de plus belle sous l’œil humide des parents, les quadrilatères de velours voltigent déjà, et c’est au tour des étudiants eux-mêmes de perpétuer des traditions : la traditionnelle photo sous le fameux pont des Soupirs adjacent, inspiré du modèle vénitien, puis celle devant la Radcliffe Camera, l’emblématique bibliothèque circulaire de la ville. Chaque college rapatrie ensuite ses étudiants pour diverses réceptions.
L’événement est d’autant plus marquant qu’il marque la fin d’une époque comme celle de la fréquentation de toute une ville. Il est plus simple de rester en contact avec des camarades d’une université parisienne ou londonienne, dont beaucoup resteront dans l’une de ces capitales. A Oxford, c’est une autre affaire : les gens viennent du monde entier, puis repartent dans le monde entier, ceux qui restent ne s’y attardent que pour commencer une thèse ou enseigner, la plupart du temps.
Cette graduation signe aussi notre sortie de la bulle confortable, atemporelle, internationale et progressiste dans laquelle nous avons évolué. Le retour à la vie d’avant n’est pas toujours aisé. Beaucoup d’amis qui sont passés par là avant moi m’ont expliqué avoir eu quelques difficultés à s’adapter à l’après-Oxford, les premières semaines du moins. Une serveuse dans un pub me racontait n’avoir jamais réussi à quitter cette ville magnétique, et avoir tout fait pour rester un peu plus… Et voilà déjà huit ans qu’elle a fini ses études !
Sans surprise, je pars donc avec le sentiment d’avoir vécu dans un lieu assez unique (je n’oublie pas Cambridge, c’est promis), que j’ai essayé de décrire aussi fidèlement que je pouvais. Cette chronique m’a permis d’ouvrir un peu plus l’œil sur tout, de sans recueillir l’avis de mes camarades et même de rencontrer plusieurs lecteurs, (ex-)étudiants ou de passage dans la ville. Il est temps désormais de passer le flambeau, bien d’autres universités méritent certainement un coup de projecteur !








