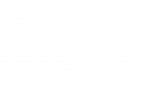Au Cameroun, de jeunes mères « séquestrées » dans un hôpital

Au Cameroun, de jeunes mères « séquestrées » dans un hôpital
Par Josiane Kouagheu (Douala, correspondance)
Des femmes racontent avoir été retenues contre leur gré, durant des semaines, faute de pouvoir payer les frais de césarienne.
Après deux semaines vécues comme une « prisonnière » à l’hôpital central de Yaoundé, Carine* a encore les yeux gonflés par les pleurs. « C’est très douloureux à raconter. Je ne pouvais pas rentrer à la maison parce que je n’avais pas d’argent pour régler ma facture », raconte la mère de famille de 28 ans, handicapée moteur depuis l’enfance, qui s’était rendue dans cet établissement public de la capitale camerounaise pour y accoucher par césarienne, le 24 juin. « A sa naissance, ma fille pesait 2,2 kilos. Les médecins m’ont dit qu’elle était très fragile et qu’il lui fallait des soins. Ça nécessitait encore de l’argent », explique Carine, sa petite fille blottie contre sa poitrine, depuis son studio à Yaoundé.
Les factures s’accumulent et le couple – son compagnon est maçon – s’avère rapidement dans l’impossibilité de payer. « Avant l’accouchement, nous avions économisé 180 000 francs CFA [274 euros]. On a ensuite vendu notre télé, le frigo et l’appareil musical, mais ça ne suffisait toujours pas. » Après quarante-huit heures en salle de réanimation et cinq jours au service hospitalisation, les médecins lui demandent de « libérer le lit ». Carine se rend alors au département néo-natalité, où sa fille est prise en charge. Elle y passe huit jours avant d’être conduite à la « chambre A35 », où elle rencontre une dizaine d’autres femmes et leurs nourrissons.
« Les vigiles veillaient »
Comme elle, toutes ont subi une césarienne et sont issues de familles démunies, incapables de payer la totalité des frais hospitaliers. D’après la presse locale, elles sont entre dix et treize femmes. Dans leurs éditions du vendredi 3 août, les quotidiens privés Le Jour et Le Messager soulignent qu’elles ont été, pendant plusieurs mois pour certaines, « séquestrées » dans l’hôpital, « surveillées en permanence par des gardiens », avant d’être finalement libérées le 2 août.
« Avec ma carte d’invalidité, je croyais qu’on pouvait réduire mes frais, mais on m’a dit que ça ne marchait pas, relate Carine. Nous étions vraiment abandonnées. Certaines m’ont dit qu’elles étaient là depuis trois mois, d’autres depuis deux semaines. La nuit, certaines dormaient sur les trois lits que comptait la salle, et la majorité sur des nattes et matelas étalés à même le sol. On ne pouvait pas sortir hors de l’hôpital, les vigiles veillaient. »
Deux ou trois femmes parviennent pourtant à tromper la vigilance des surveillants. Elles se déguisent en garde-malade, dissimulent leurs bébés dans des sacs et s’enfuient. La surveillance est alors renforcée sur Carine et les autres. Matin et soir, infirmières et vigiles « font l’appel pour s’assurer que personne n’a fui », racontent deux femmes contactées par Le Monde Afrique.
Prises de panique, les « prisonnières » prennent des photos qu’elles partagent via WhatsApp avec des proches qui tentent de réunir les sommes restantes – sans succès. Les images se diffusent jusqu’à ce que Paul Chouta, un « lanceur d’alerte » camerounais, les reçoive et les republie sur son compte Facebook, le 2 août, afin de dénoncer « le traitement ignoble infligé à ces femmes et leurs enfants ». L’effet est immédiat : les femmes quittent l’hôpital le jour même.
Un trou de 49 000 euros
Le lendemain, le directeur de l’hôpital, Pierre Joseph Fouda, organise un point presse au cours duquel il rejette ces accusations. Face aux journalistes, il dénonce « l’égoïsme » et la « mauvaise foi » des familles qui refusent de payer. Il relève par ailleurs que sur les photos diffusées, les femmes, assises à même le sol, allaitent « des bébés en pleine forme », tandis que les lits sont « vides et inoccupés » et que la porte de la salle, « largement ouverte », n’entrave pas la « liberté de mouvement ».
Pierre Joseph Fouda assure que pour les frais de césarienne (médicaments, chirurgie, anesthésie, etc.), l’hôpital central de Yaoundé a enregistré un manque à gagner de près de 32 millions de francs CFA (près de 49 000 euros) en 2017. Ce qui, d’après lui, n’empêche pas l’hôpital public de prendre en charge les malades mais explique qu’il soit vigilant face aux mauvais payeurs. « Notre rôle est de sauver des vies dans le respect de la dignité humaine, dit-il, mais il y a des malades dont les familles ont de l’argent et refusent de payer. »
Au Monde Afrique, le directeur détaille : « Chaque mois, une commission statue sur qui est indigent et qui ne l’est pas. Quand une patiente n’est pas jugée indigente, j’appelle le mari et je lui demande de payer au moins les frais de médicaments, pour nous permettre de sauver d’autres malades. Il faut que chacun assume sa responsabilité, celle de sauver des vies pour l’hôpital et celle de payer les frais médicaux pour les familles. »
* A sa demande, le prénom a été changé.