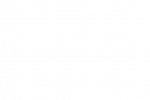Kofi Annan, un homme de paix

Kofi Annan, un homme de paix
Editorial. Avec la disparition de l’ancien secrétaire général de l’ONU s’efface un peu plus un ordre du monde fondé sur les valeurs qui avaient présidé à la création des Nations unies.
Portrait de Kofi Annan au siège de l’ONU, samedi 18 août 2018. / MARY ALTAFFER / AP
Editorial du « Monde ». Depuis l’annonce de son décès, le 18 août, une pluie d’hommages a salué la mémoire de Kofi Annan. Angela Merkel, Vladimir Poutine, Theresa May, Emmanuel Macron, les anciens présidents américains Bill Clinton et Barack Obama, et bien d’autres responsables, notamment africains, ont rappelé les convictions, le courage et la sagesse de ce croisé de la paix que fut l’ancien secrétaire général de l’ONU – entre 1997 et 2006.
Chacun fera le tri entre les éloges, ceux qui expriment une sincère admiration et ceux qui relèvent davantage des convenances, voire des larmes de crocodile diplomatiques. Mais tous témoignent, sans aucun doute, qu’avec la disparition du Prix Nobel de la paix 2001 s’efface un peu plus un ordre du monde fondé sur les valeurs qui avaient présidé à la création des Nations unies au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Certes, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et l’ambition de régler les conflits internationaux par le droit et la diplomatie internationale ont trop souvent fait figure de vœux pieux. Kofi Annan lui-même en fit l’amère expérience à maintes reprises. Ainsi lorsque, alors chargé des opérations de maintien de la paix de l’ONU, il assista, impuissant, au génocide rwandais en 1994 ou au massacre de Srebrenica, dans l’ex-Yougoslavie, en 1995.
Défénseur des valeurs humanistes
De même, en dépit de ses efforts inlassables, il ne put dissuader les Etats-Unis de George W. Bush de déclencher en 2003 une guerre qu’il n’hésita pas à qualifier d’« illégale » contre l’Irak de Saddam Hussein – intervention dont les conséquences restent aujourd’hui encore désastreuses. En 2012 enfin, il avait accepté, à la demande de son successeur, Ban Ki-moon, une mission de la dernière chance pour tenter de circonscrire la guerre civile qui débutait en Syrie ; six mois plus tard, il se résignait à jeter l’éponge, tristement conscient de l’impuissance de la diplomatie face au déchaînement de la violence dans cette région du monde et à l’inaction, pusillanime ou intéressée, des grandes puissances.
Il n’empêche, ce sont ces valeurs humanistes – les droits de l’homme comme fondement de la légitimité internationale – que Kofi Annan n’a cessé de défendre, sans irénisme mais avec abnégation, tout au long d’une vie de diplomate entièrement dévouée à l’ONU. Ce sont ces mêmes valeurs qu’il promouvait, en 2005, en faisant adopter par l’Assemblée générale de l’ONU le principe, inspiré du droit d’ingérence, de la « responsabilité de protéger » les populations civiles, y compris contre la souveraineté d’un Etat.
Epoque révolue, dira-t-on, où le Conseil de sécurité (sans l’appui duquel le secrétaire général est réduit au ministère de la parole) s’efforçait encore d’agir, où la Russie n’avait pas encore imposé sa stratégie de puissance, où la Chine n’était qu’un géant en devenir, où les Etats-Unis enfin n’avaient pas totalement renoncé à régler de façon multilatérale les défis et les conflits de la planète.
C’est exact. Les dérèglements du monde, les égoïsmes stratégiques des grandes puissances, les protectionnismes économiques ou climatiques, le mépris désormais ouvertement assumé, à Washington ou à Moscou notamment, des règles du droit et de la force des traités ont balayé l’espoir de régulations collectives. « La loi du plus fort, et non plus la force de la loi », selon la formule de Kofi Annan, s’impose chaque jour davantage.
Cela ne rend que plus indispensable la poursuite du combat pour la paix du gentleman Annan.
1997-2006 : Kofi Annan, à l’heure du bilan