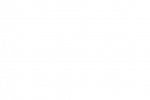A Angoulême, comédies sociales à la française
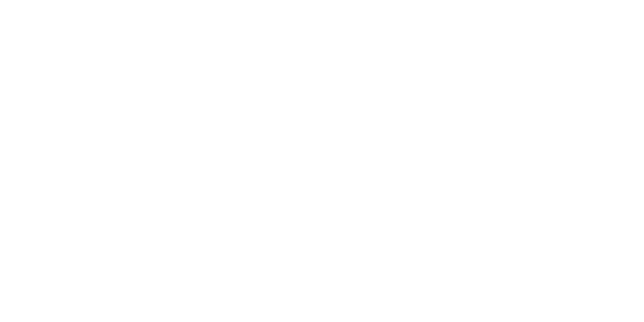
A Angoulême, comédies sociales à la française
Par Thomas Sotinel
La onzième édition du festival du film francophone dirigé par Dominique Besnehard est marquée par la récurrence du thème de l’engagement social ou politique, traité sur le mode comique.
Claire Dumas, Patrick Belland et Judith Davis dans « Ce qui me reste de la révolution », de Judith Davis. / Agat Films & Cie
Pour le dixième anniversaire et la onzième édition du Festival du film francophone d’Angoulême, du 21 au 26 août, ses aînés, les festivals de Venise et de Toronto, lui ont rendu l’hommage de leur jalousie. Organisées respectivement une et deux semaines plus tard, les manifestations italienne et canadienne ont exigé des sociétés de vente internationales, des distributeurs et des producteurs français qu’ils choisissent de dévoiler leurs films sur les bords de la Charente, sur ceux de la lagune de Venise, ou du lac Ontario. C’est ainsi que Mademoiselle de Joncquières, marivaudage cruel d’Emmanuel Mouret avec Cécile de France, ne sera pas projeté à Angoulême, comme initialement prévu, puisqu’il a été retenu dans la section « Platform » à Toronto.
Le choix n’opère pas toujours en défaveur du festival fondé, en 2008, par Dominique Besnehard et Marie-France Brière : plutôt que de répondre à la sollicitation d’une section parallèle vénitienne, l’équipe de Tout ce qu’il me reste de la révolution, premier long-métrage de Judith Davis, est venue accompagner son film, présenté en compétition.
Du rire pour atténuer les larmes
Celle-ci, qui rassemble dix films francophones, dont cinq français, forme la face audacieuse de ce festival-Janus. Le visage fédérateur est celui que présente un solide menu de quatorze avant-premières, de Voyez comme on danse, de Michel Blanc, avec Jean-Paul Rouve (qui présentait, en tant que réalisateur, Lola et ses frères), à I Feel Good, de Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. C’est le public, qui, à presque toutes les séances, remplit les salles jusqu’au dernier fauteuil et se charge de faire la jonction, passant sans heurt (mais pas toujours avec le même enthousiasme) du boulevard contemporain aux premiers films d’auteur.
En se faisant festivalier boulimique (il n’y en a pas d’autre à Angoulême), il était impossible de ne pas remarquer une coïncidence si insistante qu’elle pouvait être qualifiée de tendance. Au fil des avant-premières, on a vu dans trois comédies trois actrices, Yolande Moreau dans I Feel Good, Noémie Lvovsky dans Les Invisibles, de Louis-Julien Petit, et Agnès Jaoui dans Les Bonnes Intentions, de Gilles Legrand, prendre des rôles de femmes qui traversaient une crise personnelle en empruntant la voie du bénévolat. Ces figures occupent des places très différentes de film en film, et les cinéastes ne les utilisent pas sur le même registre. Reste que les trois longs-métrages avaient en commun de recourir au comique pour atténuer la douleur lancinante et incurable de la question « Que faire » ?
On passera rapidement sur la réponse qu’apportent Delépine et Kervern. I Feel Good sort en salle dès le 26 septembre, et l’on découvrira l’affrontement (symboliquement) fratricide entre un garçon (Jean Dujardin) qui importe brutalement ses rêves de réussite entrepreneuriale dans une communauté Emmaus animée par sa sœur (Yolande Moreau). Il suffit d’avoir vu un seul des films réalisés par le duo (Le Grand Soir, avec Poelvoorde et Dupontel, apocalypse dans la grande distribution, par exemple) pour savoir de quel côté leur cœur penche. L’innovation pour Kervern et Delépine réside ici dans l’exploration semi-documentaire de la communauté, dont les membres sont filmés avec attention, sans jamais empiéter sur le domaine des comédiens professionnels, la fiction.
Ancrage dans la réalité
Louis-Julien Petit a, lui, tenté d’effacer cette frontière. Il a demandé à des femmes sans domicile de jouer dans Les Invisibles, inspiré du travail documentaire de la photographe et réalisatrice Claire Lajeunie. La fiction n’a rien de documentaire – l’équipe d’un centre d’accueil de jour (Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena) passe dans la clandestinité après la destruction d’un campement de femmes SDF –, mais les corps et les visages des utilisatrices du centre rappellent sans relâche à la réalité sur laquelle repose cette comédie. Ce sont elles qui font oublier les facilités du récit, qui convainquent de la justesse du propos. Les Invisibles sortira en salle le 9 janvier 2019.
C’est peut-être cet ancrage qui manque aux Bonnes Intentions, de Gilles Legrand, portrait d’Isabelle (Agnès Jaoui), professeure d’alphabétisation, défenseuse de la veuve, de l’orphelin et du réfugié, mais épouse insatisfaite et insatisfaisante, mère absente. Elle est trop longtemps tournée en ridicule pour que l’on croie à la justesse de ses intentions, même si, in extremis, scénariste (la dramaturge Léonore Confino) et réalisateur œuvrent frénétiquement à sa rédemption (sortie le 21 novembre).
On retrouve cette obsession de l’échec politique et social dans Tout ce qu’il me reste de la révolution. Mais Angèle (Judith Davis, qui s’est confié le rôle principal), l’héroïne de cette comédie romantique post-marxiste, n’a vécu que par procuration les échecs de ses aînés. Angèle traverse la vie et la ville avec la mine d’une jeune femme en colère. Elle a ses raisons : architecte, elle n’arrive pas à être rémunérée pour son travail ; fille d’un couple militant défait par l’histoire, elle a pris le parti de Papa (Simon Bakhouche), qui vit dans le ressassement des grandes heures de la révolution qui a failli venir, contre maman (Mireille Perrier), qui a déserté pour la campagne.
Le film est une promenade gaie et sensuelle dans un paysage dévasté, à l’image de cette entrée de ville (la porte de Montreuil, à Paris), à laquelle Angèle rêve de redonner un aspect compatible avec la vie en société. Au fil des séquences, on croise un cadre en burn-out, un instituteur amoureux, une sculptrice au bord de la compromission… Ces incidents, ces rencontres pourraient n’être qu’une collection de choses vues, Judith Davis les assemble en une mosaïque d’une étonnante profondeur de champ. A l’applaudimètre angoumois, Tout ce qu’il me reste de la révolution a fait jeu égal avec les comédies les plus attendues.
I FEEL GOOD de Benoît Delépine et Gustave Kervern - TEASER 2
Durée : 00:59