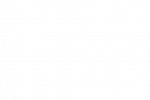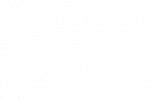« Le Monde » remet son prix littéraire à Jérôme Ferrari pour « A son image »
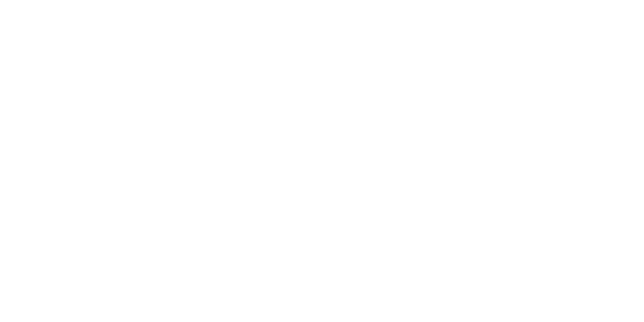
« Le Monde » remet son prix littéraire à Jérôme Ferrari pour « A son image »
Propos recueillis par Raphaëlle Leyris, Jean Birnbaum
Le sixième prix littéraire « Le Monde » a été attribué mercredi à l’écrivain pour son roman « A son image », qui retrace l’histoire d’une photoreporter corse.
L’écrivain Jérôme Ferrari. / ACTES SUD
Nous avons hésité à faire figurer A son image parmi les romans en lice pour le prix littéraire Le Monde. Non que nous ayons eu des doutes sur la beauté sombre et la force de ce roman retraçant l’histoire d’une photoreporter corse. Mais parce que, six ans après le Goncourt du Sermon sur la chute de Rome (Actes Sud), nous nous interrogions sur le sens qu’il y aurait à attribuer une récompense à celui qui avait déjà reçu le plus convoité des prix. Des questions balayées par l’enthousiasme du jury, présidé par Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, et composé de journalistes travaillant au « Monde des livres » (Jean Birnbaum, Florent Georgesco, Raphaëlle Leyris, Florence Noiville et Macha Séry) et aux quatre « coins » du Monde : François Bougon (Economie), Denis Cosnard (Economie), Emmanuel Davidenkoff (Développement éditorial), Clara Georges (« L’Epoque ») et Raphaëlle Rérolle (« Grands reporters »). En dépit des grandes qualités des autres textes sélectionnés, c’est donc A son image qui succède à L’Art de perdre, d’Alice Zeniter (Flammarion).
Quel rapport entreteniez-vous avec les prix littéraires avant le Goncourt, et ce dernier a-t-il modifié votre regard sur eux ?
Comme lecteur, je n’ai jamais choisi un livre en fonction des prix, et il ne m’a jamais semblé que ceux-ci étaient un critère de qualité littéraire infaillible. Et pourtant je me rappelle très bien à quel point, en 2012, la semaine avant l’attribution du Goncourt, j’avais du mal à penser à autre chose.
Aujourd’hui, j’entretiens un rapport moins détaché que je ne le pensais, moi qui étais convaincu d’en avoir fini avec les prix. Celui du Monde me fait très plaisir. Sans doute parce que j’ai une relation particulière avec votre journal depuis 2012. [Plus de deux mois avant de recevoir le prix Goncourt, Jérôme Ferrari avait fait la « une » du « Monde des livres » et du Monde pour Le Sermon sur la chute de Rome.]
Avez-vous un lien plus lointain, familial par exemple, avec « Le Monde » ?
Cela fait des années que je suis abonné au Monde. Dans ma famille, il n’y avait pas de quotidien à la maison, mais j’ai tout de même un lien familial avec le journal, grâce à un cousin qui travaillait à l’imprimerie du Monde, et qui a donné à mon père la plaque d’impression de cette fameuse « une » du Monde d’août 2012 !
Votre œuvre semble revenir constamment à la première phrase d’« Un dieu un animal » (Actes Sud, 2009) : « Bien sûr, les choses tournent mal. » L’expression est récurrente dans « A son image »…
Je m’en suis aperçu à la relecture ! J’ai fait un travail d’enquête en Serbie avant d’écrire, et ce qui revenait constamment dans les discussions avec les gens était leur consternation face à la rapidité avec laquelle, oui, les choses tournaient mal. Le fait qu’ils pensaient moins vite que l’événement. L’expression s’est imposée. Mais peut-être que cela m’a frappé parce que cela rencontrait, chez moi, un certain tropisme.
Plus le roman avance, plus on a l’impression que la photo est ce qui montre ce qui n’aurait pas dû être montré. Et l’on se demande si, au fond, la conclusion à en tirer ne serait pas celle d’une « supériorité » morale de la littérature…
C’est un problème qui est abordé, en effet, mais ça n’est pas du tout ce que je pense. Le piège de l’obscénité est là, dans n’importe quel type de représentation. Cette question m’intéresse, y compris d’un point de vue philosophique, depuis longtemps.
Personnellement, je pense que les photos qui montrent ce qu’on devrait cacher doivent le montrer – même si j’ai conscience que l’impact du photo-reportage de guerre est inférieur à ce qu’il a pu être, parce que l’on est noyé sous les images. Attester d’un événement reste une chose très importante. Je ne pense pas que la littérature, face à l’obscénité, puisse se placer en position de supériorité par rapport à la photographie. Il faut voir au cas par cas. Quand j’écrivais Où j’ai laissé mon âme [Actes Sud, 2010], cette question me travaillait particulièrement – et avec elle cette idée qu’on peut être obscène avec les meilleures intentions du monde.
ACTES SUD
Est-ce que ces interrogations sur l’obscénité et la complaisance ont un lien avec la relative sobriété de votre écriture dans « A son image » ?
Non, ça, c’est vraiment une chose entre moi et moi, à cause de laquelle j’ai recommencé le roman vingt fois. J’ai toujours eu peur du moment où l’on maîtrise une forme si bien que l’on finit, sans s’en rendre compte, par reproduire un « algorithme » inconscient d’écriture… Au risque de s’autoparodier. C’est une chose que je craignais, et c’est de cela que procède ce changement. Je voulais un peu échapper à moi-même.
La thématique religieuse est très forte ici, comme elle l’était dans « Le Sermon sur la chute de Rome », entre autres. Vous dites n’être pas croyant, mais est-ce que, de livre en livre, vous n’approfondissez pas ce que le philosophe, théologien et prêtre Michel de Certeau (1925-1986) appelait une « écriture croyante » ?
Cette expression est très belle ! Je veux bien me l’approprier. Il est sûr que je ne suis pas croyant, et tout aussi sûr qu’il y a là-dedans beaucoup de choses qui me touchent, sans quoi je ne me lancerais pas dans un exercice simplement intellectuel ou esthétique. Pour écrire un personnage de prêtre, comme il y en a un dans A son image, il faut que je me sente au moins la capacité de me faire une représentation intime de ce que peut être cette expérience. Je ne sais pas si j’aurais ressenti cette proximité si je n’avais pas connu les messes d’enterrement corses – c’est une série de gestes, de prières et de devoirs qui sont accomplis dans une solennité encore augmentée quand la messe est chantée en polyphonie. Peut-être que j’y suis d’abord venu par émotion esthétique.
Prix littéraire « Le Monde »: la sélection 2018
Les dix titres en lice
Arcadie, d’Emmanuelle Bayamack-Tam, P.O.L
Le Guetteur, de Christophe Boltanski, Stock
A son image, de Jérôme Ferrari, Actes Sud
Camarade Papa, de Gauz, Le Nouvel Attila
Idiotie, de Pierre Guyotat, Grasset
Un monde à portée de main, de Maylis de Kerangal, Verticales
Ma dévotion, de Julia Kerninon, Rouergue
Toutes les femmes sauf une, de Maria Pourchet, Fayard
L’Hiver du mécontentement, de Thomas B. Reverdy, Flammarion