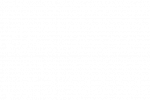La difficile question de la charge de travail dans l’industrie du jeu vidéo

La difficile question de la charge de travail dans l’industrie du jeu vidéo
Par William Audureau
L’éditeur Rockstar Games (« GTA », « Red Dead Redemption ») a été épinglé pour avoir imposé des semaines de travail de cent heures hebdomadaire. Un problème qui est structurel.
Image d’illustration de « Red Dead Redemption 2 », la prochaine superproduction de Rockstar Games. / Rockstar
C’est une petite musique qui revient avec insistance : derrière le strass des superproductions du jeu vidéo, les conditions de travail désastreuses des développeurs. La récente polémique née des propos de Dan Houser, ponte créatif de Red Dead Redemption 2, sur les semaines de cent heures — dont il a depuis contesté la généralisation —, et le problème des cadences infernales au sein de son entreprise Rockstar Games, ne sont qu’un nouvel exemple de la partie sombre de l’industrie.
Le problème est répandu. Début janvier, Le Monde, Mediapart et Canard PC révélaient les dysfonctionnements de Quantic Dream, fleuron du jeu vidéo français. En février, les salariés d’Eugen Systems entamaient une grève inédite.
En juin, dans Du sang, des larmes et des pixels, le journaliste américain Jason Schreier mettait au jour le recours quasi-systématique au « crunch » — le dépassement horaire dans les phases de bouclage — dans les plus prestigieuses compagnies américaines, comme Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us). Depuis déjà deux décennies, souvent anonymement, des salariés ou épouses de salariés d’Ubisoft (en 1999), d’Electronic Arts (en 2004) puis de Rockstar San Diego (en 2010) ont tenté de tirer la sonnette d’alarme, en vain.
En 2018, l’industrie du jeu vidéo se targue de peser désormais plus que celle du cinéma — ce qui est exact, à condition d’inclure les consoles et d’exclure l’exploitation des films en Blu-Ray et VOD. Mais elle demeure un secteur éprouvant, marqué par un turnover important de ses salariés et de nombreuses reconversions dans l’animation ou l’informatique, loin de l’image d’industrie de rêve qu’elle renvoie.
Semaines de soixante, quatre-vingt, voire cent heures ; management chaotique ; faibles salaires… un peu partout, les mêmes travers se retrouvent. Ce n’est pas un hasard : ils sont intimement liés à la structure même de l’industrie du jeu vidéo, et à la concentration de cinq spécificités.
Une industrie jeune, imprévisible, attractive et onéreuse
Premier problème, le jeu vidéo reste un secteur jeune. Suffisamment jeune, en tout cas, pour que les pionniers d’hier soient les dirigeants d’aujourd’hui. Nombre d’autodidactes géniaux apparus dans les années 1980 ou 1990 sont en charge d’importants studios — sans avoir été initialement formés à la gestion d’équipe. Les tensions peuvent être d’autant plus rudes que certains cumulent les casquettes de créatif en chef et de manageur, quitte à mélanger ce qui requiert de la passion et ce qui appelle de la réserve.
Or le monde de la manette est une industrie de prototype. Chaque projet suppose de repartir de presque zéro pour bâtir un monde entier avec ses niveaux, ses personnages, ses règles et son moteur physique — la partie informatique calculant mouvements, forces et interactions. Le tout sans certitude que le jeu sera amusant avant d’en avoir développé une bonne partie, amenant à de régulières reprises partielles ou totales, autant de travail supplémentaire pour les équipes.
Par ailleurs, l’industrie du jeu vidéo est historiquement hit-driven, c’est-à-dire qu’elle repose sur le succès commercial de quelques titres, et que celui-ci n’est jamais acquis par avance. Les bonnes ventes d’un projet à sa sortie ne garantissent pas nécessairement celles de sa suite, comme l’ont prouvé Watchdogs 2 et Titanfall 2. Cette impossibilité à prédire les retombées financières d’un jeu oblige souvent les gestionnaires à ajuster les salaires au minimum, par précaution.
Le contre-exemple d’Ubisoft
Chose qui n’arrange rien, le monde du jeu vidéo fait rêver, et cette attractivité est le premier ennemi des salariés en place, régulièrement mis en concurrence avec des légions de jeunes diplômés prêts à de nombreux sacrifices. La multiplication ces dernières années de lucratives écoles de jeux vidéo privées, comme encore Gaming Campus, à Lyon, récemment, n’a fait qu’aggraver le problème.
Enfin, les coûts de production progressent de manière exponentielle à mesure que les possibilités technologiques avancent, que les graphismes et la résolution s’améliorent, et qu’ordinateurs, consoles et téléphones gagnent en puissance. Développer un jeu coûtait en moyenne 500 000 euros dans les années 1990. Les superproductions se facturent aujourd’hui en dizaines, voire centaines en millions d’euros : environ 260 millions pour GTA V, en 2013. Or dans le même temps, la population des joueurs ne progresse pas assez vite pour que les retombées commerciales parviennent à absorber la hausse des coûts. Pour les studios, délocalisations et sous-traitance en Inde ou en Chine sont désormais devenues « inévitables ».
Le rapport de force est presque systématiquement défavorable aux salariés. Plusieurs professionnels rapportent s’être vus menacer de ne pas figurer au générique d’un jeu — seule preuve sur un CV — s’ils démissionnaient. Sur LA Noire, de Rockstar, ils avaient été une centaine à avoir découvert leur absence dans les crédits de fin.
Pourtant, les mauvaises conditions de travail ne sont pas une fatalité dans l’industrie. Selon tous les témoignages recueillis par Le Monde, l’éditeur Ubisoft, autrefois très critiqué pour sa gestion des employés, fait désormais figure de modèle. A défaut d’offrir des salaires élevés ou des perspectives d’évolution hiérarchique importantes, elle est régulièrement citée pour son attention à la diversité, à l’épanouissement de ses salariés et à la décence de ses horaires de travail hebdomadaire.
Jason Schreier rapporte, lui, que le développement de Spider-Man, la récente superproduction des Américains Insomniac Games sortie sur PlayStation 4, en septembre, a connu « un cycle de production sain, relativement sans “crunch” ».
Sécurité contre créativité
Plusieurs éditeurs se sont par ailleurs organisés pour lisser leurs rythmes de production et rationaliser la prise de risque financière. C’est le cas des licences sportives annuelles, comme FIFA ou Tour de France, qu’ils développent chaque année sur une base déjà existante, avec des prévisions de vente assez fiables, permettant d’adapter plus facilement les effectifs et les charges de travail aux besoins.
Activision a systématisé les suites de Call of Duty et Destiny, afin d’amortir les dépenses initiales sur plusieurs épisodes, en reprenant un squelette d’éléments communs (moteur de jeu, éléments graphiques, animations, etc.). De son côté, Ubisoft mutualise de nombreux éléments de ses jeux, d’un épisode à l’autre d’Assassin’s Creed par exemple, mais aussi entre séries, comme Assassin’s Creed et Far Cry, autant de petits gains de production. Quitte parfois à donner l’impression aux joueurs d’une prise de risque moindre.
Dans le même temps, les joueurs de jeu vidéo, et plus particulièrement de superproductions, rappellent fréquemment — et à bon droit — leur appétence pour des univers inédits et des séries nouvelles. C’est toute la difficile équation du jeu vidéo.