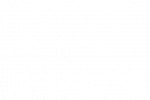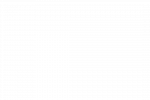« Jean-Michel Basquiat, la rage créative » : les mystères d’une étoile filante new-yorkaise

« Jean-Michel Basquiat, la rage créative » : les mystères d’une étoile filante new-yorkaise
Par Antoine Flandrin
Le documentaire de David Shulman donne la parole à de nombreuses personnalités qui ont côtoyé l’artiste.
Jean-Michel Basquiat à New York. Photo extraite du documentaire. / © MARION BUSCH
Comment retracer la trajectoire de Jean-Michel Basquiat, étoile filante de la scène artistique new-yorkaise, mort d’une overdose en 1988 à 27 ans ? Le poétique Downtown 81 d’Edo Bertoglio (1981) et l’étonnant Basquiat de Julian Schnabel (1996) avaient montré le besoin permanent de l’artiste de peindre par tous les moyens et sur toutes les surfaces. Le documentaire de David Shulman, Basquiat : la rage créative, d’une facture plus classique, se propose de percer les mystères qui entourent encore le personnage.
Monté sans voix off, il donne la parole à une multitude de personnes qui l’ont côtoyé. Ses sœurs, Lisane et Jeanine, racontent l’accident dont il fut victime à l’âge de 7 ans devant chez lui, à Flatbush, à Brooklyn. Renversé par une voiture, il est emmené à l’hôpital, où sa mère lui offre Gray’s Anatomy, classique de l’anatomie humaine publié en 1858 qui aura une grande influence sur lui.
Le film présente cet accident comme l’élément moteur de son enfance, passant sous silence ses rapports conflictuels avec son père, pour rebondir dix ans plus tard, lorsque Basquiat inscrit ses premiers graffitis sur les portes des rues de Downtown Manhattan. Son acolyte de l’époque Al Diaz, qui signe comme lui « Samo », pour « Same Old Shit » (« la même vieille merde »), explique que cette inscription se voulait comme une « alternative à Dieu ».
Le gratin des marchands d’art
Basquiat sort de l’ombre, en 1979, lors de « Canal Zone », une réunion de graffiteurs new-yorkais, faisant son apparition dans une interview télévisée. Il laisse alors entrapercevoir sa part sombre, mettant fin à sa collaboration avec Al Diaz en inscrivant partout « Samo is dead » (« Samo est mort »), un acte de trahison qui marque son passage de la rue au monde de l’art.
Son ami le rappeur Fab Five Freddy, explique comment, à force de fréquenter les grands musées new-yorkais, Basquiat se construit un répertoire d’images, de héros et de symboles issus des cultures les plus diverses. Le jeune artiste, qui n’a pas les moyens de se payer des toiles, peint sur des portes en bois qu’il trouve dans les immeubles en ruine de Manhattan.
S’appuyant sur de nombreuses archives privées ou télévisuelles ainsi que sur des toiles du peintre, le réalisateur fait alors défiler devant sa caméra le gratin des marchands d’art qui l’ont connu de près ou de loin : on retrouve la galeriste new-yorkaise Annina Nosei, qui fut accusée de l’avoir enfermé dans son sous-sol, le Zurichois Bruno Bischofberger, qui lui présenta Andy Warhol, le Californien Larry Gagosian, qui l’embarqua avec lui à Haïti pour l’éloigner des drogues et la New-Yorkaise Mary Boone, qui fit de lui un artiste richissime.
Leur parole omniprésente et leurs visages refaits finissent par écraser les autres témoignages. Il en résulte un film au ras de la galerie donnant à voir un peintre attiré par le milieu des marchands d’art opportunistes et insincères. Tous se vantent d’avoir été les seuls à avoir compris l’artiste enragé, révolté par le racisme et la condition des Noirs en Amérique, mais aucun d’entre eux ne s’interroge sur la dose mortifère de gloire que le monde de l’art a pu lui injecter. Leurs anecdotes le font surtout apparaître comme un jeune artiste à fleur de peau, tombant dans les pièges tendus notamment par les médias – il ne supportera pas que le New York Times le décrive comme la « mascotte » d’Andy Warhol. Un portrait qui ne parvient pas complètement à faire ressortir le génie torturé et autodestructeur qu’était Jean-Michel Basquiat.
Jean-Michel Basquiat, la rage créative, de David Shulman (Royaume-Uni, 2017, 55 min). www.arte.tv