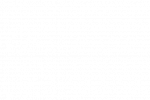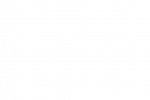Rwanda : des parties civiles veulent relancer l’instruction sur le massacre de Bisesero

Rwanda : des parties civiles veulent relancer l’instruction sur le massacre de Bisesero
Par Ghalia Kadiri, Pierre Lepidi
Des rescapés et des associations accusent les soldats français d’avoir abandonné des centaines de Tutsi à leurs bourreaux en juin 1994.
Des Hutu saluent des militaires français dans un camp de réfugiés près de Butare, au Rwanda, le 3 juillet 1994. / HOCINE ZAOURAR / AFP
Le dossier est-il définitivement clos ? Près de vingt-cinq ans après le massacre de Bisesero, au Rwanda, lors duquel plus d’un millier de Tutsi ont été assassinés en juin 1994 par des milices hutu, le rôle des militaires français reste contesté. Lors d’une conférence de presse, vendredi 26 octobre à Paris, la Ligue des droits de l’homme (LDH), l’association Survie et la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) ont déclaré avoir envoyé la veille une note au tribunal de grande instance de Paris « pour soulever les manquements constatés dans l’instruction » afin « d’empêcher un enterrement de l’affaire et un déni de justice ».
Cette déclaration au greffe fait suite à la clôture de l’instruction, cet été, après treize années d’enquête. Fin juillet, les trois juges chargés d’enquêter sur l’action de l’armée française à Bisesero ont mis un terme à leur travail sans prononcer de mise en examen à l’encontre des militaires mis en cause. « Cette fin d’enquête est prématurée car tout n’a pas été fait, déplore Fabrice Tarrit, co-président de Survie. Toutes les pistes n’ont pas été investiguées suffisamment. Ce qui s’est réellement passé à Bisesero est un moyen de faire la lumière sur le rôle qu’a joué l’opération “Turquoise” pendant le génocide et de montrer une des facettes du soutien de la France au régime génocidaire. »
« Incontestablement, les autorités savaient »
La tragédie de Bisesero est l’un des événements le plus sujet à controverse concernant le rôle de la France pendant le génocide des Tutsi, qui a fait 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Que s’est-il réellement passé dans cette chaîne de collines dans l’ouest du Rwanda ? Entre le 27 et le 30 juin 1994, plus d’un millier de Tutsi ont été méthodiquement tués par des miliciens et des soldats gouvernementaux. Présent dans le cadre de l’opération « Turquoise », une mission sous mandat de l’ONU pour « mettre fin aux massacres partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force », le premier détachement français n’était qu’à quelques kilomètres de là.
Depuis 2005, six rescapés des massacres, l’association Survie, la FIDH, la LDH et d’autres parties civiles accusent les soldats français d’avoir abandonné des centaines de Tutsi à leurs bourreaux. Les rescapés affirment que les militaires leur ont promis dès le 27 juin de les secourir. Or ceux-ci ne sont intervenus que le 30. « La question n’est plus de savoir s’ils ont été prévenus, assure Olivier Foks, avocat de Survie. Cette question est tranchée. Incontestablement, les autorités savaient, et je parle de toute la chaîne hiérarchique. De nombreux documents présents dans la procédure ne laissent plus de doute sur le fait que l’état-major des armées à Paris était informé. Pourtant, il n’y a eu aucun ordre, aucune réaction des autorités françaises entre le 27 et le 29 juin 1994. »
En treize ans d’enquête, plusieurs auditions, dont celle de François Léotard, alors ministre de la défense, ainsi que des confrontations réclamées par les parties civiles ont été rejetées par les juges. En 2017, ces derniers ont aussi refusé d’entendre l’amiral Jacques Lanxade, ancien chef d’état-major des armées, et son adjoint de l’époque, le général Raymond Germanos. « Je ne crois pas un seul instant que les juges ne soient pas indépendants, déclare Me Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH. Mais ils ont des contraintes : une forme de révérence permanente de la justice quand il s’agit de l’armée française. Si ces militaires sont renvoyés pour complicité de génocide, on peut imaginer qu’ils ne resteront pas le doigt sur la couture mais parleront des ordres venus du pouvoir civil et politique. Là est le vrai enjeu. »
« Des morceaux de chair arrachée »
Une vidéo, publiée le 25 octobre par Mediapart, se présente comme une nouvelle preuve dans un dossier déjà épais. Datée du 28 juin 1994, elle montre le chef des opérations spéciales au Rwanda, le colonel Jacques Rosier, en conversation avec l’un de ses subordonnés. Le sergent-chef M. tente de l’avertir que des crimes de masse ont été commis à l’encontre de Tutsi à quelques kilomètres de là : « Il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des maisons qui flambaient de partout… Les mecs se trimbalaient avec des morceaux de chair arrachée. » Dans une attitude passive voire indifférente, le colonel lui répond : « Eh ouais »
Comme le permet la loi, avant les réquisitions du parquet et la décision finale des juges d’instruction, les parties civiles ont formulé des observations et des demandes d’actes, parmi lesquelles des demandes de confrontation et d’audition de militaires, mais aussi de journalistes présents à Bisesero. « Cette fin de l’instruction suscite un sentiment de suspicion et d’une couverture d’impunité [pour les soldats français]. Ce n’est l’intérêt de personne d’en rester là », assure Patrick Baudouin, président d’honneur de la FIDH.
Cette demande intervient au moment où les relations diplomatiques se réchauffent entre la France et le Rwanda, après l’élection de Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des affaires étrangères de Paul Kagame, à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie, grâce notamment au soutien d’Emmanuel Macron.
Le 10 octobre enfin, le parquet de Paris a requis un non-lieu dans un autre dossier : la mise en cause de huit personnes, dont l’actuel ministre rwandais de la défense, dans l’attentat au cours duquel a péri le président Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994. Cet attentat, considéré comme l’élément déclencheur du génocide, est l’un des dossiers qui empoisonnent depuis plus de deux décennies les relations entre Paris et Kigali.
Génocide au Rwanda : quel rôle a exactement joué la France ?
Durée : 12:06