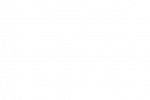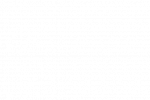Marc-Antoine Pérouse de Montclos : « Le Nigeria, un géant qui inquiète »

Marc-Antoine Pérouse de Montclos : « Le Nigeria, un géant qui inquiète »
Propos recueillis par Joan Tilouine
LE GRAND ENTRETIEN. A quelques semaines des élections, le politologue brosse le portrait du pays le plus peuplé d’Afrique et fait le bilan du président sortant, Muhammadu Buhari.
Lagos, capitale économique du Nigeria, en avril 2009. / REUTERS
Plus qu’ailleurs en Afrique, la loi du nombre s’applique brutalement au Nigeria. Avec plus de 190 millions d’habitants, ce géant d’Afrique de l’Ouest est le pays plus peuplé du continent, sa première économie et son plus grand espoir. Mais c’est aussi le pays qui concentre le plus de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, détrônant l’Inde cette année. En haut de la société, il y a des oligarques riches à milliards qui continuent de s’enrichir.
On y survit dans l’indigence et, dans le nord-est, sous la menace de Boko Haram, nébuleuse de va-nu-pieds djihadistes parmi les plus meurtriers de la planète. On s’y entretue au centre du pays, en proie à des violences entre éleveurs et agriculteurs bien plus meurtrières encore. Et dans le sud-est regorgeant de pétrole, des pirates lourdement armés menacent de reprendre les attaques contre les exploitants d’or noir et de replonger le pays dans la récession économique, tandis que des groupuscules sécessionnistes tentent d’exister.
A Lagos, la fourmillante capitale économique, se côtoient des entrepreneurs redoutables, des magnats plus ou moins corrompus, des innovateurs géniaux, des artistes et des affairistes en tous genres, aussi panafricains que les banquiers, les industriels et autres créatures propres à cette mégapole devenue une sorte de laboratoire de l’Afrique urbaine.
Autant d’univers qui cohabitent dans ce pays à l’économie peut-être la plus dynamique et inégalitaire d’Afrique, mais qui peine à s’affranchir de la volatilité des cours du pétrole. Après une période de croissance moyenne annuelle de 6,5 % (2005-2015), le Nigeria a eu du mal à sortir de la récession de 2016 et devrait connaître une croissance de 1,9 % cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international.
L’euphorie suscitée par son immense potentiel est peu à peu retombée. Des banques étrangères comme HSBC et UBS viennent d’annoncer leur retrait du pays, où la corruption, l’opacité dans l’attribution des grands contrats, les violences et l’absence de réformes économiques persistent malgré les promesses du chef de l’Etat, Muhammadu Buhari.
Elu en 2015, ce général de 75 ans à l’état de santé préoccupant avait ravivé l’espoir de la population en promettant d’assainir l’économie, d’éradiquer Boko Haram, de rétablir l’ordre et un climat des affaires propice à attirer les investisseurs étrangers. Son bilan est très critiqué par les Nigérians, qui décideront en février 2019 de lui accorder ou non un second mandat lors des élections générales. Face au président sortant, le principal parti de l’opposition a désigné Atiku Abubakar, 71 ans, un homme d’affaires influent mais réputé corrompu.
Le président nigérian, Muhammadu Buhari, à Berlin, en octobre 2016. / AFP
Directeur de recherches à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), le politologue Marc-Antoine Pérouse de Montclos décrypte les enjeux de ce scrutin et dresse un bilan du premier mandat de Muhammadu Buhari.
Sur quels grands thèmes de campagne les candidats vont-ils insister ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos La crise économique, le pouvoir d’achat et la sécurité devraient dominer les débats. Mais les agendas pour ce scrutin sont d’abord locaux. Les partis politiques nigérians agrègent des alliances régionales et sont dépourvus d’idéologie. Cette élection présidentielle voit surtout s’affronter deux poids lourds de la politique, plutôt âgés et critiqués. Pas vraiment des candidatures enthousiasmantes pour les Nigérians.
Comment ces vieux politiciens comptent-ils séduire une population dont près de 70 % a moins de 35 ans ?
Ce qui est intéressant, cette fois, c’est que ces élections pourraient bien se jouer sur la personnalité des candidats à la vice-présidence, à savoir Yemi Osinbajo pour Buhari et Peter Obi pour Abubakar. Ce sont eux qui vont incarner l’espoir du changement pour la jeunesse des villes et les classes moyennes. C’est là aussi que va se jouer le potentiel de réformes de la plus grosse économie du continent.
Yemi Osinbajo est un ancien ministre de la justice de l’Etat de Lagos. A 61 ans, il apparaît comme moderne et doté d’une vision managériale du pays. Durant les longs mois d’absence du chef de l’Etat, soigné au Royaume-Uni, Osinbajo a d’ailleurs eu à gérer des dossiers sensibles tels que les conflits liés au pétrole dans le delta du Niger. En face, Atiku Abubakar a choisi Peter Obi, 57 ans. Cet ancien gouverneur de l’Etat d’Anambra [sud-est], où il a laissé une réputation plutôt positive, bénéficie d’une image de politicien favorable à l’amélioration du climat des affaires.
Le président sortant semble fragilisé sur le plan politique. Quel bilan dressez-vous de son premier mandat ?
Le chrétien du sud Goodluck Jonathan [2010-2015] fut un très mauvais président, dont l’histoire retiendra d’abord qu’il a accepté sa défaite face à Buhari, un musulman du nord. Pour ce qui est de ce dernier, son plus important héritage politique sera peut-être d’avoir facilité une transition douce en faveur de son vice-président Osinbajo, un chrétien yoruba du sud.
Muhammadu Buhari a été élu en 2015 à un moment où le prix du baril de pétrole chutait et où le pays, qui dépend beaucoup de ses revenus pétroliers, s’enfonçait dans la récession. Dans ce contexte de crise économique, le nouveau président a d’abord soulevé de grands espoirs pour lutter contre la corruption. Il bénéficiait d’une image d’homme intègre, fort de son passé de dictateur militaire qui avait initié une « guerre contre l’indiscipline » au milieu des années 1980.
Buhari semblait aussi capable d’écraser le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est. Et d’entreprendre les grandes réformes nécessaires au développement du pays le plus peuplé d’Afrique, notamment dans le secteur pétrolier. Or son bilan est décevant sur tous ces points : Boko Haram n’est pas « techniquement défait », contrairement à ce qu’il avait affirmé en décembre 2015. La corruption persiste et les réformes économiques n’ont pas abouti.
Comment expliquez-vous qu’il ne se soit rendu qu’une seule fois à Lagos, la vibrionnante capitale économique qui fascine tant sur le continent ?
Lorsque Buhari était en campagne pour la présidentielle, ses partisans reprochaient au président sortant, Goodluck Jonathan, un ijaw du delta du Niger, de ne s’être rendu qu’une seule fois à Maiduguri [capitale de l’Etat de Borno, dans le nord-est], ravagée par Boko Haram. C’est donc une critique récurrente, dans les deux sens.
A Lagos, le président soigne son alliance, cruciale, avec le cacique yoruba Bola Tinubu. Ce faiseur de roi ou plutôt de président a apporté les votes de sa communauté à Buhari et lui a permis de l’emporter en 2015. Ce qui ne fut pas le cas en 2011.
Toutefois, comme beaucoup de notables du nord du pays, Buhari ne se sent pas à l’aise dans les grandes métropoles du sud. Il se méfie de la modernité de Lagos. Il a donc chargé son vice-président Osinbajo, lui-même de Lagos, de s’occuper des affaires du sud. Buhari, lui, s’est concentré sur le nord à dominante musulmane, dont il est originaire. C’est de cette zone sahélienne pauvre et rurale, bien moins développée que Lagos, qu’il tire son pouvoir.
Quelle image laisse ce président finalement taiseux et à la santé fragile ?
En tant qu’ancien militaire adepte de la culture du secret-défense, il n’est pas du genre à s’afficher avec l’élite flamboyante de Lagos ou à mobiliser les foules par de longs discours. Il est issu de l’aristocratie peule de l’Etat de Katsina. Et dans cette aristocratie, le chef ne parle pas. Ce sont ses adjoints qui s’en chargent et échangent avec le peuple. Ce qui renforce donc l’impression d’un président âgé voire cacochyme, qui parle peu et a finalement peu agi.
Par ailleurs, Buhari est malade. Il souffre d’un cancer, dit-on, et a été soigné plusieurs mois au Royaume-Uni. Il donne aussi l’impression d’être resté figé dans les années 1970, avec un logiciel de pensée très nationaliste. En 1984-1985, par exemple, il avait refusé de signer un plan d’ajustement structurel avec la Banque mondiale. Depuis son élection en 2015, il a néanmoins dû se résoudre à accepter l’aide de cette institution pour faciliter la reconstruction du nord-est du pays, ravagé par la crise de Boko Haram.
L’ancien vice-président Atiku Abubakar, à Port Harcourt, le 7 octobre 2018. / AFP
Quid de son rival, Atiku Abubakar, dont la désignation par le Parti démocratique populaire (PDP), principale formation de l’opposition, semble inquiéter le pouvoir en place ?
C’est un riche homme d’affaires et de réseaux, également originaire du nord mais très à l’aise à Lagos, où il fut contrôleur général des douanes, un poste de rente qui lui a permis de s’enrichir considérablement. C’est aussi un politicien éprouvé. Membre fondateur du PDP, il a joué un rôle important dans le passage d’une dictature militaire à un régime « civil », en 1999. Cette année-là, le PDP prend le pouvoir, le général à la retraite Olusegun Obasanjo est élu et Atiku Abubakar devient son vice-président. Il lui a apporté les voix du nord, avant de se brouiller après la rupture d’un accord informel censé le désigner comme dauphin d’Obasanjo.
Abubakar connaît parfaitement les rouages de la politique en régime parlementaire, contrairement à Buhari, qui n’est pas vraiment à l’aise avec les subtilités démocratiques. Lors de la présidentielle de 2007, il a été autorisé à se présenter au dernier moment seulement, ce qui l’a empêché de battre campagne, et il a fait un score médiocre. Cette fois, alors que le président Buhari est très critiqué, Abubakar apparaît comme un candidat d’envergure et un sérieux rival. Le jeu est désormais moins fermé qu’il n’apparaissait avant qu’il ne soit désigné par le PDP. Et son vice-président, qui jouit d’une bonne image, constitue un atout.
Muhammadu Buhari, chantre de la lutte anti-corruption, face à un politicien prétendument corrompu : n’est-ce pas un risque de retour en arrière sur ce thème central ?
Contrairement à ce qui était reproché au dictateur militaire Sani Abacha [1993-1998], qui plaçait des sommes considérables sur des comptes à l’étranger, Abubakar « fait tourner l’argent » à l’intérieur du Nigeria, comme on dit. Il s’est beaucoup enrichi lorsqu’il était contrôleur général des douanes notamment. Mais il a beaucoup réinvesti au Nigeria, ce qui lui confère une certaine popularité dans un pays où la population entretient une relation ambivalente avec la corruption.
Indéniablement, la corruption pénalise la fourniture de services publics de base. Mais elle permet aussi d’acheter une sorte de paix sociale et peut être perçue comme une sorte de redistribution informelle vitale pour maintenir l’activité économique. Quant à la lutte anti-corruption, elle sert traditionnellement à éliminer ou à affaiblir des rivaux politiques. Et sur ce point, Buhari n’a pas fait exception. L’agence dédiée à la lutte anti-corruption, l’EFCC, se voit reprocher d’être aux ordres du pouvoir. Elle a constitué des dossiers sur tout le monde mais a privilégié les accusations visant les responsables de l’ancien régime de Goodluck Jonathan.
Quelles ont été les avancées en matière d’assainissement du secteur pétrolier ?
Tout reste très opaque. La société pétrolière nationale, la NNPC, n’a pas été réformée. Elle fonctionne au ralenti, sans avoir été assainie, même si elle a commencé à payer des arriérés dus à des compagnies pétrolières qui menaçaient de cesser la production.
Les investisseurs étrangers sont las de la corruption, des détournements de la manne pétrolière, de l’insécurité persistante dans la région du delta du Niger et des incertitudes sur la fiscalité. La loi sur la gouvernance de l’industrie pétrolière est en gestation depuis 2006. Elle a récemment été votée par l’Assemblée nationale, mais le président Buhari refuse de la ratifier car elle prévoit de reverser une partie des revenus pétroliers directement aux communautés « hôtes » du delta du Niger et contrevient donc aux dispositions constitutionnelles sur le paiement de royalties au pouvoir fédéral.
Donc tout est bloqué, au grand dam des investisseurs, pour qui l’immobilisme du président Buhari en matière de réforme du secteur est un frein. Faute d’investissements, la production pétrolière du Nigeria ne pourra que stagner ou diminuer dans les dix ans à venir, le temps nécessaire entre l’exploration, la découverte de nouveaux gisements et leur mise en exploitation. Donc l’Angola va temporairement rester le premier producteur de pétrole d’Afrique, même si le potentiel du Nigeria est plus grand.
Sur les plans sécuritaire et économique, les pirates et autres criminels sévissant dans la région pétrolière du delta du Niger menacent-ils toujours de perturber la production d’or noir au point de pouvoir replonger le pays dans la récession ?
Il y a eu des menaces et quelques attaques. Mais le delta du Niger n’est plus du tout dans une situation d’ingouvernabilité, comme ce fut le cas en 2006. Le vice-président Osinbajo a eu la charge de gérer ce dossier sensible, avec un certain succès. Ce qui a considérablement affecté l’économie nationale, c’est plutôt le « bunkering », c’est-à-dire le vol de pétrole brut, une pratique qui existe depuis des décennies. Cette activité n’est plus l’apanage de pirates ou de gangs. Je reviens de Port Harcourt [capitale pétrolière, dans le sud] et on me dit qu’elle est désormais pratiquée par l’armée nigériane elle-même. Comme ça, il n’y a plus besoin de sous-traiter à des gangs.
Cela reflète bien l’incapacité du gouvernement Buhari à maîtriser ses troupes et à réformer son armée. Dans le nord-est, où la lutte contre Boko Haram se poursuit, les conditions de vie des militaires en brousse sont souvent épouvantables et, faute de rations suffisantes, ils détournent de l’aide humanitaire. D’une manière générale, la chaîne de commandement de l’armée reste fragile. Sur le terrain, les commandants locaux bénéficient d’une grande autonomie et jouissent d’une impunité totale lorsqu’ils se rendent responsables de violations des droits humains. Par exemple, Buhari n’a pas limogé son chef d’état-major quand il a ordonné à ses hommes de massacrer les membres d’un mouvement chiite radical en 2015. Paradoxalement, Buhari, en tant que militaire de carrière, n’était pas bien placé pour réformer une armée dont il se refuse à ternir l’image.
Dans un camp de déplacés ayant fui les massacres de Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, en juillet 2017. / AFP
Dans le nord-est, Boko Haram semble affaibli mais toujours capable de mener à bien des assauts meurtriers. Comment a évolué ce groupe que l’on dit aujourd’hui divisé ?
Le récit dominant, dans les médias, veut que le groupe soit scindé en deux. Il y aurait ainsi la faction d’Abubakar Shekau, « canal historique » de Boko Haram, et la faction affiliée à l’Etat islamique, menée par Abou Mosab Al-Barnaoui. Cette dernière était réputée plus structurée sur le plan doctrinal et davantage disposée à épargner les civils musulmans. Mais sur le terrain, on constate que ce n’est pas le cas. C’est par exemple la faction d’Al-Barnaoui qui a récemment exécuté deux sages-femmes du Comité international de la Croix-Rouge, nigérianes et musulmanes. Ce qui illustre la déliquescence d’un groupe qui, non content de tuer des humanitaires, s’éloigne de plus en plus de « l’orthodoxie djihadiste ».
Aujourd’hui, Boko Haram évoque plutôt une nébuleuse résiduelle de petits seigneurs de guerre à la tête d’unités qui s’adonnent au pillage pour survivre. Il n’y a pas un, deux ou dix Boko Haram, mais des sortes de « commandants de zone » qui utilisent cette franchise pour agir, sans dépendre d’un commandement central. Le groupe qu’on appelait Boko Haram a reflué et s’est beaucoup criminalisé. Il ne tient plus vraiment de territoires, même si, au cours des quatre derniers mois, ses combattants ont tué une centaine de militaires nigérians, un point soigneusement caché par le gouvernement. Ses combattants sont maintenant confinés dans des zones difficiles d’accès, essentiellement les marécages du lac Tchad et les maquis de la forêt de Sambisa, vers la frontière camerounaise.
Comment le président Buhari, plutôt solitaire et très nationaliste, a-t-il agi en partenariat avec les autres Etats du bassin du lac Tchad pour lutter contre Boko Haram ?
Il a vite compris qu’il avait besoin de ses homologues des pays voisins. A peine élu, il s’est rendu en visite officielle au Niger, au Cameroun et au Tchad pour consolider le montage d’une coalition antiterroriste autour du lac Tchad. Paradoxalement, Boko Haram a ainsi contribué à rapprocher des Etats qui, pour certains, avaient entretenu de très mauvaises relations par le passé. Cette année, pour la première fois, l’armée nigériane a par exemple défilé à Yaoundé lors de la fête nationale du Cameroun. Or il y a encore vingt ans, les deux pays s’affrontaient militairement dans la péninsule de Bakassi. On observe aujourd’hui un rapprochement stratégique assez fort sur la base d’intérêts communs contre Boko Haram, d’une part, et contre les groupes sécessionnistes « biafrais » du Nigeria et « ambazoniens » du Cameroun anglophone, d’autre part.
Le Nigeria semble avoir perdu de l’influence diplomatique et économique en Afrique. Il n’a pas encore ratifié l’accord sur la zone de libre-échange continentale et semble en retrait des grands dossiers de l’Union africaine (UA). Les stars panafricaines de Nollywood, de la musique ou de l’entrepreneuriat sont-elles de meilleures ambassadrices que le président Buhari ?
Elles font davantage rêver, c’est sûr, en Afrique mais aussi en Occident, où elles incarnent une élite et une classe moyenne dynamiques et pleines d’avenir. Buhari n’a pas assimilé ce logiciel néolibéral décomplexé. Il est un peu effacé dans les grands sommets de l’UA ou des Nations unies, et le Nigeria ne joue plus le rôle de leadership continental qu’il avait exercé au moment du boom pétrolier des années 1970.
Le Nigeria reste un géant, mais un géant qui inquiète. Dans la région, il apparaît d’ailleurs plutôt comme un contre-modèle. C’est une puissance par sa capacité de nuisance plus que par son effet d’entraînement positif. Et sur le plan de la politique extérieure, son rayonnement n’est plus qu’illusoire. On est loin du Nigeria des années 1970, qui, porté par le boom pétrolier, avait fondé la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, soutenu les mouvements de libération en Angola et au Sahara occidental et monté des opérations de paix au Tchad.