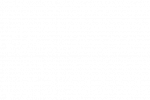Pigeons, souris, rats : les espèces les plus communes sont favorisées par les activités humaines
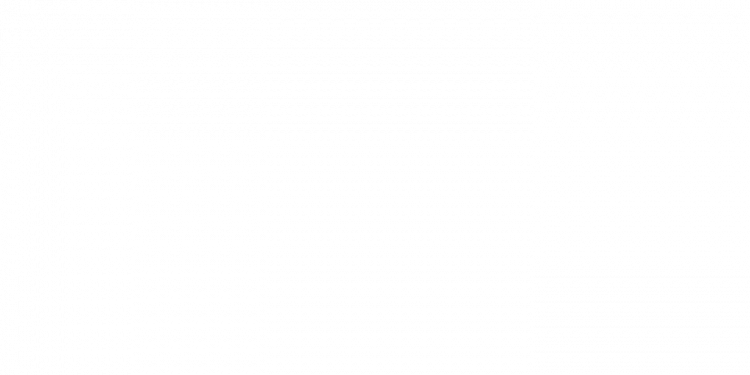
Pigeons, souris, rats : les espèces les plus communes sont favorisées par les activités humaines
Par Sylvie Burnouf
La modification des habitats par l’homme appauvrit la diversité des espèces animales et végétales locales.
Une femme nourrit un pigeon dans un parc de Minsk, en Biélorussie, le 16 mai. / VASILY FEDOSENKO / REUTERS
Des plantes et des bêtes qui ne se ressemblent pas, voilà ce qui fait la richesse et la singularité des contrées qui parsèment le monde. Le kiwi d’Okarito, par exemple, ne gambade qu’en Nouvelle-Zélande. L’okapi est endémique de République démocratique du Congo. L’arganier ne pousse qu’au Maroc. Et pour apercevoir un discoglosse de Montalent – une espèce d’amphibien – ou une nivéole à feuilles longues, c’est en Corse qu’il faut se rendre.
Mais ces spécificités locales pourraient s’estomper à mesure que l’homme transforme les habitats naturels en surfaces agricoles et en zones urbaines. Avec, à la clé, une uniformisation des espèces animales et végétales autour du globe.
Ce n’est pas qu’une hypothèse : le processus est déjà bien engagé. Une étude internationale, publiée mardi 4 décembre dans la revue Plos Biology, révèle que les espèces largement répandues, qui s’adaptent bien à tous types de milieux, tirent parti des habitats modifiés par l’homme et y prospèrent.
Plus d’impact aux tropiques
C’est le cas par exemple du pigeon, du faucon pèlerin, du moineau domestique, de la souris grise ou du rat des champs : on les retrouve partout car ils se sont particulièrement à l’aise dans ces nouveaux habitats, souligne Tim Newbold, écologue au University College London et premier auteur de l’étude.
A l’inverse, on observe un déclin, à la fois en termes d’abondance et de diversité, des espèces animales et végétales moins communes – qui possèdent des aires de répartition géographique modestes et sont donc plus vulnérables aux modifications de leur environnement – au sein des territoires exploités par l’homme. La chouette effraie des Célèbes, la panthère des neiges ou encore Amblystomus niger, une espèce très rare de coléoptère que l’on ne trouve qu’en France, en font partie.
Alors que la perte de biodiversité en cours dans le monde fait l’objet de nombreux travaux, c’est la première fois qu’une étude est menée à l’échelle planétaire en utilisant une telle méthodologie : les chercheurs ont compilé et analysé plus d’un million de données portant sur 19 334 espèces – dont 7 111 de plantes terrestres, 7 048 d’invertébrés et 5 175 de vertébrés – dans 81 pays. Végétation primaire et secondaire, plantations forestières, champs, pâtures, zones urbaines : tous les biomes terrestres ont été passés au crible, hormis les prairies et savanes inondables.
Sans surprise, leurs résultats montrent que, par rapport aux espaces de végétation primaire, le phénomène d’uniformisation des espèces touche principalement les milieux urbains, les plantations forestières, les champs et les pâtures, c’est-à-dire les habitats que l’homme contrôle le plus. La perte de diversité et d’abondance peut y attendre 30 à 50 % par rapport à des habitats non altérés par l’homme. Mais même les zones de végétation secondaire n’égalaient pas les régions indigènes en termes de diversité d’espèces locales.
En outre, l’impact au sein des écosystèmes dominés par l’homme était plus prononcé aux tropiques que dans les régions tempérées, ce que les chercheurs attribuent notamment au fait que les espèces tropicales endémiques sont plus spécialisées et ont des aires de répartition plus restreintes que celles des zones tempérées.
Parmi les solutions, l’agro-écologie
Pour Denis Couvet, directeur du département d’écologie et de gestion de la biodiversité au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, ces résultats soulèvent un « problème majeur pour la biodiversité – et donc pour les humains – notamment à cause de la dégradation des services écosystémiques qui devrait en résulter ». Selon lui, cette perte de biodiversité risque d’« obérer les capacités de résilience des écosystèmes face aux changements globaux ».
Afin de prévenir l’uniformisation des espèces, l’écologue recommande notamment le développement de pratiques forestières intégrant davantage de diversité et la réduction de l’agriculture conventionnelle au profit de l’agro-écologie. Cette dernière fait en effet « appel à des infrastructures écologiques – haies, bosquets, bois – nécessaires aux pollinisateurs et aux auxiliaires des cultures », et occupe des parcelles plus petites et plus diverses.
De fait, elle « demande et recrée une grande diversité d’habitats, favorable aux espèces spécialistes », souligne M. Couvet. Consommer moins permettrait également de réduire « la pression humaine pesant sur les écosystèmes, liée à leur exploitation ».