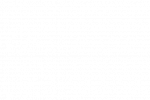Audrey, CRS blessée : « On sait que la violence va monter d’un cran et on est épuisés physiquement »

Audrey, CRS blessée : « On sait que la violence va monter d’un cran et on est épuisés physiquement »
Par Nicolas Chapuis
Blessée à la cuisse par un jet de pavé il y a une semaine, elle raconte sa confrontation avec l’« ultra violence » de la manifestation, dénonçant la stigmatisation des policiers.
Elle fait partie de ces anonymes casqués, dont les images ont tourné en boucle sur les téléviseurs. Audrey (le prénom a été modifié), gardienne de la paix au sein d’une CRS (compagnie républicaine de sécurité) présente à l’Arc de Triomphe samedi 1er décembre, a été blessée à la cuisse par un jet de pavé. Sa chute a été filmée et commentée à foison sur les chaînes d’information en continu les jours suivants. « Des experts, tranquillement installés dans leur canapé, expliquaient que ça se voyait qu’on était désorganisés. Ça m’a rendu folle ! », raconte-t-elle.
Il était environ 17 heures quand cette jeune policière, quatre ans et demi de compagnie républicaine de sécurité au compteur, a chuté sous l’impact du bloc de pierre, qui est passé sous son bouclier. A cet instant, Audrey est sur le pont depuis 15 heures d’affilée. « Je me suis levée à 0 h 30 pour prendre mon service à 2 heures du matin », rappelle-t-elle. Sa compagnie, stationnée temporairement à Paris, est affectée à la sécurisation des abords de la place de l’Etoile. A partir de dix heures, elle doit se positionner dans une rue adjacente à l’Arc de triomphe, avec sa section. Près d’une trentaine de femmes et d’hommes. Casques, jambières, boucliers, l’attirail habituel du maintien de l’ordre.
Pourtant la journée ne se présente pas comme les autres. « Ma première pensée était : ça pue la révolution. Il y avait une atmosphère de pré-chaos, j’ai senti que c’était apocalyptique dès que j’ai posé le pied sur le pavé parisien », explique-t-elle. Elle ne se doute alors pas que c’est ce même pavé parisien qui va la meurtrir quelques heures plus tard. De toute façon, la jeune femme n’a jamais aimé la capitale.
Des « envies de meurtres »
Des voix grésillent sur les ondes. Des manifestants sont en mouvement. Sa section reçoit l’ordre de les suivre. « On gravitait autour de la place, on rentrait dans les fourgons, puis on ressortait… » Vers 11 h 30, c’est l’heure de la pause sandwich. Les CRS se doutent que l’après-midi risque d’être autrement plus musclé. « On savait que ça allait être violent, avec toutes les conneries écrites sur les réseaux sociaux, les gens se montent le bourrichon. On avait lu que certains voulaient tuer du flic ! »
Soudain des manifestants commencent à caillasser les véhicules. Les policiers forment un barrage de boucliers autour de leurs fourgons. Ils s’en sortent avec de la tôle froissée. Mais ce n’est que le début. « Ça a dégénéré, on aurait dit une guérilla », raconte Audrey. Sa section est appelée pour sécuriser les abords de l’avenue Kléber, où l’intérieur d’un hôtel particulier est en train de flamber. Les grilles ont été arrachées. « On est tombé dans un guet-apens, ils nous attendaient. J’ai déjà fait des manifestations qui dégénèrent, mais là, c’était de l’ultra violence. Ils avaient des envies de meurtre. Nous, notre but c’est juste de rentrer en vie chez nous, pour retrouver nos familles. »
Elle raconte les insultes des manifestants et le mépris dans leurs yeux. « Quand on était en barrage, les gens passaient devant nous et crachaient à nos pieds. J’ai vu un mec nous expliquer qu’il était père de famille et pacifique. Deux minutes après, il nous jetait un pavé. Les gens deviennent fous. » L’effet de meute ? « L’effet mouton plutôt », corrige-t-elle.
Impossible de savoir l’heure exacte, la jeune CRS est « totalement déconnectée », dans une ambiance saturée de gaz lacrymogène. Mettre ou ne pas mettre le masque ? Un vrai dilemme. « Certains préfèrent faire sans, moi je ne supporte pas le gaz. Mais avec le masque, votre respiration est limitée et la buée empêche de voir. » Deux de ses collègues, qui ont opéré sans pour manier les lanceurs de balles de défense 40, ont eu la cornée brûlée.
Blessée, elle refuse d’abandonner ses collègues
La nuit commence à tomber quand l’endroit où sont stationnés les fourgons est menacé par les flammes. « Un groupe s’est rendu compte que notre fourgon n’était pas protégé par les CRS, ils ont commencé un énorme caillassage. A ce moment-là, je me suis dit : “Il va falloir que tu t’en sortes”. On a pris une pluie de projectiles, il n’y avait pas de moment d’accalmie. Ils étaient super bien organisés. » Un projectile se fraie un chemin entre le bouclier et la jambière. Elle s’effondre. « J’ai dit à mon binôme que j’étais touchée, il m’entendait mal. Quand il a compris que je n’étais pas bien, ils m’ont extrait de la fumée. J’étais perdu, je respirais le gaz. »
Audrey refuse cependant que le soigneur découpe son pantalon pour jeter un œil à la blessure. Cela signifierait pour elle la fin de la journée. Pas question d’abandonner ses collègues. Tout juste passe-t-elle une bombe de froid sous son pantalon. Le spray, actionné trop près, corrode la peau. Qu’importe, elle retourne aux côtés de son binôme, à qui elle cède la gestion du bouclier, incapable de l’appuyer contre la cuisse.
Les manifestants commencent heureusement à se disperser. Sa compagnie est démobilisée vers 21 heures. Le lendemain, l’aspect de la plaie l’oblige à la signaler. « Ma blessure commençait à faire des cloques. » Ecrasement du quadriceps et brûlure au deuxième degré, cinq jours d’arrêt.
Mais c’est moins pour elle que pour ses collègues qu’Audrey semble s’en faire. La compagnie, qui aurait dû être « gelée », selon le jargon policier, après un détachement de deux semaines, a été rappelée pour la journée du 8 décembre. « On sait que la violence va monter d’un cran et on est épuisés physiquement. »
Le moral n’est pas non plus au beau fixe, notamment avec les accusations de violences policières. « Il faut arrêter de pointer les flics du doigt. Les gens voient une vidéo sur Facebook, sans le contexte, et ils croient qu’ils sont experts du maintien de l’ordre. » Et de cibler les casseurs. « Ils nous visent avec des pavés, des mortiers, des cocktails Molotov… J’en ai vu un prendre les débris de la grille pour en faire un javelot et nous le jeter à la tête. Ils veulent nous tuer. Et nous, on répond avec quoi ? Du gaz qui pique les yeux et des balles en caoutchouc. »