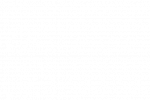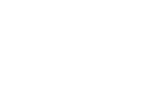Les partenaires sociaux ont été reçus par le gouvernement vendredi

Les partenaires sociaux ont été reçus par le gouvernement vendredi
Par Raphaëlle Besse Desmoulières, Bertrand Bissuel
Parmi les points abordés figure la proposition d’accorder aux salariés une prime exceptionnelle versée par les employeurs. Une nouvelle réunion est prévue mardi 11 décembre.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, et Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, avant la réunion des partenaires sociaux au ministère du travail, à Paris, vendredi 7 décembre. / FRANCOIS GUILLOT / AFP
La symbolique n’est pas pour leur déplaire. Vendredi 7 décembre, les partenaires sociaux ont été reçus par plusieurs membres du gouvernement au ministère du travail, sous les lustres et dorures du salon où furent négociés les accords de Grenelle en 1968. Accords qui s’étaient soldés, à l’époque, par une victoire de taille pour les syndicats : une augmentation de 35 % de ce qu’on appelait alors le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et un relèvement de près de 14 % pour les autres salaires. Les « événements » d’il y a cinquante ans n’ont sans doute « rien à voir » avec le mouvement des « gilets jaunes », selon les mots de Laurent Berger, à l’issue de la rencontre, mais le numéro un de la CFDT n’a pas pu s’empêcher de faire référence à cette conférence historique. Comme s’il voulait signifier que les grandes confédérations sont, à nouveau, au centre du jeu pour trouver une issue à la crise. « Il a fallu ça pour que le gouvernement se rende compte qu’il y a des syndicats dans ce pays », relève Yves Veyrier, le secrétaire général de FO.
Voilà donc les organisations de salariés de nouveau au premier plan, après avoir été tenues à distance depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. Mercredi, le président de la République avait exhorté les acteurs politiques et sociaux à « lancer un appel clair et explicite au calme ». Il a été entendu dès le lendemain par les syndicats. Les leaders de sept centrales, dont la CFDT et la CGT, ont, en effet, signé une déclaration commune dans laquelle ils « dénoncent toute forme de violence dans l’expression des revendications ». Au passage, ils se sont félicités que l’exécutif ait enfin « ouvert les portes du dialogue », même avec « beaucoup de retard ». Mais leur démarche n’est pas synonyme d’unité, chacun ayant décidé d’y aller « avec ses propres revendications et propositions ».
Pouvoir d’achat, transports, fiscalité...
Lors de la réunion de vendredi au ministère du travail, cinq thèmes ont été abordés et vont faire l’objet d’une réflexion approfondie, pour dégager des mesures concrètes : le pouvoir d’achat, les transports, le logement, la fiscalité et l’accès aux services publics. Un autre conclave est programmé mardi 11 décembre. « Ils sont en train de se dire qu’il faut changer de paradigme », veut croire le responsable d’une confédération. Parmi les pistes de réponses immédiates a été mentionnée la généralisation d’une prime transports en faveur des salariés contraints de prendre leur voiture pour aller travailler. Une revendication de longue date de FO, à laquelle s’est associée la CFDT. « Cela fera partie des chantiers », a confirmé Muriel Pénicaud, la ministre du travail.
Autre sujet examiné : une prime exceptionnelle versée par les employeurs à leurs salariés. Elle serait facultative, défiscalisée et non assujettie à des cotisations sociales. Le patronat a réagi avec bienveillance. C’est « une bonne idée », a indiqué Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, précisant qu’elle pourrait être mise en place dans les secteurs « où ça va bien ». A condition, a insisté Jean-Eudes du Mesnil du Buisson (secrétaire général de la Confédération des PME), qu’elle reste à la discrétion des entreprises. Ce dernier a évoqué une somme de 1 000 euros qui pourrait être distribuée en plusieurs fois. Un tel schéma mérite « d’être regardé », a commenté M. Berger mais il doit être obligatoire, à ses yeux. M. Veyrier s’y est également déclaré ouvert, tout en soulignant que cette prime ne réglerait pas la question des salaires, « qui demeurera profonde ».
Pression sur les entreprises
A ce stade, l’exécutif maintient la position affichée, le 28 novembre, par Edouard Philippe : pas question de donner un « coup de pouce » au smic – en plus de sa revalorisation légale. « Les syndicats responsables n’en veulent pas », confie un membre du gouvernement. « On ne va pas imposer par la loi une augmentation générale des salaires, on détruirait de la compétitivité et de l’emploi », a plaidé Mme Pénicaud, vendredi, sur BFM Business. Mais il appartient aux branches et aux entreprises d’ouvrir des négociations sur la fiche de paye. « Je sais qu’elles sont prêtes à le faire, il faut le faire », a martelé la ministre du travail. Une façon de mettre la pression sur les entreprises. Stéphane Richard, le président du groupe de télécommunications Orange, s’est d’ores et déjà dit prêt à apporter son écot : « Il va falloir lâcher du lest », a-t-il affirmé, jeudi, sur France Info.
Vendredi, dans la salle des accords de Grenelle, un acteur syndical naguère incontournable manquait à l’appel : la CGT. Elle « ne veut pas servir d’alibi », a justifié son secrétaire général, Philippe Martinez, dans un entretien au Monde. Une décision, annoncée peu après la signature de la déclaration des sept confédérations, qui a surpris jusqu’à ses homologues. « Il dit le contraire de ce qu’on venait de dire ensemble », déplore l’un d’eux. Des errements mis au crédit des divergences qui minent l’organisation de M. Martinez : après avoir paraphé le texte commun, ce dernier « n’était pas encore arrivé à Montreuil [siège de la CGT] qu’il se faisait déjà démonter la tête » par la partie la plus radicale de sa base, soupire le haut gradé d’une centrale. A l’heure où les syndicats pourraient enfin peser, la CGT donne de nouveau le sentiment de se mettre hors jeu.